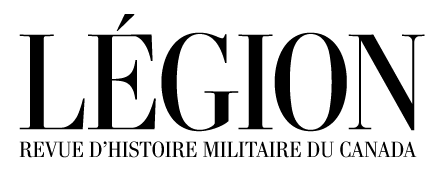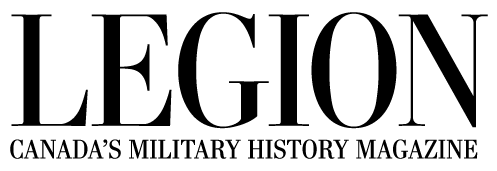![Une petite résidente de Regay observe la patrouille qui passe. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2008/06/afghanlead.jpg)
En début d’après-midi du deuxième jour de l’Opération Ateesh Bazi, alors que notre patrouille chancelait durant sa 10e heure à ce qu’on soupçonnait être, pour la troisième fois, un bastion d’insurgés, la chaleur était plus frappante et envahissante qu’un phénomène climatique devrait être.
Les chiffres ne comprennent ni ne racontent les effets du soleil de midi dans le désert afghan sur les cerveaux et les corps de Canadiens nés pour le froid. Il fait si chaud que le mot lui-même ne dit pas combien il fait chaud. On suce l’air. Le gilet de protection balistique nous fait cuire comme des plaques chauffantes fixées à la poitrine, au dos et à la tête, et on est à peine conscient que nos systèmes sont surchargés. On se sent comme si on devrait griffer quelque chose.
Mais nous continuions la marche. Quelqu’un dit qu’il faisait 42° C; quelqu’un dit qu’il fait 44 à l’ombre. Le paysage de village et de murs en boue, de pavots et sable perdait tout contraste et saturation jusqu’à ce que tout ait l’air surexposé et indistinct.
Au début, on parlait de nombre de choses pour atténuer l’inconfort. Ensuite, on voyait des mirages. Et puis notre vision devenait trouble, alors on rêvait de mirages.
L’opération allait de l’avant. On nous a avertis que des hommes en âge de combattre se déplaçaient sinistrement devant nous. Les soldats canadiens haletaient littéralement. La sueur descendait jusqu’en bas de leurs pantalons lourds. Ils suaient tellement qu’ils arrêtaient de suer. À ce moment-là, ils ont commencé à cuire. Tout bavardage inutile s’est arrêté. La patrouille avance de 50 mètres et fait une pause de 30 minutes. La patrouille avance de 50 mètres de plus et fait une pause de 40 minutes. Ces distances ne sont pas grandes. Tout le monde s’affale dans n’importe quelle ombre qu’on peut trouver.
![Des soldats afghans entrent dans le village de Regay, au district de Panjwai. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2008/06/afghaninset1.jpg)
Ce n’était pas facile d’arriver ici, au village de Khenjakak, au milieu du district de Panjwai de la province de Kandahar. Et maintenant que les Canadiens et tous les soldats afghans qu’ils ont réussi à rassembler sont finalement arrivés, la seule chose à laquelle n’importe qui peut penser c’est d’essayer de faire durer l’eau jusqu’à la fin du jour afin de ne pas s’écrouler.
Le contact avec l’ennemi, n’importe quand durant l’après-midi, aurait vraiment été un événement affreux et inopportun. Ça aurait été un chaos au ralenti; une course de 20 secondes aurait brulé l’homme dans la meilleure forme qui soit. Heureusement pour nous, ce n’est pas arrivé, bien que tout le monde s’attendait à ce que ça arrive. Plutôt que des talibans, les Canadiens ont surtout trouvé des villages déserts, comme si tout le monde était parti en vacances, probablement quelque part où il fait frais. Les talibans, s’il y avait des talibans ici, ont apparemment vu le grand nombre de soldats afghans et une certaine quantité d’armure canadienne convergeant vers eux à travers la province et les hélicoptères de combat décrivant des cercles au-dessus d’eux, et ils ont décidé que ce n’était pas le meilleur moment de se battre.
Malgré la chaleur, les talibans ont probablement bien choisi parce que personne n’était de très bonne humeur pour le combat.
* * *
Une unité d’Afghans de l’opération était menée par un homme que les Canadiens ont surnommé Al-Qaeda.
Le lieutenant Matiullah a ce surnom à cause de sa barbe menue, sa dévotion à la prière et son habitude de répondre « inshallah » — traduction : ça arrivera si Dieu le veut — à chaque déclaration ou demande, mais il ne fait que rire chaque fois que quelqu’un l’appelle Al-Qaeda.
Il a le commandement de la 1re Compagnie du 1er Bataillon, du 1er Kandak du 205e Corps de l’armée nationale afghane, une unité basée à la Base d’opérations avancée Sperwan Ghar, base dirigée par les Canadiens dans le district de Panjwai du Kandahar. Son autre surnom, c’est Shumps. En fait, personne ne l’appelle Matiullah; on l’appelle toujours Shumps, et personne ne m’a jamais dit pourquoi.
Shumps est un soldat afghan typique de bien des façons : il est fier et brave, habituellement jovial mais quelque peu impénétrable; n’importe à quel point on l’observe, on ne sait jamais à quoi il pense ou comment il se sent. Il sourit souvent quand il est contrarié et c’est quand il raconte des farces qu’il a l’air le plus fâché. Quatre Canadiens ont été attachés à sa compagnie de soldats afghans en tant que conseillers. Les Canadiens font partie de l’Équipe de liaison et de mentorat professionnel (ÉLMP), qui est formée de petits groupes de soldats canadiens affectés aux unités afghanes, des fantassins habituellement, mais des fois des unités de policiers ou d’autres.
Durant deux jours à la fin du mois d’avril 2008, Shumps et ses mentors canadiens ont rejoint une autre compagnie afghane et une grosse force de Canadiens lors de l’Opération Ateesh Bazi, une manœuvre compliquée de deux jours dans une région du Panjwai appelée « bastion d’insurgés », une série de villages où il n’y a pas eu de présence importante de l’OTAN depuis neuf mois. Bien que les villages ciblés par Ateesh Bazi, Adamzai, Khenjakak et Salavat, ne se trouvent qu’à quelques kilomètres au sud d’un axe de ravitaillement canadien important, l’OTAN ne se souciait pas de cette région auparavant.
Au cœur de ces villages se trouve un endroit appelé Nakhonay qui, au début du printemps 2008, était souvent le sujet dont s’entretenaient les soldats canadiens autour du Panjwai. Nakhonay était un endroit dont les gens parlaient discrètement la nuit. Des centaines de talibans étaient là, le bruit courait, qui opéraient ouvertement dans les rues; ils avaient instauré un gouvernement parallèle, avaient leur propre monnaie et leurs propres tribunaux. C’était si farfelu, tout le monde était d’accord, qu’il fallait pratiquement que ce soit vrai.
En tout cas, Shumps n’était pas inquiet. Ou bien il l’était. C’est difficile à dire. Des fois, il avait l’air impatient, mais il s’ennuyait peut-être. La barrière linguistique m’empêchait de le découvrir, bien que même là, à propos de la langue anglaise, Shumps était difficile à lire. Son aisance en ce qui concernait l’anglais laissait perplexe même le capitaine Matt Aggus, le mentor de l’ÉLMP assigné à Shumps depuis quelques mois et son ombre durant cette opération.
Aggus est un officier intellectuel, presque pensif, de la Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et il croit que l’officier afghan comprend bien plus l’anglais qu’il ne le laisse entendre, mais qu’il ne réagit que si c’est quelque chose d’important qui arrive ou qu’il veut vraiment savoir. Par la suite, durant l’opération, par exemple, quand un des soldats de Shumps s’est mis à critiquer ouvertement l’aptitude d’Aggus en ce qui concernait la lecture d’une carte, ce dernier a réussi à très bien comprendre la situation sans interprète.
Aggus, qui semble être assez en forme pour pouvoir courir trois marathons d’affilée, n’était pas du tout dérangé par cela. Le bilinguisme étrangement inconstant de Shumps n’était qu’un fait de la vie pour Aggus, quelque chose à quoi réfléchir pendant qu’il observait l’horizon.
Diplômé de l’University Queen’s de Kingston (Ont.), le capitaine Aggus voulait à l’origine être médecin mais, comme il le dit, il a décidé de briser les gens plutôt que de les arranger. Il ne veut pas vraiment dire ça, bien sûr, il fait simplement preuve d’humour noir, mais c’est ce qu’il dit.
Son rôle en tant qu’officier de l’ÉLMP n’est pas facile du tout. Il ne commande pas Shumps. Et il n’est pas chargé de le former non plus. Il est simplement là pour le conseiller, peut-être pour lui servir d’exemple et peut-être, ce qui est le plus important, pour servir de liaison avec les autres forces de l’OTAN et le support aérien durant les opérations comme Ateesh Bazi.
Le plan de manœuvre général pour l’Opération Ateesh Bazi, c’était que le major de l’ÉLMP Mark Campbell et Aggus emmènent la force principalement afghane de Sperwan Ghar, à travers un village soupçonné d’appartenir aux insurgés, et de rejoindre la force canadienne de chars d’assaut et de blindés venant de la Base d’opérations avancée Masum Ghar. Après s’être rencontrés, les deux groupes devaient mener un exercice de tir réel à leur portée en fin d’après-midi avant de camper pour la nuit, à un certain endroit dans le désert, et puis prendre la route de Nakhonay à l’aube.
Le matin du 24 avril 2008, le 1er jour de l’Opération Ateesh Bazi, alors que la compagnie afghane de Shumps sortait de Sperwan Ghar pour ce qui allait être la plus grosse opération à laquelle elle avait participé, Aggus montait à bord d’un Nyala RG-31 avec le reste de son équipe d’ÉLMP à la recherche de la guerre. L’équipe comprenait un infirmier et un chauffeur/tireur qui était aussi commandant en second d’Aggus, l’adjudant John McNabb.
Ce dernier, un ancien soldat du régiment aéroporté qui en est à son troisième voyage en Afghanistan, semble avoir découvert la façon dont on endure, avec beaucoup d’humour, n’importe quelle calamité ou malchance qui arrive. En plus de cela, surtout dans une opération comme celle-ci, on sent quand on se tient près de lui qu’il sait ce qu’il fait et, par conséquent, je ne le quitte pas d’une semelle pendant les deux jours qui suivent.
Bien entendu, aller à la recherche de la guerre comme Shumps, Aggus et McNabb en ont l’intention, n’a rien de facile, surtout en Afghanistan, où on peut être certain que les choses ne vont pas se passer comme on les a prévues et, en plus de tout ça, la manière particulière dont les choses arrivent est toujours surprenante, pour ne pas dire malicieuse.
Le premier arrêt de l’opération arrive au village de Regay qu’il faut nettoyer et qu’on a évalué comme ayant une certaine connexion avec les méchants qui se trouvent peut-être dans la région de Nakhonay. Lorsque le convoi prend le départ, McNabb claque la portière du Nyala et semble un peu confus en voyant la longue portière en acier se mouvoir librement avec sa main. Le loquet s’est brisé et il en vient à tenir à la main quelques kilogrammes d’acier, très important mais maintenant inutile.
Il secoua la tête et regarda autour de lui, comme s’il se demandait si quelqu’un était en train de faire une farce à ses dépens. « Oh ben, tabar—k », dit l’infirmier, assis en face de lui, qui regarde la portière qui va et vient. « C’est pas possible. »
![Le capitaine Matt Aggus (à g.) et le lieutenant Matiullah (Shumps) discutent de leur traversée d'Adamzai. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2008/06/afghaninset8.jpg)
En peu de temps, l’adjudant avait trouvé une façon d’étirer la jambe pour coincer son pied contre un petit coffre et tenir ainsi la portière fermée, mais il était probablement extrêmement inconfortable, vu qu’il était bouclé fermement dans un harnais à cinq branches. Il ne dit pas un seul mot. Il ne faisait que secouer la tête et il semblait attendre la prochaine chose qui irait mal.
Il n’a pas eu besoin d’attendre longtemps. D’abord, les radios ne fonctionnent pas, ensuite, une couple de véhicules de l’armée nationale afghane (ANA) sont embourbés dans un oued, et puis il y a des rapports que la grosse force canadienne qu’on devait rencontrer près de Regay avait déjà beaucoup de retard à cause de problèmes de navigation à quelques kilomètres à l’est et elle était en train d’envoyer des véhicules chenillés à travers des murs de boue pour trouver une issue. À la radio, on demandait le déploiement des spécialistes canadiens chargés de compenser les fermiers afghans quand leurs biens sont endommagés par l’OTAN.
Pendant ce temps, la portière du Nyala s’ouvrait toute seule durant notre tangage à travers les routes aux profondes ornières. L’adjudant McNabb ne pouvait que secouer la tête d’un air grave.
« Un soldat m’a enseigné un adage l’autre jour », lui dis-je.
Il me regarde et soulève son menton un millimètre à peine; à l’évidence, il voulait l’entendre. C’était un adage sévère, le genre de choses que disent les soldats quand il s’agit de décrire la vie à la guerre toujours accablante.
« F—kery knows no bounds (la putasserie n’a pas limites) », lui dis-je.
Il sourit en coin, évidemment très amusé. Et puis il a l’air de réfléchir. « Les Afghans ont un adage comme celui-là aussi », dit-il calmement. « C’est “inshallah”. »
Il ne faut pas oublier que cela se passe durant la première demi-heure de l’opération, quand la base Sperwan Ghar que nous venions de quitter était encore bien visible. La friction. C’est comme ça que les gars qui se spécialisent en planification appellent ça. Cela signifie que dans une manifestation aussi compliquée que l’Opération Ateesh Bazi, il y a toujours beaucoup de petites choses qui vont mal, alors il faut échafauder un plan robuste qui puisse supporter les petites éventualités sans se faire démanteler entièrement. Pour cette opération, les planificateurs devaient être bons, alors il n’y a pas eu de divagation malgré une friction importante.
Après quelques heures de retard et de battage, la grosse force afghane de deux compagnies s’est rendue à la périphérie de Regay, où elle descend des véhicules et se prépare à entrer au village à pied. Mais les soldats s’assoient un peu partout avant que les patrouilles prennent le départ, et se demandent ce qui va se passer durant les quelques prochains jours, si les talibans vont se battre ou rester tapis. En général, ils pensent qu’ils vont rester tapis, mais personne n’est vraiment sûr. « C’est la première fois qu’on va fouiller du côté sud-ouest de Nakhonay », dit le major Campbell. « On veut le définir d’abord, ou tout au moins essayer.
« Si on s’avance avec une puissance de combat écrasante, ils ne vont pas accepter le combat. Ils ne sont pas stupides », dit-il, finissant sa phrase presque comme si c’était une question. Là-dessus, l’opération était lancée officiellement et les soldats afghans, avec leurs mentors canadiens, commencèrent à marcher, en trois longues colonnes, vers Regay, le soleil déjà haut dans le ciel, qui tapait sur les montagnes découpées non loin de là.
![Un soldat de la 1re compagnie avec son arme improvisée. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2008/06/afghaninset6.jpg)
Quant à Regay, comme cela se fait communément pour décrire un endroit dans un pays étranger, il est « au bord du désert ». En réalité, Regay est même encore plus au bord du désert que ça. Dans ce cas-ci, c’est le désert du Registan, qu’on appelle des fois le désert Rouge à cause de sa couleur ocre foncée, et le village de Regay en est à la fin du processus où il en devient une partie.
La périphérie de Regay est une série de dunes d’où sortent des murs en ruine. Il n’y a pas d’adultes autour, mais des enfants courent librement parmi les dunes, peut-être jouent-ils. À l’intérieur du village, des dunes plus petites couvrent les petites allées entre les enceintes et nombre d’édifices en ruines semblent avoir été décorés avec des gravures complexes par quelque force étrange d’une autre planète, et puis bombardés par une autre force. En général, l’endroit semble appartenir à un temps tout de suite après la fin du monde; ou peut-être avant elle.
Aggus et Shumps guident les soldats afghans dans la bonne direction. Shumps, bien qu’il semble être attentif, ne s’intéresse guère à la carte d’Aggus, ni aux plans tactiques dont il parle, ni aux conseils de navigation qu’il lui donne; à la place, il semble content d’aller dans le sens du courant, quel qu’il soit.
La patrouille s’avance en plein milieu du village et s’établit sur une dune, à découvert. L’autre compagnie afghane est visible au loin, qui contourne la périphérie de Regay et vient vers nous. « 7-1 Alpha », dit Aggus à la radio. « La 1re Compagnie a dépassé l’objectif Little Mountain et s’est disposée au point 31256. À vous. »
Le capitaine se laisse tomber, désireux de conserver son énergie dans cette chaleur accablante. « C’est insupportable », dit-il. « Il y a encore trois heures avant la partie la plus chaude de la journée; ça va être une h—tie de fournaise. »
Shumps n’est pas convaincu que ce soit une bonne idée de garder sa patrouille ici. Et vu que sa compagnie est étalée en petits groupes à des centaines de mètres dans toutes les directions, sa brève hésitation est cause de confusion, car nombre d’entre eux ont continué de marcher, ne sachant pas que nous avions atteint l’objectif que nous nous étions fixés.
L’interprète dit à Aggus que Shumps veut emmener la compagnie à la limite des arbres à 500 mètres de là, où des soldats afghans attendent déjà, et il semble déjà demander que sa compagnie prenne le départ. « Je sais qu’ils attendent », réplique Aggus immédiatement, « mais on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller avant d’avoir rejoint le commandant de Kandak et qu’il nous dise ce qu’il veut qu’on fasse. »
L’interprète dit ça à Shumps qui semble y réfléchir un instant avant de porter son regard à la limite des arbres avec indifférence. Il trouve probablement le besoin constant des Canadiens de tracer et contrôler les positions et de vérifier tous les mouvements avec les supérieurs, plutôt ennuyeux. La limite des arbres était sans doute une meilleure position que de rester assis à découvert, comme c’était le cas à ce moment-là, alors il lui a probablement semblé étrange que les Canadiens veuillent tenir cette position simplement parce que c’est la position choisie sur une carte quelques jours auparavant.
L’interprète, un jeune Afghan du Nord, ne parle probablement pas l’anglais beaucoup mieux que Shumps. Malgré cela, il prenait de grands risques en se trouvant ici, car les interprètes, au contraire des soldats de l’ANA, sont souvent injuriés par beaucoup d’Afghans. Quelques instants auparavant, l’interprète se vantait que même sa propre mère ne sait pas comment il gagne sa vie.
Shumps et l’interprète parlent quelques secondes et puis ce dernier dit à Aggus que la radio du commandant de Kandak est en dérangement, et que Shumps n’arrive pas à le joindre. Aggus soupire et appelle lui-même, sachant déjà la réponse qu’on va lui donner. « L’indicatif d’appel ici a l’intention d’avancer jusqu’à un bosquet au bord de l’objectif Big Mountain », dit-il au major Campbell par radio, « et je voudrais savoir si le commandant de Kandak est d’accord, vu que l’indicatif d’appel ici ne peut pas communiquer avec lui. À vous. »
La réponse embrouillée arrive tout de suite. Aggus transmet le message à Shumps par le truchement de l’interprète. « Alors on va rester ici jusqu’à ce que l’autre compagnie soit dans le village et on pourra alors aller jusqu’à la limile des arbres. »
Dans le but de donner une leçon suite à la petite conversation, il ajoute : « Si la 2e Compagnie vous dit d’aller la rejoindre dans le village, vous devriez lui dire que ça ne fait pas partie du plan, et elle n’a pas le droit de vous dire ça, et que vous allez obéir aux ordres de votre commandant. »
Shumps regarde le sol, et puis le ciel, presque comme un petit garçon quand son père essayait de corriger sa façon d’agir : il écoute peut-être, mais il n’est pas très content. Quoi qu’il en soit, en fin de compte, Shumps a fait ce qu’il voulait et la patrouille au complet s’est avancée jusqu’aux arbres où tout le monde s’assoit pour faire une longue pause.
Détendus sur le sable, Aggus et McNabb écoutent la radio où les « tankers » du Lord Strathcona’s Horse grommellent à propos de leurs chars Leopard qui sont coincés et de trouver une issue au terrain du Panjwai compliqué au point qu’ils en ont des cauchemars. Il y a des rires compatissants d’Aggus et de McNabb à l’occasion.
En attendant, la seule friction, pratiquement, à Regay arrive d’une manière des plus nonchalantes, quand la patrouille s’est arrêtée dans l’ombre en attendant qu’on vienne la chercher. « Est-ce qu’on a le temps de bouffer? » L’adjudant demandait cela à son capitaine.
« Probablement », répondit Aggus.
Mais, que pourrait-il arriver d’autre, aussitôt que McNabb avait mis sa ration de pain de viande avec sauce dans le sac de cuisson, les véhicules se pointent à l’horizon, venant nous chercher à toute allure. « C’est pas croyable », gronde McNabb pour rire. « Vous avez dit qu’on avait le temps. »
« Ben, c’est la guerre, vous prenez vos risques », répondit Aggus en gloussant doucement, tout en regardant McNabb enfoncer son sac à ration qui fumait encore dans son sac à dos.
Toutefois, il n’a pas fallu longtemps à la malchance pour rattraper McNabb, et au milieu du chemin vers la route où les tankers du Strathcona arrivent, notre Nyala subit une sorte de crise épileptique sur le sable brulant du désert. Quoi que fit le chauffeur, le Nyala refusait d’avancer. L’équipage au complet descend et de l’extérieur, il semble que les freins sont coincés. Chaque fois que le chauffeur appuyait sur l’accélérateur, le Nyala sautait verticalement sur le sable, tout en crachant de la fumée noire comme un animal de l’âge du pétrole qui se meurt.
Aggus et McNabb ont passé une grande partie de l’après-midi à observer leur Nyala d’un air triste, appelant à l’aide de temps en temps, une aide qui a fini par arriver grâce à un véhicule de dépannage du Strathcona d’où sort un mécanicien de chars du Strathcona déjà harcelé qui, après avoir entendu les symptômes de la panne du Nyala, admet tout de suite qu’il ne peut ni réparer le véhicule ni nous remorquer.
McNabb secouait simplement la tête.
Le mécanicien de chars demande quand même à Aggus de démarrer le Nyala, rien que pour voir le problème.
Comme prévu, le Nyala démarre et s’avance presque comme s’il n’avait jamais été endommagé.
McNabb secouait simplement la tête.
En conclusion, on pense que le problème était causé par la chaleur, et nous avons tous hâte de rejoindre tout le monde pour faire le dernier exercice du jour, le tir réel de portée. Le major Campbell dit que « c’est toujours bien de savoir si les canons fonctionnent ».
Durant l’exercice sur cible, les armes lourdes de la compagnie de Shumps, des mitrailleuses de 12,7 mm et de 14,5 mm montées à l’arrière de camions Ford Ranger, ont des ratés et se bloquent au point où sur les quatre qui ont été apportées, il n’y en a qu’une qui tire et, on ne sait trop comment, elle manque complètement la montagne et les balles s’en vont vers le Pakistan. Les chars canadiens, quant à eux, lançaient des obus qui explosaient sur la montagne de façon impressionnante, faisant sauter des morceaux de pierre et donnant un spectacle de bruit et de puissance qu’on ne pouvait ignorer à des milles à la ronde.
À la fin du tir, le convoi au complet, qui avait alors plusieurs kilomètres de longueur et qui était plus large que jamais, s’élança en grondant autour de la montagne, en direction d’un emplacement près de Nakhonay.
* * *
La question qu’on se pose, bien sûr, c’est pourquoi il n’y a pas eu de présence de la coalition d’importance à Nakhonay et ses environs pendant si longtemps.
C’est difficile de comprendre comment permettre le développement d’un « bastion d’insurgés » à 10 kilomètres seulement d’une importante base canadienne pouvait être bon pour la stabilité du Kandahar. « Nous ne sommes pas encore allés nettoyer l’endroit, et le tenir, alors c’est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de nous pencher », dit le brigadier-général Guy Laroche, de retour au terrain d’aviation de Kandahar, peu de temps après l’Opération Ateesh Bazi.
Bien que certains officiers canadiens se plaisent à dire que le fait que l’ennemi ne combatte plus de front, qu’il ne s’engage plus dans des tactiques conventionnelles, est une indication du succès de l’OTAN, on se demande ce qui arriverait si un convoi canadien allait directement à Nakhonay. Il est fort probable qu’il y aurait un gros combat conventionnel, mais ce n’est pas couru d’avance. « Nous sommes allés là-bas pour voir si l’ennemi y était », dit Laroche. « Nous ne savons pas s’il y avait vraiment des méchants dans la région, et il n’y a pas eu d’engagement direct. »
En fin de compte, le facteur crucial, c’est la main-d’œuvre. Cela n’a pas été facile d’assembler les forces pour Ateesh Bazi; il a fallu la planifier pendant presque un mois. Pour atteindre les objectifs de base de la stratégie contrinsurrectionnelle rien que dans le district de Panjwai — nettoyer une région d’insurgés, la tenir et construire là-dessus — il faudrait évidemment d’autres troupes.
Même si les troupes ne sont pas habituellement en assez grand nombre, au moins pendant quelques semaines, en avril, on avait des raisons d’espérer, au terrain d’aviation de Kandahar, parce que les marines états-uniens étaient arrivés en grand et ils étaient armés et prêts à combattre.
La 24th Marine Expeditionary Unit est une force de combat autonome de presque 3 000 hommes de troupe et elle arrivait avec autant d’armes lourdes qu’il lui était possible d’apporter; difficile de ne pas avoir de pitié pour l’ennemi quand on observe les rangées à n’en plus finir de blindés, de chasseurs à réaction et d’hélicoptères d’attaque des marines.
De fait, il n’y a pas d’aura exactement comme celle d’un grand groupe de jeunes marines des États-Unis endurcis qui font le pied de grue tout autour du terrain d’aviation, en attendant que les commandants s’occupent de la paperasserie et les lancent au combat. (Cependant, lorsque vous lisez ceci, ils ont vraiment pris part aux combats, ayant été déployés à l’ouest où ils aident les Britanniques, dans la province de Helmand.)
Ces marines sont les seules personnes que j’ai jamais rencontrées, j’ai l’impression, pour qui mourir au combat serait une partie de plaisir. Ou, tout au moins, ce serait plus amusant que de patienter au terrain d’aviation de Kandahar pendant deux mois, ce qu’ils ont fait pour l’instant.
Il faut le dire, le terrain d’aviation n’est pas le meilleur endroit où passer sa vie. Tout le nécessaire s’y trouve, mais il ne s’agit pas d’une existence joyeuse, assez près du chez soi pour rappeler à quel point il manque mais pas assez près pour qu’on soit heureux.
Bien sûr, le bar à expresso où l’on peut boire du café à volonté apporte un peu de calme. Mais même comme ça, il faut être patient pour se tenir debout et appuyer sur le bouton à plusieurs reprises pour obtenir une tasse pleine, sans parler de la volonté de fer pour endurer les regards hostiles des soldats européens en manque de caféine qui attendent leur tour.
Mais même au terrain d’aviation, les hostilités, disons qu’elles font intrusion, dans le malaise climatisé. Même au terrain d’aviation, on ne peut le dire plus délicatement, on peut exploser à tout moment, car les roquettes tombent du ciel avec une régularité déconcertante. Et quand on sait qu’une roquette pourrait foncer sur soi à tout instant, la vie devient tout autre. C’est un changement subtil, un petit déclic dans le fond du cerveau. On passe, tout doucement, de la vie normale au simple espoir qu’on va survivre. Pour pouvoir l’endurer de cette façon-là, on dirait qu’il faut abandonner un tout petit peu, de s’abandonner au sort, ou au destin, ou inshallah, ou quelle que soit la manière qu’on veuille l’exprimer. Et même la crème glacée à volonté n’aide pas beaucoup en ce qui concerne cette réalité, surtout après sept, huit ou neuf mois de service, comme c’est le cas pour bien des membres du personnel du quartier général canadien.
Toutefois, le gros danger de mort ce n’est pas une roquette dans la tête, dit-on aux soldats canadiens à leur arrivée pour les rassurer, ce serait plutôt la sorte d’hémorragie artérielle qui arrive quand, disons, les jambes sont arrachées.
Résultat, la plupart des soldats ont un savoir-faire des plus impressionnant en ce qui concerne le garrot militaire à la fine pointe de la technologie qui sert à comprimer circulairement le membre. Bien que le garrot arrête l’hémorragie dans la plupart des cas, la probabilité de sauver le membre est loin d’être excellente. Et des fois, même le garrot ne suffit pas, ce qui veut dire qu’il ne reste qu’à essayer la solution du dernier ressort : le pansement Quick Clot. Il s’agit d’un produit chimique qu’on saupoudre sur la blessure comme si c’était de la litière pour chat et qui cautérise le tout si fort qu’il arrive régulièrement que la personne qui applique l’agent coagulant souffre de brulures, alors imaginez le pauvre sur qui il est appliqué. L’agent est si puissant qu’on ne peut l’utiliser que sur les membres car on sait qu’il rongerait des organes en entier.
Et ce ne sont là que les renseignements de la séance d’information à l’arrivée.
* * *
Pendant ce temps, près de Nakhonay, le deuxième jour de l’Opération Ateesh Bazi, le soleil commençait à poindre à l’horizon un peu après 5 h, et tout le monde se levait, personne n’ayant succombé durant la nuit aux vipères, aux scorpions ou aux talibans.
D’après le plan, il fallait conduire jusqu’à une position à peu près au centre de tous les villages et placer les chars d’assaut et les véhicules canadiens pour qu’ils puissent offrir un tir de couverture pendant que les Afghans et l’ÉLMP nettoyaient les villages une enceinte à la fois.
Lorsque le convoi arriva, au grand complet, au centre de la position de combat, il fallut réajuster le tout, alors pendant un certain temps, les gens dans les villages pouvaient voir ce déploiement effrayant de puissance de feu qui tournait en rond, littéralement, à travers leurs champs. « Maintenant, ils ne vont pas se battre avec nous, c’est sûr », dit McNabb. « Ils vont croire qu’on est tous des h—ties de fous. »
« Si on n’a pas de plan, c’est sûr que l’ennemi ne pourra pas deviner ce qu’on va faire », dit joyeusement un autre soldat.
« Planifiera bien qui planifiera le dernier », dit un autre.
Cependant, en fin de compte, tout est réglé et les ÉLMP s’assemblent pour leur dernière séance d’information. « Bon, s’il n’y a pas d’autre question, je vous souhaite à tous un tab—e de bon temps », dit le major Campbell aux ÉLMP assemblés. « Allez-y lentement et sûrement, c’est pas un h—ie de sprint, c’est un marathon : aujourd’hui, on avance pas plus de six ou sept kilomètres si on finit par atteindre tous les cal—ces d’objectifs. Et pour ceux qui n’ont pas encore engagé l’ennemi, rappelez-vous que c’est pour de vrai, alors vous n’avez pas l’occasion de recommencer; manquez pas votre h—ie de coup. Bon, allons-y. »
À la périphérie du premier village, Aggus arrête la patrouille pour dire à Shumps qu’il vient d’entendre un rapport à la radio que des insurgés sont en train de planter des dispositifs explosifs de circonstance (DEC) dans le village devant nous. Des hélicoptères vrombissent au-dessus de nos têtes.
Shumps ne réagit pas. Il demande à un villageois qui passe par là avec un âne s’il y a des méchants dans le village. Le villageois aurait dit que non. Shumps fait encore comme s’il allait chez le dépanneur. Il continue de jeter des coups d’œil aux alentours comme s’il allait prendre l’autobus. C’est un peu déroutant.
Aggus profite de cette courte pause pour essayer de convaincre Shumps qu’il faut qu’il soit assez loin devant pour pouvoir influencer la direction que les premiers éléments de la patrouille vont prendre dans le village.
Bien que Shumps finit par faire ce qu’Aggus lui conseille de faire, il appert que ce n’est pas vraiment suffisant. Le procédé de manœuvres des patrouilles à travers les villages, bien qu’ils n’étaient pas sorciers, étaient assez compliqués pour causer des problèmes.
Les deux compagnies de l’ANA devaient avancer en parallèle et en quinconce, une compagnie avançant d’abord, puis prenant position en attendant que l’autre la dépasse et prenne position aussi. De cette manière, elles auraient progressé par bonds à travers les trois villages.
Mais lorsque les deux compagnies de l’ANA sont entrées dans le premier village, Adamzai, elles commencent à se chevaucher, et elles essaiment pratiquement dans le village.
Au sol, quand on voyait les soldats de l’ANA aller dans toutes les directions en même temps, on savait bien que si l’ennemi se mettait à tirer, on n’aurait pu faire mieux que de se jeter par terre et essayer de tenir parce que les balles auraient certainement volé dans toutes les directions.
Il n’a pas fallu longtemps au major Campbell pour rejoindre Aggus et Shumps. « La géométrie du feu est complètement cal—cée », dit Campbell, et il indiqua qu’une compagnie allait devoir avancer pendant que l’autre resterait sur place.
L’opération s’est dénouée lentement, et les difficultés de navigation qui avaient causé le problème furent extrêmement pénibles à résoudre. Alors que les premiers éléments de la compagnie de Shumps n’étaient qu’à 50 mètres devant le groupe de commandement porteur de cartes, la distance était suffisante pour causer une confusion incessante.
À un moment donné, Shumps s’est fatigué des encombrements et il a décidé de mener la patrouille lui-même. Aggus le retint immédiatement.
Au fur et à mesure que l’opération allait de l’avant, tout le monde souffrait des problèmes de navigation incessants.
Un jeune soldat afghan qui avait passé la journée parmi les premiers éléments vint à côté d’Aggus après un autre renversement de direction et fit semblant de lui prendre la carte, comme pour se moquer. « Vous devriez parler à ce gars », dit McNabb à Shumps en rugissant.
« Il n’a pas d’éducation », répondit Shumps, dans un anglais très courant. « C’est un soldat fou. Tous les soldats sont fous. »
McNabb secouait simplement la tête.
Il dit que la patience est une chose clé qu’il a apprise en travaillant avec l’ANA. « Ils m’ont certainement appris à être patient », dit-il. « C’est une chose que j’aurais dû apprendre il y a 10 ans. »
Et il se tient sur ses gardes avec patience pour tout le monde, surtout pour Aggus, s’assurant que ce dernier soit assez hydraté et qu’il mange ses rations. Mais il le fait aussi pour Shumps qui, vers la fin de la journée, devient de plus en plus malade à cause de la chaleur, bien qu’il refuse constamment de se faire soigner.
Il est indubitable que la chaleur est l’ennemi le plus dur auquel se mesure la force de coalition durant Ateesh Bazi, mais il y a aussi d’autres difficultés militaires de base dont il faut tenir compte quand on veut relier les deux cultures de combattants. Les soldats afghans ne semblent pas s’intéresser à notre manière de faire la guerre, nos cartes, nos plans, nos tactiques. Ils ont leur propre système, beaucoup plus décontracté, qui semble s’asseoir sur l’instinct autant que sur la raison. Mais comme tout le monde le remarque, la culture afghane est pleine de guerre et les hommes sont des combattants extraordinaires, alors ce n’est pas facile à dire si leur façon de guerroyer est mauvaise ou incorrecte.
Cependant, il est évident que le fatalisme calme personnifié par les « inshallah » de Shumps a un mauvais côté.
Par exemple, un des soldats de la compagnie de Shumps a un fusil AK-47 embelli par des additions super comme un lance-grenade, un capiton de crosse et même une belle lunette, une amélioration rarement utile car le AK-47 est une arme notoirement inexacte à la distance où une lunette serait nécessaire. De toute façon, comme le dit un des Canadiens, la lunette ne devrait pas être montée sur ce fusil et le capiton est bancal, alors toute l’installation de fortune a l’air remarquable mais « on manquerait son coup à bout portant ».
Mais pour l’Afghan qui porte l’arme, s’il atteint la cible ou non dépend probablement davantage de la volonté de Dieu que de quelque question technique comme une lunette bien précise. Malgré cela, ce n’est pas la compétence tactique afghane dont Aggus se soucie le plus. En fait, comme il le dit lui-même, la chose la plus importante à propos de laquelle il travaille avec Shumps et la compagnie n’est pas le combat mais la persistance et la logistique.
Mais même là-dessus, il n’y a pas de doute que le penchant qu’ont les soldats afghans de laisser les choses de base au hasard les opprime. Par exemple, Shumps et sa compagnie savaient que leur générateur d’électricité allait tomber en panne, mais ils n’ont pas remis la paperasserie au quartier général de leur bataillon pour qu’on le leur répare ou pour le faire remplacer malgré les exhortations répétées de leurs mentors. Alors il est tombé en panne et ils ont passé une semaine sans électricité, en se plaignant aux Canadiens sans arrêt.
McNabb dit qu’il s’agit d’apprendre à la dure école. Et même si c’est une manière difficile d’apprendre, comme il le fait remarquer, c’est comme ça à propos de tout ce qu’ils font, même l’entretien des armes, ce qui est évidemment quelque chose dont on devrait se soucier si on tient compte du tir des armes lourdes des Afghans la veille. « On leur dit de nettoyer les armes. On donne l’exemple », dit McNabb. « Mais je vais certainement pas les nettoyer pour eux, leurs h-oties d’armes. »
Ça risque d’être une école vraiment dure.
De toute façon, à la fin d’une longue journée de patrouilles sans voir d’ennemi, le convoi se prépare à repartir et McNabb passe la consigne à Shumps : « Quand on avance, vous nous suivez. »
« Inshallah » : telle est la réponse de Shumps.
McNabb secoue la tête, un sourire résigné aux lèvres. « J’adore ça », dit-il. « C’est comme quand je dis à ma fille de 16 ans de faire quelque chose et qu’elle me répond “comme tu veux” ». Au bout d’un certain temps, tout le monde est prêt à partir, mais lorsque le convoi quitte Nakhonay vers le nord, une explosion a un effet de vague le long des blindés canadiens. Un véhicule canadien de devant a sauté. C’est un autre VAL et, ce qui est étrange, c’est le quatrième véhicule de la file, derrière deux chars avec des rouleaux de déminage et un char avec une lame qui racle la route.
Personne ne peut nous dire comment ce DEC a pu survivre au passage des démineurs, mais en général on semble croire qu’il a été détonné par un taliban qui se trouve dans le coin. Il y a eu des blessés, mais rien de très grave, bien qu’il faille si longtemps à l’opération de récupération que la nuit tombe et le convoi au complet doit passer par un chemin très fastidieux pour le retour au bercail en se servant d’équipement d’imagerie thermique.
La friction ne se fait pas attendre. Les heures passent pendant que le convoi vire d’un côté, puis de l’autre, dans la noirceur, essayant de rester loin de la route et du risque de DEC, mais devenant de plus en plus coincé. Ça n’en finit plus dans le noir. Quatre, cinq, six heures. On n’arrivait pas à trouver un chemin et on piétinait. Au loin, on remarque des mouvements ennemis. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que McNabb était là, dans le noir, en train de secouer la tête.
Il est sûr qu’une mission d’ÉLMP n’a rien de facile. Ce sont des gens qui s’occupent d’instruction de base dans une zone de tir réel et, en fait, sans avoir l’autorité de diriger l’instruction. Malgré cela, Aggus insiste beaucoup que le système des ÉLMP est un bon système et qu’il va finir par fonctionner. De fait, Ateesh Bazi a été une réussite. L’opération était compliquée et dure à souhait mais sa raison d’être, l’obtention de renseignements sur la possibilité d’une présence ennemie à Nakhonay, a été complétée.
Tout au moins, personne ne pourra jamais douter de la bravoure d’hommes comme Aggus, McNabb et Campbell, qui, quelque part au-delà des lignes du front, risquent tout pour aider l’armée afghane à s’améliorer.
Notre VAL repart et nous entendons un drôle de rapport. « Je ne pense pas que le système d’armes fonctionne », dit le commandant du VAL à l’interphone.
« Pourquoi? » demande la sentinelle aérienne arrière du VAL.
« Parce qu’il indique qu’on va vers le sud-ouest. »
« C’est bien vers le sud-ouest qu’on va » répond le soldat.
C’était là un problème car, le sud-ouest, c’était la direction d’où nous venions.
La consigne inévitable nous parvint alors à la radio : si on n’arrive pas à sortir d’ici au prochain coup, il va falloir former un périmètre défensif ici pour la nuit. Il y a un gémissement général, sauf chez les gars du quartier général, qui passent une grande partie de leur temps au terrain d’aviation et qui seraient contents de l’aventure d’une nuit dans le territoire des méchants.
Ensuite, quelqu’un dit à la radio qu’il vaudrait mieux abandonner le système d’imagerie thermique. C’est logique car on pouvait nous entendre et voir l’ANA, qui n’avait pas de système d’imagerie thermique et allumait ses lampes, à 10 kilomètres à la ronde. Alors la consigne fut donnée et le convoi alluma ses lampes blanches.
Quelques secondes après, un rire doux et perplexe bruit à l’interphone. « C’est un h—stie d’embouteillage géant », dit la sentinelle arrière.
Tout le monde était désorienté dans la noirceur et, quand les lampes furent allumées, on voyait une étrange image : tout le convoi était égrené et mélangé, des lampes dirigées de tous côtés; difficile à dire s’il y en avait deux qui pointaient du même côté. Tout le monde, semblait-il, avait une idée différente à propos de comment nous tirer du pas où nous nous trouvions.