LA GUERRE A FAÇONNÉ LE CANADA. Cette petite phrase ne vient pas souvent à l’esprit des Canadiens, habitués à vivre dans un royaume pacifique, mais elle est certainement vraie. L’avenir de l’Amérique du Nord britannique fut décidé dans les plaines d’Abraham en 1759 et confirmé pendant la guerre de 1812, où le Canada survécut tout juste à l’invasion américaine. Deux grandes guerres mondiales ont montré que le Canada ne plierait devant rien pour vaincre les desseins expansionnistes des kaisers et des dictateurs de l’Axe. Des Canadiens et Canadiennes ont été déployés au combat contre les islamistes qui menaçaient, et menacent encore, les démocraties. Le Canada n’était pas une grande puissance, mais ses militaires, au cours du siècle passé, ont joué un rôle important aux côtés de leurs alliés.

LE CANADA ALLAIT-IL ÊTRE COLONIE FRANÇAISE OU BRITANNIQUE? La guerre de Sept Ans (1756-1763) régla la question, et la bataille déterminante fut livrée à Québec le 13 septembre 1759. Cet affrontement opposa le général James Wolfe, qui commandait des troupes régulières britanniques au marquis de Montcalm, qui avait des forces plus nombreuses mais mixtes de réguliers, de guerriers des Premières Nations et de miliciens. Les préparatifs de l’engagement décisif furent longs; la bataille devait être brève.
James Wolfe, né en 1727, était officier de l’armée depuis 1741, et il avait servi sur le continent, en Écosse et à la prise de Louisbourg en 1758 où, en tant que brigadier, il s’était distingué. Il fut promu major-général et on lui confia le commandement des forces terrestres de l’expédition de Québec le 12 janvier 1759. Son commandement englobait 10 bataillons d’infanterie formés de quelque 8 500 soldats réguliers. L’expédition avait le soutien de 49 navires, dont 22 de 50 canons ou plus.
Wolfe avait des problèmes d’estomac et des rhumatismes, et bien que très compétent, il avait du mal à gérer ses subordonnés.
À son arrivée au large de Québec, le 27 juin, Wolfe prévoyait accoster à l’est de la ville, sur la rive nord du Saint-Laurent, mais prévoyant cette manœuvre, Montcalm avait fortifié la rive. Le commandant britannique, sûr de gagner s’il pouvait obliger Montcalm à accepter le combat, se trouva donc forcé de revoir ses plans. S’il ne pouvait pas obliger les Français à se battre, l’hiver le contraindrait à se replier sur Louisbourg jusqu’à la fin du printemps de 1760.
Que faire? Wolfe modifiait ses plans sans arrêt, sa mauvaise santé empirant les choses. Il plaça ses canons en face de Québec et bombarda la ville; il lança une attaque juste à l’ouest de la rivière Montmorency le 31 juillet et subit de lourdes pertes; il donna l’ordre d’incendier les habitations à l’est et à l’ouest de Québec. Finalement, ne sachant comment procéder, il écrivit à ses trois brigadiers pour leur demander de « penser à la meilleure façon d’attaquer l’ennemi ». Ils lui suggérèrent d’envoyer l’armée en amont de la ville, sur la rive nord. Ils dirent que, si les voies de communication vers Montréal et l’intérieur de la Nouvelle-France étaient bloquées, « le général français devrait se battre selon [leurs] propres conditions ». Wolfe accepta et, le 8 ou le 9 septembre, il fit faire une reconnaissance vers l’aval et décida de tenter un débarquement à l’Anse-au-Foulon, où une piste montait la falaise.
Le 13 septembre à 4 h, plusieurs compagnies d’infanterie légère grimpèrent la falaise et mirent en déroute la petite force qui se trouvait là. Au matin, les réguliers de Wolfe s’alignaient dans les plaines d’Abraham et Montcalm, attendant peut-être des renforts de l’ouest, décida quand même de se battre. Il forma ses colonnes et lança ses hommes à l’assaut des lignes britanniques à 10 h. Wolfe laissa les Français s’approcher à moins de 80 coudées et deux salves les décimèrent. Montcalm fut blessé pendant le premier quart d’heure de la bataille et fut transporté à Québec où il mourut. Wolfe, atteint trois fois, mourut dans les plaines. Le reste de la force française partit vers l’ouest peu après en contournant les Britanniques. La ville de Québec se rendit le 18 septembre.
La conquête de la Nouvelle-France n’était pas encore achevée. La Marine royale devait quitter le Saint-Laurent peu après la victoire, et la garnison britannique, où le scorbut faisait rage, avait peine à survivre. À la fin du mois d’avril 1760, les Français attaquèrent et remportèrent une importante bataille à Sainte-Foy, à l’ouest de Québec, mais les Britanniques se replièrent à l’intérieur des murs de la ville. Le succès éventuel dépendait alors de l’arrivée des navires ravitailleurs : s’ils étaient français, la Nouvelle-France pourrait survivre; s’ils étaient britanniques, la colonie était condamnée. La Royal Navy arriva à la mi-mai, et la conquête fut effectivement totale. Montréal capitula en septembre, et le traité de Paris de 1763 donna la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.
Le fait français demeurait au Canada, mais l’avenir de la colonie était entre les mains de Londres. Wolfe n’avait pas été un grand capitaine, mais il avait gagné la bataille décisive. Le sort d’empires, la destinée du Canada, avaient dépendu d’un sentier montant une falaise dans une anse qu’on surnomme maintenant Wolfe’s Cove.

LA GUERRE DE 1812 MIT EN PÉRIL L’EXISTENCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE. Les Canadas pourraient-ils survivre à l’assaut des États-Unis numériquement supérieurs et plus riches? Pour ce faire, il faudrait un commandant aguerri. Heureusement, au début de la guerre en juin 1812, les forces britanniques en avaient un : le major-général Isaac Brock.
Ce dernier avait une tâche colossale à accomplir pour défendre le Haut-Canada. La loyauté d’un grand nombre des colons arrivés des États-Unis au cours des 30 dernières années était naturellement suspecte, et ils étaient au moins quatre fois plus nombreux que les colons loyalistes. L’organe législatif, peu coopératif, refusait de dresser des plans sérieux pour la guerre. Le nombre de soldats britanniques réguliers n’était que de 1 600. En outre, pour s’assurer la loyauté des Premières Nations, il fallait leur montrer que les défenseurs britanniques aient une chance crédible de victoire. Brock savait qu’il devait frapper le premier.
Tout de suite après avoir appris que la guerre avait commencé, et après une petite indécision qui ne lui ressemblait pas, Brock donna l’ordre au capitaine Charles Roberts du Fort St. Joseph, situé à la tête du lac Huron, de s’emparer de Michillimakinac. Roberts déplaça 600 hommes, des autochtones, quelques soldats et un petit nombre de commerçants de fourrures, sur 80 kilomètres jusqu’à Michillimakinac, dit au commandant américain surpris que la guerre avait été déclarée, et accepta sa reddition le 18 juillet. Cette petite victoire mit les Premières Nations du secteur supérieur des Grands Lacs du côté des Britanniques.
Cependant, tout n’était pas encore dit. Le 12 juillet, le brigadier-général William Hull quitta Détroit à la tête de forces américaines et entra au Canada. Le long de la frontière, les miliciens désertaient pour se joindre aux Américains ou s’enfuyaient. Brock était découragé, et il s’inquiétait que le moral du public défaillît, que tout le monde eût peur que le Haut-Canada soit condamné. Mais les troupes britanniques tenaient encore Fort Amherstburg, alors Brock rassembla réguliers, Autochtones et miliciens et s’y rendit le 13 aout. Il s’aperçut que Hull, commandant pompeux et faible, était déjà reparti à Détroit avec ses 2 000 hommes. Brock disait que l’« état de la province [du Haut-Canada] n’exigeait rien de moins que des mesures désespérées ». La Marine provinciale avait capturé un navire américain où se trouvait la correspondance entre le général Hull et le secrétaire de la Guerre à Washington. Il était clair, dit Brock, que la « confiance accordée au [général Hull] n’était plus, et il est évident que le découragement règne partout ».
Cette intuition poussa Brock à prendre la décision d’attaquer Détroit. Le 16 aout, il fit traverser la rivière Détroit à ses 1 300 hommes, dont 600 membres des Premières Nations commandés par Tecumseh, chef shawnee, et 400 miliciens, et invita Hull à se rendre. Le danger que les Premières Nations échappent « à tout contrôle au moment où commenceraient les hostilités », comme l’écrivit Brock à Hull, fut suffisant et le général américain déposa les armes, livrant hommes, provisions, 35 canons et autre matériel de guerre.
L’effet du bluff et de l’audace de Brock sur la population du Haut-Canada fut vite évident. Il écrivit à sa famille que « la milice a été inspirée par notre récent succès; les mécontents ont été réduits au silence ». Personne ne pensait plus que la défaite britannique était inévitable.
La guerre était cependant loin d’être terminée, et Brock lui-même fut tué lors de la première grande bataille sur la péninsule du Niagara, à la victoire de Queenston Heights en octobre 1812. Les défenseurs des Canadas ne seraient pas toujours aussi bien dirigés qu’ils l’avaient été par Brock, mais la fin de l’impasse de deux ans de guerre fit que les Canadas, rien qu’en survivant, avaient remporté une grande victoire. Ils étaient restés britanniques, et l’expansionnisme américain avait été bloqué. Brock est encore vu comme le héros de la guerre, le chef capable et charismatique qui comprenait l’impact des victoires sur l’opinion publique, même les plus petites.

CENT ANS APRÈS, LE DOMINION DU CANADA ÉTAIT À NOUVEAU EN GUERRE. Sa relation avec les États-Unis s’était améliorée depuis des dizaines d’années, malgré les craintes de guerre occasionnelles. Les Canadiens avaient combattu les Boers en Afrique du Sud au début du siècle, mais la population n’était pas du tout prête à un conflit outre-mer.
La Grande-Guerre commença pour le Canada le jour où la Grande-Bretagne déclara la guerre à l’Allemagne du Kaiser, le Canada étant alors une colonie britannique. Les hommes répondirent à l’appel diligemment, et ils continuèrent de le faire jusqu’à ce que le nombre des victimes dépasse celui des volontaires, à la fin de 1916. Les soldats canadiens qui partirent en guerre, surtout de récents immigrants britanniques, apprirent sur le tas. Ils tinrent bon à la première attaque au gaz majeure, à Ypres, en avril 1915. Ils se battirent à la Somme en 1916, ils prirent la crête de Vimy auparavant imprenable en avril 1917, et ils avancèrent avec obstination à travers les horreurs de Passchendaele dans le froid de l’automne de 1917. Les batailles les plus importantes, celles des cent jours entre le 8 aout 1918 et l’armistice, les attendaient encore.
En aout 1918, les Canadiens menèrent une attaque de grande envergure à Amiens, s’avançant de jusqu’à 15 kilomètres le premier jour. Alors commandé par des Canadiens, et la moitié de ses effectifs étant nés au Canada, le Corps canadien avait une réputation bien méritée de corps d’élite, et le lieutenant-général sir Arthur Currie, son commandant, avait gagné l’admiration du grand état-major britannique. Malheureusement, ses propres soldats ne l’aimaient pas.
Après Amiens, les quatre divisions canadiennes partirent à Arras, au nord. Les effectifs étaient au complet et, grâce à Currie, ils avaient plus d’ingénieurs, de camions, de canons et de fantassins que les corps d’armée britannique. Le Corps canadien fit une brèche dans la ligne Drocourt-Quéant à l’issue de luttes couteuses, obligea les Allemands à se replier et prit la voie de l’ouest vers le Canal du Nord inachevé. Sa tâche, la plus importante de la guerre, était de le traverser.
Mais comment? Les berges étaient élevées, le canal était large et le côté allemand bien fortifié. Les postes de mitrailleuses ennemies sur la berge étaient nombreux, il y avait des lignes successives de tranchées à l’arrière, ainsi que les canons et le gaz. Currie fit sa reconnaissance lui-même, comme il le faisait toujours, et décida que le meilleur endroit pour attaquer était le tronçon inachevé de 3 600 mètres. Il lui fallait l’élément de surprise pour réussir, et parvenir à envoyer 50 000 hommes à travers une petite brèche et les déployer sur un front de 15 à 20 kilomètres. Il lui faudrait construire rapidement des ponts pouvant supporter ses chars et ses camions, une bonne communication et assez de munitions, de fil de fer et de nourriture pour soutenir ses soldats lorsque l’ennemi contre-attaquerait. Le plan que produisirent les officiers d’état-major, presque tous canadiens, était complexe, mais bien conçu.
Les supérieurs britanniques de Currie doutaient qu’il réussisse à mettre en œuvre un plan si audacieux. Son ami le général sir Julian Byng lui demanda s’il pensait pouvoir le faire. « Oui, répondit Currie. S’il y a moyen de le faire, les Canadiens peuvent le faire. » Byng enchaina, « mais si tu échoues, on te renvoie chez toi. »
Les canons canadiens ouvrirent le feu le 27 septembre à l’aube, et les fantassins des 1re et 4e divisions s’avancèrent. Les ingénieurs canadiens fournirent rapidement des ponts pour l’infanterie et des rampes pour les canons et les véhicules. La 4e Division fut l’objet d’un feu d’enfilade, mais elle atteignit quand même son objectif, le bois de Bourlon. La Première Division, se dirigeant vers la gauche, prit le contrôle des villages le long du canal. Le front était alors d’environ 15 kilomètres, et une division britannique traversa le canal. L’ennemi envoya des renforts à la hâte, et les combats se poursuivirent jusqu’au 1er octobre, quand Currie annula l’avancée. Le chemin de Cambrai, route principale et voie ferrée servant au transport du matériel allemand dans le nord de la France, était alors leur point de mire.
À ce moment-là, les Canadiens de Currie étaient au milieu de ce qu’on appelle depuis les Cent jours du Canada. Ils allaient pulvériser les positions allemandes au front occidental et écraser un quart des divisions ennemies sur le terrain. Entre le 8 aout et le 11 novembre, jour de la capture de Mons, en Belgique, les quatre divisions de Currie jouèrent le rôle le plus important jamais joué par des soldats canadiens. Le prix fut terrible – 45 000 morts, blessés et prisonniers, c’est-à-dire 20 p. 100 du total des pertes canadiennes à la guerre de 1914-1918 –, mais les gains de territoire et les coups portés à l’ennemi étaient réels et extrêmement importants. L’objectif des Allemands, contrôler l’Europe, avait été bloqué par les Alliés, et le Corps canadien avait joué un rôle disproportionné par rapport à son effectif.

Le Corps canadien avait montré que les civils inexpérimentés de 1914, devenus fiers Canadiens grâce au succès sur les champs de bataille, étaient devenus les soldats qualifiés, techniquement compétents et déterminés des Cent jours. Ils avaient aussi montré qu’ils pouvaient apprendre à se battre sur le tas, bâtir une excellente réputation et se forger une renommée. Et sir Arthur Currie était devenu le plus grand soldat canadien, un commandant à l’imagination fertile qui s’occupait bien de ses hommes et qui faisait partie des tout meilleurs de la Première Guerre mondiale.
LES LEÇONS DE LA GRANDE GUERRE FURENT MALHEUREUSEMENT VITE OUBLIÉES AU CANADA. Les gouvernements laissèrent les forces armées s’amoindrir presque au point de disparaitre, les armes devinrent vite obsolètes et une fois de plus, le Canada allait partir en guerre sans y être préparé.
Le Canada entra en guerre le 10 septembre 1939, non plus en tant que colonie comme en 1914, mais en tant que dominion qui avait le contrôle de sa politique inté-rieure et étrangère. Le Canada décida tout de même
de suivre la Grande-Bretagne dans la guerre contre l’Allemagne hitlérienne. Pendant que la guerre faisait rage, pendant que la Grande-Bretagne subissait une défaite après l’autre, l’effort principal du Canada était de lever une Première armée canadienne de cinq divisions et deux brigades blindées pour la Grande-Bretagne. Une division fut envoyée se battre en Italie en 1943, puis une deuxième. Les trois autres divisions traversèrent la Manche en juin et juillet 1944 où elles prirent part aux féroces combats en Normandie et, en aout, au « breakout ». La Première Armée canadienne accomplit une partie importante des efforts des alliés contre les nazis.
À la fin de septembre, le deuxième Corps de l’Armée canadienne était en Belgique où il se préparait à sa principale lutte de la guerre. Le lieutenant-général Guy Simonds, commandant du corps, remplaçait temporairement le général Harry Crerar, qui avait de graves problèmes d’estomac, en tant que commandant de l’Armée. Il avait pour tâche de nettoyer l’estuaire de l’Escaut que le maréchal Bernard Montgomery, commandant du 21e Groupe d’armées, avait oublié, on ne sait comment, afin que les provisions indispensables puissent atteindre le grand port d’Anvers, capturé intact par les alliés, mais à 80 kilomètres à l’intérieur des terres.
Les Allemands avaient été nettement battus en Normandie, mais ils avaient récupéré à une vitesse incroyable, et ils étaient en train de fortifier la péninsule du Beveland-Sud et l’ile de Walcheren. Les en déloger serait pour les Canadiens la tâche la plus difficile de la Seconde Guerre mondiale. Le temps était misérable, froid, humide. Le champ de bataille était en grande partie au-dessous du niveau de la mer, et seules les digues permettaient de se déplacer sans trop de difficultés; ces digues, étant bien entendu, exposées au feu de l’ennemi.
Simonds se replia dans sa roulotte, réfléchit au problème et établit son plan. La 3e Division d’infanterie canadienne, renforcée par la 4e blindée canadienne et la 52e Division britannique, nettoierait la rive sud de l’Escaut qu’on appelait la poche de Breskens. Pendant ce temps, la 2e Division canadienne libèrerait le Beveland-Sud. Pour terminer, Walcheren, d’où l’on contrôlait l’entrée de l’estuaire de l’Escaut, serait attaquée par la route sur digue menant au Beveland-Sud. Le concept était simple, et Simonds devait persuader le Bomber Command de l’Aviation royale d’attaquer les digues qui tenaient la mer à l’écart du sol fertile de Walcheren. Il présenta son point de vue brillamment aux maréchaux de l’air, et son argument l’emporta.
Les combats furent féroces. Dans la poche de Breskens, les Allemands étaient très compétents et bien approvisionnés, et il fallut des lance-flammes, un feu d’artillerie implacable et beaucoup de courage pour les chasser de leurs tranchées d’où ils défendaient les nombreux canaux. Les Canadiens utilisèrent leurs blindés, leurs Buffalo sur chenilles, leurs véhicules de transport de personnel et leurs mortiers pour l’emporter. Il lui fallut tout le mois d’octobre et une partie du mois de novembre, mais la Première Armée canadienne finit par contrôler la rive sud de l’Escaut.
Les choses n’étaient pas plus faciles au Beveland-Sud, où la 2e Division traversait les polders inondés avec beaucoup de difficulté et se battait avec les parachu-tistes allemands fanatiques. Le Black Watch fut mis en pièces le 13 octobre, et le Royal Hamilton Light Infantry, trois jours après. Ce n’est que le 24 octobre que l’isthme fut coupé et que le Beveland fut finalement libéré. C’était alors le tour de Walcheren.
Le bombardement des digues effectué par l’AR commença le 3 octobre et l’ile fut rapidement inondée, isolant l’ennemi. Les commandos et soldats britanniques sous les ordres de Simonds attaquèrent par la mer et la résistance cessa le 8 novembre. Pour détourner l’attention de l’attaque amphibie, les Canadiens avaient été obligés de poursuivre leur attaque sur la route sur digue fortement défendue qui reliait Beveland à Walcheren. Les assauts répétés décimèrent un bataillon après l’autre, mais les combats durèrent jusqu’au
8 novembre. En tout, 6 367 Canadiens, et autant de Britanniques, perdirent la vie, furent blessés ou capturés pour reprendre le contrôle de l’Escaut. Mais les approvisionnements pouvaient dorénavant se rendre à Anvers, et la défaite de l’Allemagne nazie était désormais inévitable.
Les batailles de l’Escaut avaient eu leur importance. Le deuxième Corps canadien qui s’y était battu se composait entièrement de volontaires; un million d’hommes et femmes s’étaient portés volontaires pour combattre l’axe à la Seconde Guerre mondiale, prouvant que les Canadiens comprenaient le danger du régime monstrueux d’Hitler pour leur démocratie. L’armée, mal formée, mal équipée et mal dirigée en septembre 1939, était devenue la meilleure petite armée au monde, capable de battre les SS et la Wehrmacht. Et le général Simonds, le seul commandant supérieur canadien en qui les Britanniques et les Américains avaient entièrement confiance, avait montré qu’il pouvait planifier et mener une grande opération militaire cruciale, et faire en sorte que ses Canadiens en sortent victorieux. Tout comme à la Grande Guerre, les Canadiens savaient alors qu’ils pouvaient accomplir les travaux les plus exigeants.

LES MILITAIRES CANADIENS N’AVAIENT PAS PRIS LES ARMES DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE DE CORÉE, EN 1953. Ils avaient été pris pour cibles lors de plusieurs missions de « maintien de la paix » et avaient subi des pertes, mais la guerre? Les combats contre une force ennemie? Cela n’était pas arrivé jusqu’en 2006, en Afghanistan.
Le Canada a participé de plusieurs manières à la guerre d’Afghanistan qui a débuté après l’attaque d’Al-Qaïda le 11 septembre 2001 à New York et Washington, et ce, jusqu’au retrait en 2012. Ce qui est sûr, c’est que plus de Canadiens ont servi en Afghanistan qu’en Corée, une guerre fort différente, où le nombre de victimes avait été beaucoup plus important.
Le Canada répondit vite au 11 septembre, envoyant en Afghanistan et dans ses environs des navires, des avions et des soldats des Forces spéciales, et au début de 2002, un bataillon de fantassins. Les Américains et les forces alliées firent prendre la fuite à Al-Qaïda rapidement, mais les militants islamistes, les talibans, se reformèrent peu après. Le Canada poursuivit le rôle majeur qu’il avait dans la Force internationale d’assistance à la sécurité de l’OTAN à Kaboul. En 2006, on se concentrait surtout sur Kandahar, lieu de naissance des talibans, et sur la création d’une équipe provinciale de reconstruction (ÉPR) qui devait faire avancer la réforme, bâtir des institutions pendant que les soldats se battaient contre les islamistes. Pour protéger l’ÉPR, le Canada envoya un groupement tactique du 1er Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. On pensait que les militants talibans, dont le nombre, pensait-on, s’élevait à 200, pouvaient au pire enfouir des bombes le long des routes.
Ce n’était pas du tout le cas. En juillet, il y avait au Kandahar des milliers de talibans empressés de se mesurer aux Canadiens, et le PPCLI dut faire face à une force bien équipée qui se déplaçait rapidement. Les Canadiens, dotés de VBL III, établirent vite des bases d’opérations avancées, « vivant parmi les gens du pays, […] dans leur VBL ». Cela signifiait que leur réaction était plus rapide, mais l’approvisionnement des soldats qui se battaient en sous-unités plus difficile. Le premier combat important du PPCLI eut lieu en mai, au village de Pashmul, où fut tuée la capitaine Nichola Goddard, observatrice avancée d’artillerie. C’était la première militaire canadienne jamais tuée au combat.
Deux mois après, le PPCLI prit part à une grande bataille dans la région de Panjwaye où une importante force de talibans engagea le combat. C’était une erreur pour l’ennemi, car les Canadiens lui infligèrent de lourdes pertes. Les talibans commirent la même erreur en aout, quand le PPCLI se préparait à quitter le théâtre et que le 1er Bataillon du Royal Canadian Regiment prenait sa place. Les islamistes subirent des centaines de pertes, mais ils réussirent à tuer quatre Canadiens et à en blesser onze. L’assaut de Pashmul qui avait menacé Kandahar avait été défait à un coût très élevé pour l’ennemi.
Les combats se poursuivirent. Le groupement tactique du RCR fit face peu après à une attaque de grande envergure au Panjwaye, laquelle fut déchiquetée par les avions et l’artillerie et, selon un officier, « des combats désespérés et improvisés âprement livrés ». Des attaques semblables mais plus modestes continuèrent jusqu’à ce que les dernières unités de combat canadiennes reviennent au pays, à la fin de 2011. Une mission de formation resta en Afghanistan jusqu’en 2014.
Si l’objectif avait été de protéger Kandahar, on pourrait dire que le rôle canadien en Afghanistan fut une réussite. Mais si le but était de permettre aux villageois afghans de vivre leur vie à l’abri des talibans, il faut bien dire que la guerre fut pour le moins un échec partiel. Les talibans n’ont pas disparu, les efforts de l’ÉPR ont été restreints, et la paix et la sécurité sont encore du domaine du rêve.
Mais le général Rick Hillier, chef d’état-major de la défense pendant cette période des plus cruciales, avait eu un autre objectif. Il avait servi en ancienne Yougoslavie et avait été consterné des règles qui bridaient les Canadiens là-bas, règles tellement strictes que les militaires des autres nations modifièrent le terme « Canbat », en « Can’tbat » (« can » voulant dire « pouvoir » et « can’t » voulant dire « ne pas pouvoir », NDT). Cela l’avait piqué au vif, et il se promit de rendre ses soldats aptes au combat à nouveau. Le gouvernement libéral de Paul Martin et le gouvernement conservateur de Stephen Harper lui donnèrent les fonds et le matériel, et les réguliers canadiens, leurs rangs renforcés par des réservistes jusque-là méprisés, firent leurs preuves au champ de bataille.
Le public canadien n’était pas très favorable à la guerre en Afghanistan, mais il appuyait avec ferveur les soldats. Il y avait les « vendredis en rouge » où les civils portaient des vêtements rouges pour montrer leur soutien, des autocollants pour pare-chocs et des épinglettes. Et, plus émouvant encore, chaque fois qu’un des 158 soldats canadiens tués en Afghanistan arrivait à Trenton, le cortège vers Toronto était accueilli par des milliers de personnes longeant les ponts de l’autoroute 401, laquelle a été rebaptisée Autoroute des héros. Hillier avait réussi à modifier l’image de soldats du maintien de la paix en celle de soldats combattants, au moins temporairement.
L’Afghanistan, comme les plaines d’Abraham, la guerre de 1812 et les deux guerres mondiales, a façonné le Canada à sa manière. La population canadienne n’a jamais eu un esprit militariste, mais ses soldats étaient qualifiés et féroces au combat, une fois bien entrainés et bien équipés. Cela a toujours pris du temps et de l’argent, mais heureusement, le Canada avait des alliés et, le plus souvent, le temps de se préparer. Toutefois, cela ne sera peut-être pas toujours le cas, et les Canadiens, chanceux de vivre dans un pays paisible, devraient à tout le moins penser aux pires des scénarios auxquels ils ont souvent échappé. Le temps ne sera peut-être pas toujours de leur côté.


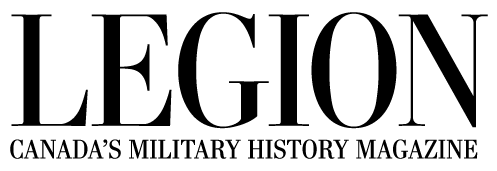







Comments are closed.