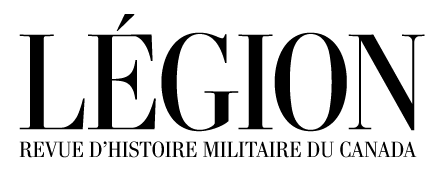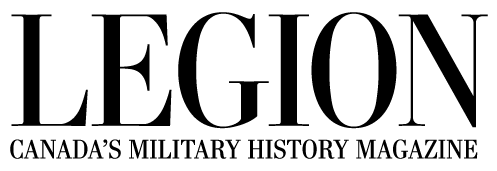![Près de Zangabad, en 2008, une patrouille canadienne n’ose pas s’aventurer en territoire ennemi. [PHOTO : ADAM DAY] Près de Zangabad, en 2008, une patrouille canadienne n’ose pas s’aventurer en territoire ennemi. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2011/09/AfghanLead1.jpg)
Le point de vue d’un journaliste sur la mission de combat canadienne au Kandahar, 2006-2011
En 2008, lors d’un après-midi fiévreux en Afghanistan, je pense avoir compris la guerre.
Mes souvenirs de Zangabad ne sont qu’un enchainement de moments confus et de contrariétés. Ce jour-là, en avril, le village presque désert n’était qu’un labyrinthe de murs en boue fauves, quelques fermiers louches et des EEI désastreux.
J’accompagnais une patrouille de fantassins. Ils avaient pour mission d’assurer la sécurité lors de la construction d’une nouvelle route passant par Haji et Zangabad jusqu’à Mushan.
La route devait apporter la paix et la prospérité au Panjwaii occidental, la partie la plus hostile du district le plus hostile du Kandahar, si ce n’est du pays.
Leur mission ne se passait pas très bien. La route était constamment piquetée d’EEI. Les Canadiens et les Afghans mouraient et le projet en entier était compromis.
Cette patrouille-là ne se passait pas très bien non plus. Elle avait pour but de recueillir des renseignements sur les activités des insurgés et de cibler de nouveaux projets à réaliser afin de commencer la reconstruction de la communauté. Mais il y avait un hic. Les gens de la place refusaient de parler. Chaque fois que le commandant de la patrouille — un capitaine — et l’agent de relations civiles-militaires essayaient d’engager la conversation avec eux, ils recevaient un déni.
Les villageois avaient peur. Ils refusaient de coopérer avec les Canadiens parce qu’ils avaient peur des talibans. Et les Canadiens ne pouvaient pas les protéger s’ils ne collaboraient pas en fournissant des renseignements.
C’était l’énigme classique. Et il fallait la résoudre pour que les Afghans locaux puissent penser à soutenir le gouvernement central de Kaboul, ce qui devait arriver afin que l’Afghanistan puisse se débarrasser de son statut d’État en déroute, et ce qui devait arriver afin que le Canada et d’autres pays n’aient plus à s’inquiéter du terrorisme exporté d’Afghanistan.
Le travail, qui semblait presque impossible, s’est révélé encore plus difficile.
La patrouille se trouvait au bord du village, près d’une école bombardée. En quelques minutes, plus un son n’en provenait. Un bavardage fut entonné à la radio : les insurgés avaient tendu une embuscade en avant.
Ce qu’il fallait faire n’était pas évident. En avançant, on risquait d’en arriver à un échange de coups de feu; en se repliant, la patrouille se soldait par un échec. Il y eut une dispute chez les Canadiens. Le capitaine commandant la patrouille ordonnait le repli, le sergent expert en relations civiles-militaires voulait continuer malgré les risques.
Les deux soldats m’ont expliqué leur façon de penser par la suite.
Le sergent voulait avancer; il lui fallait débarrasser le secteur d’insurgés pour pouvoir amorcer la reconstruction. Le capitaine le savait bien, mais il ne se croyait pas en position d’ordonner une avance vers un emplacement ennemi bien défini avec si peu de soldats et si peu de possibilités de renforts.
D’après les plans, le secteur aurait déjà dû être libre d’insurgés et ces soldats étaient venus construire. Toutefois, personne n’avait dit aux insurgés qu’ils avaient débarrassé le secteur. Ils étaient toujours là, et cela compliquait l’affaire parce qu’il n’y avait pas suffisamment de soldats pour s’en occuper.
Au cours de mes cinq années de reportages, de mes quatre voyages au Kandahar et de mes six semaines à l’extérieur des barbelés, la guerre s’était tellement compliquée que plus rien ne me semblait sensé. Mais, ce jour-là, à Zangabad, la lumière fut et je compris quelque chose : la mission à laquelle participaient les soldats ne pouvait que faire fiasco.
Quelques mois plus tard, la reconstruction de la route au Panjwaii de l’Ouest était abandonnée, les bases canadiennes étaient toutes démantelées et le secteur était abandonné à l’ennemi.
L’odeur du paradis se répand
Le martyre approche. Cette phrase avait été écrite par le bombardier du 11 septembre Ziad Jarrah dans ses notes personnelles avant l’attaque.
Pour le Canada, la guerre a commencé le 11 septembre 2001, quand al-Qaïda a attaqué les États-Unis et que l’OTAN a répondu en invoquant son pacte de défense mutuelle.
L’intervention militaire débuta quand les talibans refusèrent de livrer Oussama Ben Laden à la justice.
La mission avait pour but de détruire al-Qaïda et passer à l’offensive contre les militants islamistes.
Cependant, au-delà du 11 septembre et du terrorisme, la guerre, de bien des façons, concernait le progrès, c’est-à-dire ce que le progrès signifie et qui peut définir les règles de base du fonctionnement de la société et du monde.
Pour Ben Laden, al-Qaïda et les talibans, le progrès signifiait un recul à pleins gaz par rapport au monde moderne. Ils voulaient créer un État islamiste parfait, un royaume sauvage où règneraient la charia et la piété sans limites. Un tel endroit n’a jamais vraiment existé que dans un livre — le Coran — et la mauvaise interprétation de ce texte par les militants islamistes leur a donné un but qui n’est qu’une fantaisie religieuse provenant d’un Âge sombre.
![Une evasan après l’explosion d’un EEI. [PHOTO : ADAM DAY] Une evasan après l’explosion d’un EEI. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2011/09/AfghanInset21.jpg)
Voilà pourquoi ils étaient nos ennemis : ils voulaient nous détruire et transformer le monde en un paradis totalitaire comme ils l’imaginent, où les femmes sont des esclaves, les hommes sont purs et Dieu est roi. C’est un monde dont on peut voir l’atrocité dans les gestes posés par les talibans eux-mêmes : ils frappent les femmes à coups de barres de métal dans les rues, ils aspergent d’acide les jeunes filles qui veulent apprendre à lire, ils assassinent tous ceux qui s’opposent à eux.
Bien entendu, ces extrémistes ont tort; ce sont d’éternels perdants qui ne peuvent pas résister à l’attrait d’une confrérie dans un culte de la mort et dont la seule réponse aux défis implacables et aux difficultés d’un monde moderne qu’ils sont incapables de comprendre est d’essayer de le détruire, cherchant le paradis en le créant ici bas, jusqu’à la mort.
Il n’y a pas de doute qu’il fallait les combattre. Les Canadiens se sont toujours opposés à ce qu’un groupe impose ses idées aux autres au détriment de leur liberté. On appelle cela le fascisme et tout groupe d’hommes assez stupides pour en menacer le monde devrait s’attendre à encourir la colère de ce dernier.
Mais c’est là où les choses se compliquent.
Cet ennemi mérite d’être combattu, c’est sûr, mais ce n’est pas toujours lui que nous combattions en Afghanistan.
L’embrouillement de la guerre
En juin, j’ai rencontré un soldat dans un bar au Canada central. Nous avions passé quelques semaines ensemble au Panjwaii, une fois. Je lui ai dit que j’écrivais cet article-ci, que j’essayais d’écrire une courte histoire de la guerre du Canada au Kandahar. Je lui ai dit que j’avais l’intention de dire la vérité à ce sujet.
Le bar était sombre et la musique plutôt forte. Il secoua la tête, ses lèvres dessinant un sourire comme celui qu’on a quand la personne à qui l’on parle est trop bête. « Bonne chance », me dit-il.
Qu’entendait-il exactement? Eh bien, c’est difficile à dire. Mais permettez-moi d’essayer.
Il sait qu’il n’y a vraiment qu’une seule histoire importante que je puisse raconter. C’est l’histoire des soldats, l’histoire des Canadiens envoyés à une terre lointaine pour combattre, suivre les ordres, essayer l’impossible et s’efforcer de ne pas mourir ni de perdre les jambes. Ce n’est pas exactement une histoire de triomphe après le tumulte. C’est une histoire complexe et étrange, celle d’une guerre que l’on a peu de chances de gagner. C’est une histoire, il le sait, que personne ne veut fort probablement entendre.
Les Forces canadiennes sont allées au Kandahar en 2006 afin d’établir l’ordre et la civilité dans toute la province. Au début, le groupement tactique devait assurer la sécurité de l’équipe de reconstruction provinciale qui devait mener à bien toutes sortes de projets.
Cela n’a pas eu lieu.
Depuis le début, la guerre était plutôt tumultueuse, agitée, mouvementée : un état d’urgence constant dans lequel le groupement tactique traversait tout le Kandahar, et même jusqu’à la province d’Helmand, écrasant toute activité des insurgés où qu’ils les trouvassent.
Au fil du temps, à mesure que l’opposition se manifestait, le secteur des opérations des Canadiens — toute la province au début — rapetissa jusqu’à n’être plus que quelques districts autour de Kandahar et même, pour finir, plus que la moitié du district de Panjwaii.
Dans le bar, au Manitoba, je dis au soldat que j’essayais d’expliquer ce rétrécissement.
« Dites donc cet échec », me répondit-il.
Peut-être. Mais ce qui a eu lieu ne se résume pas qu’à un échec.
Une nouvelle génération d’anciens combattants
Il y a comme un secret ignoble à propos des Canadiens en guerre. Les soldats de cette génération ont adhéré à une fraternité historique : les gens qui ont été témoins de ce qui est en deçà de la civilité, bien au-delà des discours des politiciens, ceux qui ont été témoins de ce qu’il y a de brutal en dessous du vernis.
Les inconvénients de cette expérience sont graves. Patrouiller parmi les bombes, c’est comme une grande loterie inverse où les plus malchanceux perdent tout d’un seul coup.
En outre, quand vous passez assez de temps là-bas, il faut bien que votre tour arrive.
La mission au Kandahar a couté la vie à plus de 150 Canadiens. Beaucoup de centaines d’entre eux ont perdu des jambes ou des bras et ont été blessés de diverses façons.
Mais ce n’est pas tout.
Les survivants, des dizaines de milliers d’entre eux, prenaient des risques qu’il est difficile d’imaginer, vraiment difficile à comprendre.
À moins d’avoir marché au Panjwaii occidental, de la base de patrouille Sperwan Ghar au sous-poste de la police Zangabad; à moins de s’être attaché dans un Geländewagon non blindé et d’être allé au cœur de la violente opération Méduse; à moins d’avoir assisté à une explosion dans un Bison sur la route Hyena, dans un VAL ou dans un Nyala, et à moins d’avoir été pris pour cible dans un Griffon, un Blackhawk ou un Chinook, il vous sera difficile de comprendre ce que les soldats canadiens de cette génération ont enduré. Vous ne pourrez jamais comprendre non plus l’étendue de leur sacrifice.
En voici un aspect : quand vous ne savez pas combien de temps il vous reste à vivre, vous ne pensez plus particulièrement à l’avenir. Le spectre de la violence vous met temporairement dans un état d’intemporalité. C’est un problème, parce que quand on se met à ne pas tenir compte de l’avenir, il est difficile de se rappeler qu’on sait le faire. Lorsqu’on a éprouvé un tel détachement, quand ces liens ont été tranchés, il est ardu de les rattacher quand on rentre chez soi.
On finit par avoir l’impression qu’y retourner est la seule chose qui soit sensée. Quant au soldat au bar, la seule chose qui l’inquiétait vraiment, c’est que la guerre était terminée.
Mission inexpliquée
Bien sûr, la guerre n’est pas terminée. Mais le Canada quitte le champ de bataille. C’est la première fois de l’histoire que le Canada se retire d’un combat avant que la guerre ne soit gagnée.
Pourquoi est-ce arrivé? Hélas, ce n’est pas simple.
En 2006, j’ai eu un entretien avec le colonel Fred Lewis qui était alors commandant adjoint de la force opérationnelle canadienne au Kandahar.
Au terrain d’aviation de Kandahar, un document très important était épinglé au mur de Lewis : c’était plus ou moins le plan de campagne canadien, un diagramme de ce qui devait avoir lieu pour établir un État afghan qui fonctionne. Et l’élément clé de la campagne, c’était, chose intéressante, le public canadien.
Voici ce que Lewis disait à propos du plan.
« La volonté du peuple canadien est notre centre de gravité. Alors, disons que le centre de gravité est notre puissance. Si notre puissance vient à manquer, nous perdons. »
Je trouvais cela extraordinaire, alors je lui demandai : « Comment une force militaire peut-elle soutenir ou maintenir la volonté du peuple canadien? »
« Ouais, répliqua-t-il. Vous savez, c’est là la question capitale. C’est ça qui est difficile à faire. »
![L’infanterie à Salavat. [PHOTO : ADAM DAY] L’infanterie à Salavat. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2011/09/AfghanInset4.jpg)
En plus du fait que l’armée n’est pas équipée pour influencer l’opinion du public canadien et qu’elle n’a pas la permission de le faire (cette tâche incombe aux politiciens), les grandes lignes de la mission seraient toujours difficiles à vendre. Et les questions sont valables : est-ce que le long combat avec les insurgés est la meilleure manière de lutter contre les extrémistes islamiques en Afghanistan? Comment exactement en est-on arrivé à ce que de jeunes hommes et femmes du Canada aillent à un pays en développement de l’autre côté de la planète se battre avec des agriculteurs afghans xénophobes et des fanatiques religieux irréductibles pour défendre New York, Washington et Ottawa?
Bien que la mission était sensée en ce qui concerne la stratégie — al-Qaïda devait être détruite, les talibans, vaincus et l’Afghanistan, transformé en un endroit stable où les terroristes ne puissent plus se réfugier et s’entrainer pour nous attaquer — dans l’opinion publique, tout cela dépassait la mesure.
Les sondages expliquent tout : les Canadiens n’ont jamais vraiment cru en la mission. Les données sont vraiment catégoriques. Dans au moins 30 sondages sur l’opinion publique menés entre le début de 2006 et la fin de 2010, plus de 50 p. 100 des Canadiens indiquaient qu’ils s’opposaient à la mission en Afghanistan.
Quant au gouvernement Harper, il ne voulait pas vraiment justifier les fondations stratégiques de la guerre.
Il a plutôt cherché un moyen de rendre la guerre plus acceptable pour les indécis. En 2006, le gouvernement organisait une série de groupes de discussion dans sept centres du pays afin de découvrir les messages les plus agréables pour la guerre.
« Cet exercice a été entièrement documenté dans l’article Losing Heart: Declining Support and the Political Marketing of the Afghanistan Mission » paru dans la Revue canadienne de science politique en 2009.
« Le rapport annonçait que […] le soutien pourrait être renforcé chez les “partisans modérés” de la mission et ceux qui hésitaient entre le soutien et l’opposition. Ils devraient tous être la cible d’une “campagne d’information” agressive insistant “sur des exemples concrets du progrès (concentrés surtout sur les femmes et les enfants), sur l’engagement de l’ONU et de l’OTAN, et sur la clarté concernant le besoin de sécurité et de stabilité afin de procurer de l’aide et d’entreprendre la diplomatie”. »
On ne sera pas surpris qu’il existât un désir politique de mener une campagne de relations publiques pour présenter la guerre sous un certain angle.
La guerre est-elle arrivée vraiment au stade de la reconstruction? Voilà la vraie question.
Le talon d’Achilles de la mission, c’était l’incapacité de débarrasser le Kandahar d’insurgés. Aucune théorie de contre-insurrection ni de campagne de relations publiques, si soigneusement échafaudées soient-elles, ne pouvaient suffire à compenser le manque de bottes sur le terrain.
Mieux et pire en même temps
Alors qu’avons-nous accompli? En 2006, Bazaar-e-Panjwaii était une ville fantôme où se trouvaient les insurgés; l’école était une base militaire. En 2010, j’ai été en mission à partir de Masum Ghar; nous avons traversé Bazaar-e-Panjwaii à pied, l’école avait des centaines d’élèves, et les marchés prospéraient. Et puis la patrouille a échangé des coups de feu dans la ville, à la vue des Canadiens qui se trouvaient derrière les barbelés de Masum Ghar.
Les insurgés étaient encore dans la ville.
Alors, bien que la situation se soit améliorée de bien des manières, elle est quand même aussi violente et incontrôlée que jamais.
En 2009, étant revenu au pays, je perdais mon temps à l’ordinateur en jouant avec le tout nouveau moteur de recherche à la pointe de la technologie appelé Wolfram Alpha qui, dit-on, peut répondre à n’importe quelle question, si difficile soit-elle. Alors je l’ai testé avec la question la plus difficile que j’ai pu : « quel est le problème en Afghanistan? »
Tout ce que j’ai obtenu, c’était la fiche technique d’un pays. C’était décevant au début, mais je me suis mis à lire les renseignements. L’Afghanistan a une frontière de 2 430 kilomètres avec le Pakistan et une de 936 kilomètres avec l’Iran, l’espérance de vie est de 44,6 années (217e au monde), l’âge moyen est de 17,6 ans (204e au monde), il y a quatre ethnies principales qui parlent principalement cinq langues, le taux d’alphabétisation est de 28,1 p. 100, le PIB est de 217,79 $ par personne (233e au monde) et le taux de chômage est de 40 p. 100 (14e au monde).
Ainsi, le pays équivaut à un groupe de jeunes analphabètes pauvres qui vivent dans un mauvais quartier et qui n’ont pas vraiment d’espoir d’avenir. Oui, c’est ça le problème.
La paix est difficile à imaginer pour l’Afghanistan. Les tensions et les rivalités entre les ethnies, la corruption répandue, le manque d’éducation, la présence d’armes, et le voisin officieux, pour ne pas dire carrément déstabilisateur, qu’est le Pakistan. Des fois, on dirait que l’Afghanistan est un pays fait pour la guerre civile. En 2006, le Canada y entrait en plein milieu; en 2011, il quittait le Kandahar. Comment avons-nous modifié la vie des Afghans et l’histoire moderne du pays? Rien de tout cela n’est clair.
La mission n’a pas manqué de succès, petits et grands, mais le public canadien a encore beaucoup de doutes à propos de la guerre. Il n’y a pas longtemps, quelqu’un m’a demandé si elle avait valu la peine, si ce que la mission a donné au Canada valait ce que nous y avons perdu. J’ai réfléchi pendant quelques secondes, mais tout ce que je pouvais dire c’est que ce n’était pas la bonne question à poser. Il ne s’agissait pas d’un combat que qui que ce soit eut pu désirer. On ne pouvait certainement pas laisser al-Qaïda bien installée et protégée par les talibans en Afghanistan. Il y a des choses qui méritent qu’on se batte pour elles, et c’en est une. Les talibans sont éparpillés et Oussama Ben Laden est mort. Ce sont là des résultats.
Le prix a été élevé. Par exemple, l’armée canadienne a été profondément modifiée. Au début, en 2006, il s’agissait surtout d’une armée de gens faisant carrière; les caporaux-chefs d’une trentaine d’années étaient nombreux et ils étaient très compétents, faisant ce qu’ils aimaient faire. Ces deux ou trois dernières années, les fantassins sont devenus plus jeunes, des gars qui se sont engagés pour aller à la guerre, une armée de gars qui n’avaient pas l’intention de porter l’uniforme toute leur vie. Il y a eu des conséquences. Je parlais à une simple soldate de 19 ans à Salavat, en 2009, et je lui ai demandé pourquoi elle s’était engagée. Elle avait une réponse toute prête. « Je pensais qu’aller à la guerre, ce serait bon pour mon CV. »
Peut-être qu’au moins nous avons acquis l’humilité que l’on a quand on réalise que notre vision a dépassé nos capacités, que notre capacité d’imaginer un résultat dépasse parfois notre capacité de l’atteindre.
La victoire est un état d’âme
La route du Panjwaii de l’Ouest a été complétée au printemps 2011. Il a fallu une vraie légion de soldats américains pour assurer la sécurité pendant la construction, mais les soldats canadiens étaient aussi là pour le voir.
Peut-être que tout le monde va finir par oublier la route de Mushan, mais nombreux sont les Canadiens qui sont morts pour elle.
Peu après l’ouverture de la route, le premier ministre Stephen Harper est allé au Panjwaii une dernière fois y prononcer un dernier discours.
« Le régime brutal des talibans matraquait ses propres citoyens et abritait les pires tueurs du monde : des hommes baignant dans leur propre mal au point où ils croyaient que leurs ambitions épouvantables n’étaient rien de moins que la volonté de Dieu. »
« Le monde est venu en Afghanistan parce que c’était un endroit si brutal qu’il était devenu un danger pour le monde entier, disait Harper aux journalistes. Quels que soient les problèmes et les défis qu’il reste, l’Afghanistan ne représente plus un danger pour le monde. »
Ce n’était ni plus ni moins qu’une déclaration de victoire. Bien que ce fut audacieux — l’Afghanistan n’est pas encore tout à fait libre de terroristes — l’histoire décidera si en gros Harper avait raison.
Permettez-moi de vous proposer une manière de le savoir : si Mushan, Zangabad et le Panjwaii deviennent un jour assez paisibles et hospitaliers pour que les Canadiens puissent y bâtir des monuments à leurs morts militaires et qu’ils puissent y aller en visite quand ils voudront, peut-être pourra-t-on alors crier victoire.