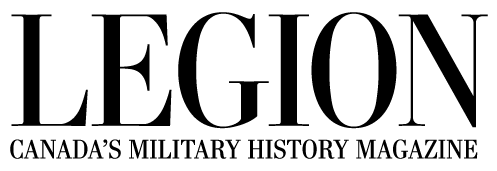![[PHOTO : ADAM DAY] [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/OutpostLead.jpg)
Ils savaient qu’il y aurait des bombes cachées sous terre. Ils savaient que leurs détecteurs à métaux ne décèleraient pas leurs plateaux de pression en bois. Ils savaient qu’après les bombes, ils seraient pris en embuscade et que des morceaux de métal voleraient de tous côtés à toute vitesse.
Les Canadiens savaient qu’ils s’avançaient vers les détonations, que certains d’entre eux tomberaient, qu’il était improbable qu’ils revinssent tous à la base.
Ils savaient qu’il y aurait du grabuge et des explosions cauchemardesques, et la peur atroce de mourir.
Ils y allèrent quand même.
Ils marchèrent à travers champs jusqu’à la guerre et tout ce qu’ils avaient anticipé se produisirent.
Nous sommes en aout 2010 et la guerre au Kandahar s’est tellement intensifiée qu’on ne sait ce qui va d’abord se détraquer. La base aérienne des alliés, limitrophe de la ville de Kandahar, est déjà aussi grande qu’une ville et les Américains continuent d’arriver. Ce sont des jeunes occidentaux, lucides et portant fusil, qui s’entassent en Afghanistan du Sud par milliers, en quête d’action.
Quand on est en sécurité, à la base, la guerre semble principalement se résumer à des explosions lointaines. Le conflit est si vague et il y a tellement de points de vue qu’il semble impossible d’obtenir des renseignements irréfragables; soit que l’OTAN est en train de gagner, soit que les insurgés se préparent à envahir la piste d’atterrissage, ou même, étrangement, les deux. On note du progrès dans un secteur et un chaos indescriptible à cinq kilomètres plus loin. Tout semble possible et la seule manière d’élucider le mystère, c’est de s’aligner sur les rumeurs qui vont bon train de tous côtés et qui sont aussi difficiles à capter qu’une odeur dans un courant d’air.
Louie Palu dit que « c’est l’été des EEI [engins explosifs improvisés] » et personne ne le sait mieux que lui. Photojournaliste canadien rebelle et amusant, malmené par la guerre, Palu dit que les jeunes au Panjwai accueillent les patrouilles des Canadiens en érigeant des piles de terre à la main comme s’il s’agissait de l’emplacement d’EEI et crient « pan! » pour taquiner les soldats.
![La bataille à coups de fusils fait rage. [PHOTO : ADAM DAY] La bataille à coups de fusils fait rage. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/Outpost4.jpg)
Palu a probablement passé plus de temps au Panjwai que n’importe quel autre Canadien et sa conception de la folie de la guerre est presque instinctuelle. Il parle d’un avant-poste qui est pris en cible tous les jours et qu’on risque de tomber dans une embuscade si on s’éloigne de 100 mètres. Il y a des EEI partout; ils sont de bois et de plastique, donc indétectables. Mais, dit Palu, les soldats continuent de sortir. Il attribue cela au machisme presque suicidaire de l’unité. N’importe quelle autre unité aurait renoncé, mais ces gars-là continuent de se promener parmi les bombes, comme pour dire : « Allez-y arrachez-nous les jambes à coups d’explosifs; on n’abandonne pas ».
Comme c’est le cas des pires rumeurs, celle-ci s’est révélée pratiquement réelle.
Avant-poste de combat Panjsher
La seule route qui mène à la petite base canadienne la plus assiégée de toute la guerre est surnommée « Nightmare » (cauchemar) et personne ne veut vraiment s’y aventurer.
Au début, il est interdit d’y aller : c’est bien trop dangereux pour les journalistes. Enfin, on arrive à un compromis et on nous permet de nous y rendre, mais pas de sortir de l’avant-poste. Ce compromis sera altéré par la suite, mais il nous faut d’abord nous rendre là-bas, ce qui n’est pas facile parce que la route est presque constamment sous le feu de l’ennemi.
Après quelques jours sur le qui-vive, le moment est enfin venu de passer aux actes. Lentement.
Pendant au moins les deux heures d’attente, le grand convoi vert blindé diffuse des échappements de diésel dans la base d’opérations avancées Masum Ghar. L’avant-poste de combat Panjsher est la cible de coups de feu et l’on y dissuade les visiteurs. Le déplacement risque d’être remis parce qu’il se fait tard et suivre la route Nightmare pourrait prendre beaucoup de temps.
Finalement, le convoi fait le voyage à toute vitesse et nous sommes rapidement à Panjsher.
Non qu’il y ait eu grand-chose à voir. Panjsher est un petit avant-poste carré au milieu d’un champ désaffecté en plein milieu du district de Panjwai. C’est un poste rudimentaire : une collection de tentes, du sable et des armes, rien de plus.
Sur une planche en contreplaqué enchâssée dans les barbelés à lames, quelqu’un a peint Keep Out (entrée interdite). On peut croire que les Afghans de la ville de Chalghowr, que les Canadiens sont en théorie venus protéger, ne parlent pas anglais. Mais c’est là le moindre des problèmes.
La ville de Chalghowr est située à quelques centaines de mètres au sud, mais elle demeure inaccessible aux soldats de la base. Chaque fois qu’ils s’y dirigent, un évènement catastrophique arrive. Cela se produit à plusieurs reprises au cours des semaines de patrouilles, jusqu’à ce que l’unité soit visiblement réduite.
Chaque soldat de l’avant-poste Panjsher mérite une médaille, nous dira leur commandant. Ce sont des soldats qui s’avancent en connaissance de cause dans un champ de mines indétec-tables. Ce sont des soldats à la réputation de machisme suicidaire de Palu, des hommes et des femmes du 7e Peloton de la compagnie Oscar du 3e Bataillon du Royal Canadian Regiment.
L’histoire de leur unité à Panjsher en est une d’existence aux premières lignes d’une guerre difficile, où tout n’est pas raisonnable et où les problèmes tactiques ne sont pas nécessairement solubles. C’est une situation intenable, mais vivre aux premières lignes a toujours été intenable. Parfois, ils sont impuissants face à la façon dont l’ennemi attaque. Il semble que la seule chose à faire, c’est de continuer comme à l’habitude.
![Le 7e Peloton portant des masques à tête de mort. [PHOTO : ADAM DAY] Le 7e Peloton portant des masques à tête de mort. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/Outpost7.jpg)
On nous fait sauter
Jusqu’ici, le prix de la persistance a été élevé. Le peloton et tous ses divers partisans ont reçu toute une raclée à Panjsher. Beaucoup ont été blessés, et c’est parmi les galonnés que les ravages sont les pires : d’abord, ils ont perdu un commandant de section (une balle dans la poitrine tirée de près) et puis un autre (un pied emporté par une explosion), ensuite ils ont perdu le commandant du détachement d’ingénieurs (une jambe emportée par une explosion), le maitre-chien (un bras et une jambe emportés par une explosion), et le commandant et l’adjudant du peloton (relevés de leurs fonctions quand le commandant de la compagnie ne leur faisait plus confiance).
Le lieutenant Stephen Martin, âgé de 27 ans, est le nouveau commandant du peloton. Il est dans l’armée depuis trois ans environ et quelques semaines plus tôt, il était à Petawawa, ne croyant pas vraiment qu’il serait assigné dans un endroit comme Panjsher.
Malgré l’embarras dans lequel il se trouve, Martin est calme et pensif et, bien qu’il fasse actuellement preuve d’un peu de prudence, il s’est fait à la situation tactique de la petite base. Le mot clé à Panjsher est impasse : les ennemis, comme les Canadiens, sont trop forts pour perdre et trop faibles pour gagner. Quant à la stratégie contrinsurrectionnelle d’expulser l’ennemi, de défendre le terrain et de construire quelque chose de mieux, on ne peut certainement pas l’employer actuellement à Chalghowr. « Eh bien! dit Martin en riant et en promenant son regard autour de la base, on tient assez bien Panjsher. »
Le terme « impasse » n’est pas trop désagréable d’après les soldats; ils sont fiers de maintenir leur position en ce petit lopin de terre situé dans un endroit si dur. Il n’y a pas eu plus de quelques jours d’affilée, au cours des deux derniers mois, où l’avant-poste n’ait pas été criblé de balles, mais il est impossible à l’ennemi de le leur prendre. D’un autre côté, aller n’importe où au sud de Panjsher, c’est comme de s’introduire chez l’ennemi.
« Quand les nouveaux arrivent, ils pensent que “c’est pas si mal”, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, nous dit un soldat peu après notre arrivée. Si on allait par là, dit-il en indiquant le sud, des sections entières disparaitraient. »
Duel de tireurs d’élite à midi,tous les jours
Le tireur d’élite est un dur, tranquille comme ils ont tous l’habitude de l’être. Il a l’air à moitié surfeur, à moitié culturiste et, bien qu’il semble aimable et tranquille, j’ai l’impression qu’il n’est vraiment pas très aimable ni très tranquille. De toute façon, il est actuellement distrait; il ne parle guère parce qu’il se trouve dans une tour à neuf mètres de hauteur, d’où il fixe le territoire ennemi des yeux, dans un duel avec un tireur de précision ennemi.
Pendant des heures, il est accroupi au-dessus de son lourd fusil C-14, balayant Chalghowr et espérant que son adversaire fasse la moindre erreur pour pouvoir lui tirer dans la tête.
Le tireur et le guetteur tirent le plan du terrain et du village patiemment en y attribuant des noms mémorables : pizzéria, mosquée sommaire, porte ouverte, arbre à guetteur, tralalas, porte fermée et ainsi de suite.
« Ce gars n’est pas facile à avoir », dit le tireur d’élite, qui ne veut pas que vous connaissiez son nom, ce qui n’est pas difficile à comprendre, car son métier est de tuer des gens. « Je pourrais être assis ici pendant des heures, ce que j’ai fait d’ailleurs, et rien… »
Il n’aime pas appeler son adversaire tireur d’élite. Il ne croit pas que le tireur ennemi ait mérité le titre, même s’il l’a presque tué une fois; le tireur de précision ennemi avait placé une balle à une trentaine de centimètres au-dessus de la tête du Canadien, d’une distance de 800 mètres. « Il est intelligent. Il a été bien entrainé », dit le Canadien à contrecœur.
Ces tireurs de précision insurgés sont nouveaux en Afghanistan du Sud. Bien que le tireur qui fait feu sur Panjsher n’ait encore atteint personne, il existe des histoires de tireurs semblables à d’autres bases dans le Sud et plusieurs ont, de temps à autre, eu un coup heureux.
Le tireur de précision ennemi se cache à Chalghowr et ne tire que des coups de feu uniques, peut-être pas plus d’une fois l’heure et, d’après le tireur d’élite, l’ennemi est profondément dans un édifice quand il tire, sa balle sortant par une porte ou une fenêtre. Tout au moins, c’est là une des théories : tout ce que le tireur d’élite sait vraiment, c’est que, quoiqu’il ait été dans la tour lorsque des dizaines de coups ont été tirés, l’œil à la lunette, il n’a jamais vu ni éclair ni poussière indiquant la position de son adversaire.
« Il devra bien faire une erreur à un moment donné. Il s’agit d’être ici pour la remarquer », dit le tireur d’élite.
Dans ce duel particulier, le tireur ennemi n’a pas tiré depuis plusieurs heures, soit depuis que le tireur d’élite et le guetteur sont montés dans la tour. Le tireur ennemi observait donc.
Le tireur d’élite décide qu’il en a assez. Il prend son fusil et le dépose sur le plancher, le gros silencieux émergeant des sacs de sable. « Je vais laisser mon fusil ici comme appât, dit-il. S’il frappe le silencieux, je le mute au grade de tireur d’élite. » Il rit.
À ce moment-là, l’ennemi tire un coup et nous nous baissons promptement.
Les deux gars reprennent immédiatement leur lunette. Le guetteur met son casque. Nous restons tous bien plus bas.
Personne n’a entendu la balle, ne sait où elle a fini, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Le tireur d’élite rit silencieusement. « Chaque fois, on se baisse, mais c’est toujours trop tard quand on a entendu le coup de feu », dit-il tout en scrutant les environs.
![La patrouille avance en ordre ouvert. [PHOTO : ADAM DAY] La patrouille avance en ordre ouvert. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/Outpost6.jpg)
Prenons les blindés
Dans la tente de commandement, le lieutenant Martin explique le plan de bataille de demain. C’est Chalghowr la cible, mais plutôt que de se diriger directement au sud, ils vont se déplacer vers l’est à 800 mètres et puis vers le sud jusqu’à une partie de la ville surnommée la Petite Chalghowr. Ils partiront de bonne heure et à pied afin d’essayer de surprendre l’ennemi.
Un groupe de fantassins réfléchissent tranquillement à cela. La position de Martin n’est pas facile : il est nouveau, il n’a pas beaucoup d’expérience et il commande.
Le caporal-chef Colin Bridger, commandant de section suppléant, prend la parole. « Je pense qu’on devrait prendre les véhicules blindés. »
Martin n’est pas du même avis. Il pense qu’une colonne blindée alerterait l’ennemi. Il demande à Bridger pourquoi ils devraient prendre les blindés.
Bridger fait la guerre ici depuis plusieurs mois. Il refuse de justifier son avis. La situation est délicate. « On devrait prendre les véhicules blindés », répète-t-il.
Martin y réfléchit. Il n’a peut-être pas d’expérience, mais il n’est pas imprudent. « Bon. »
Par la suite, Bridger nous explique sa pensée. « Je savais qu’on allait être attaqués; on est toujours attaqués ici. »
Il a raison.
Martin, Bridger et environ 16 autres Canadiens s’empilent dans quatre véhicules blindés tout juste après l’aube, se rendent à l’endroit où la patrouille doit descendre et traversent un champ à pied pour se rendre à la Petite Chalghowr.
Juste avant que la patrouille quitte la route, je demande au soldat derrière moi quelles sont les chances qu’on tombe sur quelque chose. « À peu près 100 p. 100 », grommèle-t-il et il se met un demi-masque décoré d’un crâne d’humain.
![Le caporal-chef Ken Wilson et l’équipe d’EVASAN américaine venue le sauver. [PHOTO : ADAM DAY] Le caporal-chef Ken Wilson et l’équipe d’EVASAN américaine venue le sauver. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/Outpost2.jpg)
Qu’ils brulent
Deux ingénieurs prennent la tête du groupe avec leur détecteur de mines. À quelque 100 mètres, un petit pont enjambe un fossé d’irrigation que nous allons emprunter pour aller vers le sud.
Les ingénieurs, balayant le sol de leur détecteur, quittent le champ et suivent un petit sentier. La patrouille au complet se trouve alors dans le champ. Les ingénieurs ont atteint le pont. Le seul bruit est celui des bottes foulant la terre.
Bien que je sois sûr que ce qui arrive ensuite a un son, sur le moment, j’ai l’impression que c’est silencieux.
Le corps du caporal Troy Carleton s’élève dans un pilier de fumée et de terre, comme une poupée de chiffon qu’une force géologique malveillante aurait lancée. Ça semble aberrant, répréhensible : la terre elle-même lance Carleton par en haut où il frappe un arbre dont les branches le renvoient à terre.
Carleton crie quelque chose. La patrouille est déployée. Au début, personne ne bouge, puis les soldats s’élancent vers lui.
Il était cinquième ou sixième dans la ligne des Canadiens. Les plateaux de pression en bois de la mine, en plus d’être imperceptibles aux détecteurs de métaux des ingénieurs, sont petits et Carleton est celui qui a eu la malchance de piler dessus de façon à faire détonner l’engin.
Heureusement que la bombe a été fabriquée avec des explosifs improvisés et qu’elle n’a pas explosé tout à fait correctement. Bien que la déflagration ait été puissante, il s’agissait d’une explosion « d’ordre inférieur ».
Carleton est assis sur le sentier, à peu près où il a atterri. Sa jambe n’est pas belle à voir, mais il va s’en tirer pratiquement intact au point de vue physique.
L’interprète se trouve à ses côtés. C’est un Afghan très petit, on ne peut plus gentil, qui n’a jamais rien de mal à dire à propos de qui que ce soit. Il était à plusieurs de mètres de l’éruption. « P—ins de leur m—s », murmure-t-il en direction de Chalghowr, avec une authenticité qu’on ne peut probablement avoir que lorsqu’on s’est presque fait tuer.
![Le caporal-chef Ken Wilson sur un brancard, quelques minutes après s’être fait blessé. [PHOTO : ADAM DAY] Le caporal-chef Ken Wilson sur un brancard, quelques minutes après s’être fait blessé. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/Outpost5.jpg)
À la suite de l’explosion, sur le réseau radio de l’ennemi, on parle d’une embuscade imminente. D’après l’interprète et les quelques soldats afghans qui accompagnent le 7e Peloton, plusieurs groupes d’insurgés essaient de se mettre en position pour tirer.
En attendant, des gars de la neutralisation des explosifs et munitions sont en chemin pour examiner l’EEI et vérifier s’il y a des bombes secondaires.
La plus grande partie du peloton s’est mise à couvert dans un fossé, de l’autre côté du champ où Carleton a sauté, mais il y a encore quelques ingénieurs sur le sentier.
Le caporal-chef Ken Wilson est là, debout sur le sentier. Et puis il n’y est plus.
À sa place, il y a une éruption de pierres et d’éclats d’obus.
J’ai peine à croire qu’un corps humain puisse se trouver au milieu d’une telle violence sans être désintégré. Wilson est pourtant là, par terre, qui se contorsionne et ses cris ne forment pas de mots.
Cette fois-là, l’explosion n’était pas d’un ordre inférieur. J’étais couché dans le fossé à six mètres de lui; j’ai ressenti le souffle comme une mise en échec et mes oreilles n’ont plus fonctionné pendant un moment.
Wilson est par terre à trois mètres de l’éruption et, alors que le nuage de l’explosion se disperse, les soldats courent vers lui en criant.
Le bavardage radio a atteint un point critique et Martin crie aux gars qui donnent les premiers soins à Wilson de le mettre à l’abri.
Le peloton s’est aligné sur le replat d’un fossé d’irrigation, les armes dirigées vers le sud, vers la Petite Chalghowr. Les soldats soulèvent Wilson et le transportent derrière le replat. Il est couvert de terre, la bouche ouverte.
Les premiers coups de feu de la bataille sont ceux des Canadiens : un tireur de véhicule blindé fait feu de sa mitrailleuse C6 sur quelqu’un qui se déplace dans le champ à quelques centaines de mètres.
L’ennemi se met à tirer et, pendant longtemps, les balles sifflent de tous côtés. Les projectiles de l’ennemi sifflent surtout au-dessus de la tête des Canadiens qui tirent des coups de feu et lancent des grenades en retour. Quelques soldats de l’armée nationale afghane apparaissent d’où ils s’étaient réfugiés et tirent quelques grenades propulsées par fusée vers la ville, pour ensuite disparaître à nouveau.
L’ennemi arrête de tirer juste après l’arrivée d’un hélicoptère états-unien; les Canadiens arrêtent alors aussi.
L’ennemi sait qu’en règle générale, il sera tué s’il tire quand il y a des hélicoptères dans les environs, alors il ne le fait pas.
Le combat terminé, les soldats se lèvent et bavardent comme on bavarde quand on a beaucoup d’adrénaline dans le sang.
« Deux de nos mecs ont sauté aujourd’hui », dit l’un d’eux en souriant et en regardant les flammes de six mètres qui jaillissent d’une enceinte, au loin. « Alors qu’ils brulent, ces en—és. »
Carleton et Wilson sont allongés derrière un véhicule blindé. Wilson est sur un brancard, son fusil brisé à côté de lui.
On les évacue tous deux du champ de bataille, Carleton vers Kandahar où il passera beaucoup de temps et Wilson vers l’hôpital de la coalition, à Landstuhl, en Allemagne, où il recevra des soins avancés.
Juste avant que Wilson soit transporté à bord de l’hélicoptère, nous lui demandons s’il nous permet de publier les photos de lui que nous avons prises. « Ouais, dit-il, simplement, mais me fais pas avoir l’air d’une femmelette. » Attaché à la civière roulante, le casque bien serré, le bas de sa tenue en lambeaux, le visage maculé de terre et de sueur, il est loin d’en avoir l’air.
![Chalghowr brule après la bataille. [PHOTO : ADAM DAY] Chalghowr brule après la bataille. [PHOTO : ADAM DAY]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2011/01/Outpost3.jpg)
Des sucettes pour les amputés
Il y a une étrange symétrie au combat : nos attaques les plus convaincantes viennent des airs, celles de l’ennemi, de sous la terre. Et il y a une sorte de guerre au milieu.
C’est une guerre étrange. C’est une guerre où la mission des soldats est de protéger les gens d’un village où ils ne peuvent pas entrer, d’un ennemi qui attaque surtout d’une façon qu’ils ne peuvent pas contrer.
On dirait un jeu futile, déconcertant, où l’on avance jusqu’à prendre contact avec les EEI. Nous ne savons pas comment ils font. Nous n’avons de cesse de le leur dire. Ils n’en ont que faire. Ils ne veulent vraiment pas notre avis.
Pendant que nous attendions l’EVASAN, un autre soldat nous racontait l’histoire de l’ingénieur qui a perdu une jambe dans une explosion à Panjsher, récemment.
Un technicien médical tomba dans un ruisseau en traversant un champ de bataille en courant, semble-t-t-il. Quand il arriva auprès de l’ingénieur blessé, il se plaignit inconsidérément de sa chute.
L’ingénieur aurait dit : « Ouais, t’es tombé; moi, on m’a fait sauter la jambe. Est-ce que j’ai droit à une sucette? »
Le soldat conteur éclate de rire. « Ouais, on est dans la merde », dit-il.
Mais c’est encore pire que cela, pensons-nous.
On n’est pas venus pour tuer des enfants
Le lendemain, les mauvaises nouvelles font rapidement le tour de l’avant-poste; un garçon de 10 ans aurait été tué pendant la bataille à la Petite Chalghowr.
La rumeur n’est pas tout à fait surprenante. Pendant la bataille, une femme provenant des lignes ennemies a couru vers les Canadiens. Elle agitait les bras et criait. On lui dit de s’en retourner avant même que quiconque sache ce qu’elle voulait, mais elle était évidemment dans un grand désarroi.
Le major Steve Brown, commandant de la compagnie Oscar, est entièrement décent, extrêmement intelligent et foncièrement franc. Son état-major et lui sont basés à la base de patrouille Folad, mais il vient à Panhsher aussi souvent qu’il peut.
Il ne sait pas si un enfant a vraiment été tué pendant la bataille. Il est presque impossible d’en être certain quelques jours à peine après, mais il ne prend quand même pas la nouvelle à la légère. Il ne serait pas exagéré de dire que la possibilité d’une mort d’enfant aux mains des Canadiens est une torture à son endroit.
« Nous prenons chaque rapport de victimes civiles très sérieusement, dit-il. Les insurgés se servent d’enfants dans leurs opérations; ils s’en servent à tous les niveaux. Et ils participent activement à l’insurrection. […] Et c’est un très gros problème pour nos soldats parce qu’aucun d’entre eux n’est venu ici pour tuer des enfants. »
« Il nous est arrivé de voir des femmes et des enfants placés sur les toits ». Il soupire. « Il se peut que nous ayons touché une cible légitime et que c’était un jeune », déclare-t-il.
Le vide de la futilité connue
Le 7e Peloton a été frappé durement, mais il n’abandonne toujours pas. Il est difficile d’expliquer pourquoi ses membres veulent rester : s’il faut qu’il y ait des Canadiens à Panjsher, nous dit-on, ils veulent que ce soit eux.
« Ils méritent tous une médaille parce que, tous autant qu’ils sont, ils sortent chaque jour et prennent le risque de se faire tabasser, dit Brown. On sait qu’une patrouille sur quatre va mener à des blessures graves… »
Il s’arrête un instant.
« Et c’est ce qui les frustre, parce qu’on dirait qu’il faut actionner les EEI pour pouvoir tuer les méchants. C’est pas vraiment comme ça, mais ça en a beaucoup l’air. »
Nous sommes d’accord. On dirait que chaque fois que les soldats se dirigent vers Chalghowr, on les fait sauter.
Ceci dit, l’impasse à Panjsher n’a rien de sérieux dans le contexte militaire. Les insurgés se chiffrent à quelques dizaines au plus à Chalghowr et leurs bombes improvisées ne représentent pas un très grand danger pour notre équipement de déminage le plus robuste. Mais le peloton de Panjsher ne l’a pas, cet équipement; tout ce qu’il a, ce sont les détecteurs de métaux…et leur corps.
S’ils pouvaient déminer la route adéquatement, avec des démineurs résistant aux explosions, ils pourraient emprunter la route Nightmare pour se rendre à Chalghowr chaque jour, bouleversant les insurgés et dénouant l’impasse. Mais ils ne le peuvent pas.
« C’est une question de ressources, dit Brown. […] à moins que le Canada accepte de s’engager en Afghanistan plus considérablement […], c’est simplement une restriction avec laquelle ils doivent composer. »
Il y a de la pression à tous les niveaux : sur les soldats pour qu’ils sortent, sur les commandants pour qu’ils montrent qu’il y a du progrès, sur la force opérationnelle canadienne pour qu’elle batte l’ennemi à Panjwai et sur la coalition pour qu’elle gagne la guerre.
« Qui est-ce qui se précipite pour arriver au bout? C’est nous, dit Brown. Il y a, au pays, des points de référence concernant le progrès qu’il nous faut atteindre. Les forces de sécurité afghanes bougent lentement et régulièrement. Les insurgés disent que “Nous avons les montres, mais ils ont le temps”. Si on se précipite, ça se fait à nos risques et périls. »
La pression vient d’en haut et on dirait que tout ce qu’il reste à faire, c’est avancer sans tenir compte du prix.
À Panjsher, l’ennemi a adapté ses tactiques avec succès pour dépasser nos capacités; les soldats le savent, mais ils persistent. Ils se trouvent dans un mauvais endroit : c’est le vide entre le moment où leurs tactiques ont été battues et celui où ils s’en débarrassent. Disons, le vide de la futilité connue.
Ils continuent même si leurs idées sont devenues des idées fausses. Peut-être que c’est tout simplement la manière dont vont les choses au front, au cauchemar.