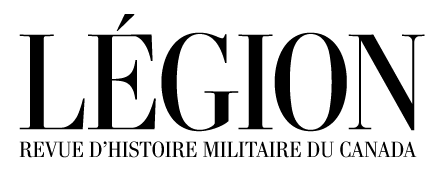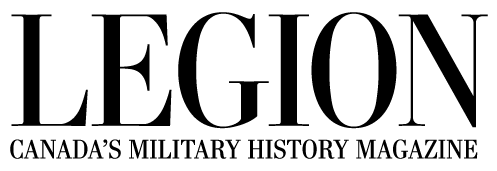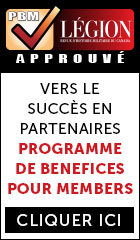![. [ILLUSTRATION : FRED SEBASTIAN]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2009/10/osiintro.jpg)
Le sergent Shawn Clarke sait à quel point les Forces canadiennes ont progressé au chapitre des traumatismes de stress opérationnel. S’il s’était connu il y a 10 ans tel qu’il est aujourd’hui — un vétéran de la guerre d’Afghanistan souffrant du trouble de stress post-traumatique — il se serait dit « arrête de te plaindre, espèce de lavette! C’est ce que j’aurais dit à un gars comme moi. »
Mais les choses ont changé en dix ans, presque du tout au tout.
Clarke fait partie d’un nombre croissant de militaires et d’anciens combattants qui récupèrent après un traumatisme de stress opérationnel (TSO) et, comme beaucoup d’entre eux, il n’a pas peur de défier les gens — même les hauts gradés — qui n’ont pas de tact ou de respect pour ceux qui souffrent d’un TSO. « Si j’entends un commentaire, je réponds, “Arrêtez-vous!” Et ça m’est égal qui c’est. Je dis : “Écoutez, j’ai entendu ce que vous venez de dire. Croyez-le ou non, mais c’est ça la politique, alors vous allez vous y conformer ou bien je vais pousser plus avant”. »
Autrefois, cela aurait été une entrave à la carrière; aujourd’hui, on reconnait qu’il est nécessaire de créer une « culture d’acceptation » en ce qui a trait aux problèmes de santé mentale.
« La conscientisation, surmonter l’infamie causée par les problèmes de santé mentale, rien n’est plus important pour moi », dit le général Walter Natynczyk en lançant une campagne de sensibilisation qu’il espère va changer sérieusement l’attitude liée aux traumatismes concernant la psyché, pour qu’elle soit comparable à celle qui concerne les blessures physiques. « Nous avons tous la même responsabilité, quel que soit notre grade; de s’entraider, d’aider les gens dans le besoin. »
Les gens qui sont chargés du bien-être des militaires et des anciens combattants ont fait des progrès remarquables au chapitre des TSO, ces 10 dernières années. Les Forces ont fait des efforts pour diminuer les TSO grâce au criblage, à l’éducation, à la formation et au traitement. Anciens combattants Canada (ACC) octroie de l’aide psychosociale et des avantages aux anciens combattants diagnostiqués comme souffrant de TSO; dont certains qui en souffrent depuis plus de 60 ans. Les officiers d’entraide de la Légion royale canadienne s’efforcent d’identifier les anciens combattants — jeunes ou vieux — qui présentent des symptômes de TSO, s’occupent de leur traitement et leur offrent leur appui.
En règle générale, c’est l’histoire d’un succès, mais il y a eu des rebondissements tragiques. Cependant, ce n’est pas de la fiction. Quand on appelle à l’aide en vain, les résultats sont catastrophiques pour les souffrants et leurs familles.
L’épouse d’un certain officier des Forces canadiennes d’une ville des Prairies a passé le printemps et l’automne à voir son mari, Philip, s’effondrer. Sa spécialité est rare et il a le sens du devoir, alors après son retour d’Afghanistan, ayant eu des traitements pour un TSPT, il a repris le travail, lequel devait être à temps partiel. « On ne sait trop comment, le temps partiel est devenu du temps plein », dit l’épouse, Caitlyn (ils nous ont demandé de ne pas dévoiler leur identité). Philip a pris part à un exercice malgré le fait que cela déclenchait ses symptômes; bien qu’il soit incapable de rester assis le temps d’un film; bien que son humeur soit devenue instable.
C’est sa décision de demander la libération tout de suite après l’exercice qui lui a permis de continuer. Philip « s’efforçait d’être à la hauteur » de l’uniforme jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que pour sa santé et pour celle de sa famille, il lui faudrait enlever cet uniforme à tout jamais.
Pendant que Philip s’écroulait, les Forces lançaient leur campagne sur la santé mentale et exhortaient leurs membres à combattre l’infamie, à s’appuyer les uns les autres; et à faire preuve de vigilance pour remarquer quand ceux qu’ils commandaient, leur copains ou eux-mêmes avaient besoin d’aide.
Mais combattre l’infamie ou prendre garde à sa propre santé n’ont rien de facile. « Pour susciter un changement culturel, il va nous falloir des années », dit Shawn Hearn, coordinateur du Canada atlantique et directeur du soutien et de l’administration des blessés pour le réseau de Soutien social aux blessures de stress opérationnel (SSBSO). Survivant d’une BSO lui-même, Hearn sait que les guerriers sont formés pour penser à la mission d’abord, à leurs pairs en deuxième lieu et à eux-mêmes bien après.
Dans la culture militaire, depuis très longtemps, la faiblesse équivaut à l’échec et craquer mentalement équivaut à une faiblesse de la personnalité. Les symptômes du traumatisme causé par le combat ont été remarqués depuis des milliers d’années, et principalement répudiés en tant que lâcheté. À la Première Guerre mondiale, nombre de victimes de ce qu’on appelait des « traumatismes dus aux bombardements » étaient passés en jugement et puis exécutés pour des crimes allant de la lâcheté jusqu’à la désertion, en passant par l’insubordination.
Au Canada, les changements ont accéléré. « Il y a quand même beaucoup d’améliorations à faire », dit Hearn. En 2008, une étude au Centre de recherche de l’Hôpital Douglas a indiqué qu’un tiers des membres des Forces n’essaieraient pas d’obtenir de traitements pour la santé mentale parce qu’ils avaient peur de se faire qualifier de façon négative.
Pendant longtemps, les gradés « étaient très réticents quand il s’agissait d’admettre qu’il y avait un problème », dit le Dr Greg Passey, psychiatre et militaire pendant 22 ans. Quand ses recherches, en 1993, ont indiqué qu’il y avait un taux de SSPT de 15 p. 100 et un taux de dépression de 13 p. 100 parmi deux unités de maintien de la paix revenant au pays, « ils ont dit que mes statistiques étaient incorrectes ».
ACC a fait les frais d’une vague d’anciens combattants souffrant de BSO peu de temps après. « Au milieu des années 90, il y a beaucoup plus d’anciens combattants qui sont venus nous voir à cause de problèmes de santé mentale car (les missions militaires du Canada) à l’étranger leur avaient fait changer de rôle », dit Raymond Lalonde, directeur du Centre national pour traumatismes liés au stress opérationnel de l’Hôpital Ste-Anne à Montréal. « En 2001, on a conclu un accord avec le ministère de la Défense nationale pour essayer de travailler ensemble. »
Il y a eu plusieurs évènements qui ont amené beaucoup de progrès. Le général à la retraite et sénateur Roméo Dallaire, qui a dirigé une mission de maintien de la paix en 1994 au Rwanda, a dévoilé qu’il souffre de SSPT et qu’il a essayé de se suicider en 2000. ACC a sondé 2 700 clients en 2000 et découvert que 15 p. 100 souffraient de SSPT et 28 p. 100 souffraient de dépression majeure. En 2003, l’année où sortait le livre de Dallaire J’ai serré la main du diable, 25 soldats et anciens combattants souffrant de SSPT ont engagé un procès demandant 60 millions de dollars en dommages pour traitement présumé inadéquat. En 2002, le protecteur du citoyen du MDN a rapporté que les traitements pour les gens souffrant de BSO étaient inadéquats.
Dans un tel contexte, ACC et le MDN se sont associés. La motivation est économique, en plus d’être humanitaire. Étant donné que les BSO sont plus difficiles et plus couteuses à traiter quand on attend avant de les diagnostiquer, les deux ministères peuvent faire des économies, à la longue, grâce à un système qui permette d’identifier rapidement les BSO et de les traiter efficacement.
Ils ont institué le Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles du MDN et d’ACC, et édifié un réseau national de cliniques de traitement et de programmes de soutien pour les traumatismes de stress opérationnel à l’échelle du pays afin de servir les militaires, les anciens combattants et les membres de la Gendarmerie royale du Canada. « Nous avions l’intention de créer une suite de services et de politiques, indépendamment de l’endroit où habite le militaire ou l’ancien combattant », nous explique Lalonde.
Les Forces ont ajouté un procédé de criblage précédant le déploiement, en 2003, quand les hauts gradés militaires dirent s’inquiéter du fait qu’on déployait des soldats ayant des problèmes de santé mentale. Une pause de cinq jours de détente était prévue à la fin des déploiements opérationnels, pour permettre aux professionnels de la santé mentale de dépister les problèmes chez les soldats avant leur retour au Canada.
Le programme d’éducation et de formation des Forces sur les BSO devrait avoir touché environ 15 000 militaires à la fin de l’année. « Plus de 80 p. 100 de ceux qui pourraient bénéficier d’une aide en santé mentale ne savent pas qu’ils en ont besoin », dit le sergent Doug Brown à une vingtaine de jeunes officiers lors d’une classe sur les BSO dans le cadre de leur premier programme de formation officiel. Les cours sur les BSO sont donnés par le Bureau des conférenciers conjoints de la Santé mentale et des Blessures de stress opérationnel, un organisme créé en 2007 par les Forces et ACC. Les cours sont donnés par des équipes de militaires et d’anciens combattants souffrant de BSO. Le personnel militaire de tous les grades apprend à déceler les BSO, à supporter le stress, à aider les autres à supporter un évènement traumatique, à combattre l’infamie. On lui raconte aussi l’histoire d’un soldat ou d’un ancien combattant qui a eu une BSO.
« Cette campagne éducative est le fondement », dit le lieutenant-colonel Stéphane Grenier, un conseiller spécial des Forces sur les BSO chargé d’élaborer une stratégie d’éducation nationale. À la fin de l’année, dit-il, la formation pré- et post-déploiement comprendra une composante sur la santé mentale.
Combattre l’idée fausse comme quoi tous ceux qui souffrent d’un traumatisme lors d’une affectation opérationnelle vont souffrir de BSO est encore une bataille. « Déploiement n’égale pas traumatisme. Le déploiement est une bonne chose pour un militaire, qui a été bien préparé et entrainé », dit Grenier.
Les préparatifs et l’entrainement concernant les BSO n’existaient pas au début de sa carrière, dit le lieutenant-colonel Rakesh Jetly, psychiatre et conseiller en santé mentale chargé de surveiller les problèmes cliniques des BSO. Il n’y avait « pratiquement aucun (soutien) au chapitre de la santé mentale. Après le Rwanda […] de retour à Ottawa, on nous remettait notre trousse et on nous donnait congé en moins de 20 heures. […] Il y a des gens qui tombaient malades; il y a des gens qui se suicidaient. » Les recherches sur les gens souffrant de BSO indiquent que presque la moitié pensent au suicide et qu’environ 19 p. 100 s’y essaient. Maintenant, il y a une formation pré-déploiement et « des services de santé mentale énergiques dans le théâtre […]. La moitié (de ceux qui sont affectés par un traumatisme) se font déjà soigner » lorsqu’ils reviennent, dit-il. Cela va être payant : une étude des victimes de la guerre du Liban de 1982 indique que, même 20 ans après, les taux de SSPT et de symptômes psychiatriques sont inférieurs chez ceux qui se sont fait soigner au front. Ils sont aussi moins seuls et fonctionnent mieux en société.
L’éducation aussi donne des résultats. « Autrefois, les gens attendaient entre quatre et sept ans après le commencement des symptômes, quand leur vie commençait à être ruinée, avant de demander des traitements, dit Grenier. Maintenant, ils se font soigner plus vite. »
« C’est pas du tout vrai qu’on est libéré si on a été diagnostiqué », dit Jetly. Grenier a été promu plusieurs fois malgré le fait qu’il souffre d’une BSO lui-même. Souffrir d’une BSO ne signifie pas nécessairement qu’on est renvoyé au Canada pendant une mission. « Dans le théâtre, si quelqu’un a des difficultés, il peut se faire évaluer et commencer à se faire soigner […] il ne retourne pas obligatoirement chez lui. La grande majorité d’entre eux continuent leur affectation. C’est un message important pour les soldats », ajoute Jetly.
Le sergent Douglas Brown en est un exemple. Il lui a fallu 10 ans avant de demander de l’aide, et il a continué de travailler pendant cinq années de traitements. Au début, les séances de thérapie avaient lieu une fois par semaine, et puis une fois par mois et ensuite tous les deux mois, et il lui arrive encore de demander de l’aide à l’occasion. « On a des hauts et des bas », nous explique-t-il. Quand on obtient de l’aide au bon moment, cela empêche les petits problèmes de devenir des gros problèmes. « Le fait est que quand on souffre de SSPT, c’est pour la vie, dit Passey. Il y a des gens qui ont eu une rémission et qui ont été envoyé en mission, mais c’est comme le diabète. Quand on l’a, il est toujours en arrière-plan même si on ne ressent pas les symptômes. Je vais toujours avoir besoin de l’aide de quelqu’un pour rester stable, dit Brown. Quand on a un bas […] c’est soit qu’on oublie quelque chose qu’on nous a enseigné, soit qu’on n’a pas l’aptitude nécessaire, alors on a besoin d’aide. »
Toutefois, si à la fin du traitement, la BSO empêche quelqu’un de se conformer à la stipulation concernant l’universalité de service — une politique des Forces qui exige que les membres soient « physiquement en forme, employables et déployables pour les fonctions opérationnelles » — il pourrait être libéré pour raison médicale. Clarke risquait de l’être. Heureusement, il a obtenu un poste de SSBSO à Terre-Neuve, alors ses compétences et son expérience ne seront pas entièrement perdues pour les militaires en service.
Oui, les Forces vont mieux, dit Dallaire. « Mais nos systèmes ne sont pas aussi sophistiqués qu’ils devraient l’être. » Les soldats continuent de souffrir de BSO et ceux qui « passent entre les mailles du filet » sont souvent dans l’esprit du public; en partie, dit Jetly, parce que ceux qui se font soigner et continuent de travailler ne se font guère remarquer. Non seulement l’anonymat est-il maintenu, mais « nous n’exploitons pas nos patients » pour des interviews médiatiques.
Les gens ayant eu des mauvaises expériences qui acceptent de parler ne manquent pas. Même en continuant les améliorations, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet et les condamnations se poursuivent. En 2007, le Vérificateur général du Canada a rapporté que, dans les Forces, « la demande de soins de santé mentale dépasse les ressources courantes ». Il était déclaré dans ce même rapport du Vérificateur général que le MDN « n’avait pas de cadre de mesure du rendement capable de donner des renseignements fiables à savoir comment le système de soins de santé fonctionne ».
Le système de santé des Forces, ajoutait le rapport, « utilise encore des dossiers médicaux sur papier. Par conséquent, à moins que le Ministère ne déploie des efforts considérables pour recueillir des données dossier par dossier, il s’avère très difficile de fournir à la direction de l’information générale sur la santé pour fins d’analyse ou de contrôle ».
Le protecteur du citoyen du MDN et le Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes se sont dits frustrés que les Forces ne puissent donner des chiffres exacts sur le SSPT. En 2008, le protecteur du citoyen du MDN déplorait l’absence d’une base de données nationale permettant de jauger l’importance du problème, d’établir les besoins de services et de mesurer l’efficacité des programmes. Le Système d’information de santé des Forces canadiennes, un projet qui a débuté en 1999, ne doit être en ligne qu’en 2011, l’année où l’engagement en Afghanistan touchera à sa fin.
Le comité permanent a extrapolé la fréquence de SSPT en se fondant sur 8 200 questionnaires remplis par des soldats dans les six mois après leur retour d’Afghanistan. Les chiffres indiquent que 27 p. 100 sont revenus avec des problèmes, y compris le SSPT, la dépression et la consommation abusive d’alcool. Étant donné que 27 000 militaires ont déjà servi en Afghanistan, il se pourrait que quelque 3 640 d’entre eux souffrent de troubles mentaux.
Le nombre de BSO qui ne sont pas liées à la mission afghane pourraient vraiment gonfler ce chiffre, comme celles qui ont eu lieu en service aux Balkans, en Somalie ou au Rwanda, ou bien celles qui sont dues à des traumatismes causés en service au Canada. Les chiffres ne comprennent pas non plus ceux dont les symptômes ne se manifestent pas (ou qui sont cachés) pendant le service. ACC a actuellement quelque 12 000 clients qui ont une invalidité mentale, dont plus de 60 p. 100 souffrent de SSPT, dit Lalonde. Les Forces avaient en tout 4 917 cas liés à la santé mentale le 31 janvier 2008.
Les anciens combattants de la génération à qui on disait « d’arrêter de se plaindre » viennent encore demander des traitements pour les blessures qu’ils ont subies il y a 60 ans, dit Gerry Finlay, un agent du bureau d’entraide de la Division de l’Alberta–Territoires du Nord-Ouest. « Il y a ce facteur de fierté chez les anciens combattants les plus vieux. “Je faisais mon travail, pas plus que mes camarades.” Ils ne se plaignent pas ». Quand il leur parle à l’occasion d’une demande qu’ils font à ACC, Finlay écoute leurs histoires; comme celle d’un ancien combattant de 82 ans qui a passé la Seconde Guerre mondiale à s’occuper de déminage, de bombes qui n’avaient pas explosé et de pièges. Une évaluation psychiatrique que la Légion avait arrangée a indiqué que ce sapeur souffrait de SSPT depuis lors, et qu’il avait droit à une pension pour invalidité. Imaginez le soulagement, à 82 ans », dit Finlay.
Étant donné les décennies d’arriérés, l’apparition tardive des symptômes et les gens qui ne savent pas qu’ils ont besoin d’aide, il est difficile de connaitre l’étendue du problème. Un rapport de 2008 pour le directeur parlementaire du budget évalue les couts d’invalidité et de santé de la mission afghane à entre 476 millions et 1,7 milliard de dollars, dépendant des effectifs de l’année.
Le manque de données est une des raisons pour lesquelles des gens « passent à travers les mailles du filet », une expression qu’on entend si souvent lors des audiences qu’elle « en a perdu sa notoriété », remarquait le comité permanent dans son rapport de 2009 intitulé Pour de meilleurs soins : services de santé offerts au personnel des Forces canadiennes, en particulier dans le cas des SSPT. « Si les Canadiens s’attendent à ce que nos soldats fassent ce qu’on leur demande, ce n’est que justice que ces mêmes soldats puissent avoir confiance qu’on s’occupera d’eux s’ils se font blesser en service. »
Bien que les services de santé des Forces soient parmi les meilleurs au monde, dit le rapport du comité, il y a « des militaires ou des membres de leur famille qui n’ont pas reçu de soins adéquats ». Trois causes principales y sont distinguées : une brèche entre la politique et la mise en application, un manque chronique de professionnels de la santé, et l’infamie.
Dallaire dit que le rythme opérationnel est une cause importante de la brèche liée à la mise en application. Il n’y a tout simplement pas assez de personnel, dit-il. L’effectif de la force régulière est d’environ 66 000 personnes aujourd’hui, qui était de presque 90 000 au début des années 1990. Un rapport fait par le protecteur du citoyen du MDN en décembre 2008 déclarait que les Forces et ses membres « sont stressés au point de rompre » à cause de l’augmentation importante de l’intensité des opérations de combat. (Les Forces sont en train de recruter, dont l’objectif est un effectif de 100 000 personnes, 70 000 réguliers et 30 000 réservistes, en 2027.)
« Il y a actuellement des soldats canadiens qui ont plus d’expérience du combat que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale », dit Dallaire. Quand les garnisons n’ont pas suffisamment de personnel, le roulement des membres est plus rapide et ceux qui sont laissés derrière « font le travail de deux, trois, ou même quatre personnes ». Étant donné la nature de la guerre et des ennemis d’aujourd’hui, les soldats sont constamment en état d’alerte lorsqu’en opération et ils sont incessamment sous les projecteurs des médias.
Quand on demande si le niveau des effectifs est suffisant pour accomplir les missions aisément, on nous répond que les Forces procèdent à une vérification avant les opérations pour s’assurer que « le personnel, l’équipement et les ressources requis sont en place pour la durée de la mission. Bien que nous ayons ressenti de la tension en ce qui a trait à certaines professions et à certaines capacités, nous nous sommes acquittés de nos obligations avec notre personnel actuel ».
D’après la politique actuelle, un membre des Forces qui revient d’une affectation de 180 jours ou plus ne peut pas être sujet à une autre affectation semblable avant un an; on donne un répit de 60 jours aux membres qui ont été déployés pendant au moins six mois. Pendant ce temps-là, ils sont exemptés de poste, d’exercice, de cours ou de devoirs temporaires qui les obligeraient à s’éloigner de chez eux pendant plus d’une journée. Le taux de SSPT et de stress dû à un incident grave commence à grimper en flèche au bout de 210 jours à l’extérieur de chez soi. « Les membres qui passent plus de temps à l’extérieur risquent davantage de souffrir de SSPT », est-il dit dans l’étude PERSTEMPO de 2007, laquelle sert à analyser les facteurs qui affectent le moral des troupes.
« Normalement, on ne demande pas aux membres des Forces d’accepter un déploiement à une affectation opérationnelle de six ou 12 mois plus d’une fois en trois ans, poursuivait la réponse des Forces. Cependant, quand on tient compte des exigences opérationnelles et de la capacité de roulement de l’unité, cet objectif n’est pas toujours atteignable. »
Les commandants peuvent « déroger aux intervalles de déploiement s’il y a un besoin opérationnel ». Depuis 2006, les Forces ont un système qui sert à tenir compte du temps que les militaires passent loin de chez eux, une information qui sert à identifier les professions trop chargées et à partager la charge des déploiements de manière équitable. Les Forces « sont décidées à équilibrer le rythme opérationnel actuel d’après les besoins de leurs membres et de leurs familles », en reconnaissant que les déploiements, l’entrainement, les cours et les fonctions temporaires impliquent de lourdes charges pour les familles.
La politique semble avoir bonne allure sur le papier, mais il est dit dans le rapport Pour de meilleurs soins que « le problème principal des Forces est le manque de personnel, presque partout, presque toujours ». Il décrivait l’expérience d’une unité pendant une affectation de sept mois, en 2007. Certains sont tombés malades de retour chez eux, en congé, et ils ne l’ont pas rapporté quand ils ont repris le service; et puis ils sont retournés à un moment où l’on a demandé aux sous-officiers de suppléer aux postes d’entrainement d’officiers affectés outre-mer, pendant la saison des affectations, quand les leaders étaient assignés à de nouveaux postes, à divers endroits. Juste quand on a le plus besoin de superviseurs pour déceler et traiter les BSO, dit le rapport, leurs rangs sont « dispersés à cause des charges et des postes ».
Le sergent Ted Peacock du 1er Régiment du génie de combat d’Edmonton, qui a été sujet à cinq affectations — au Kuwait, en Iraq, en Croatie/Bosnie et en Afghanistan — en 2004-2005 et en 2006-2007, a été victime du rythme. Il avait déjà demandé un emploi moins mouvementé, en 2007, après le congé subséquent à son tour en Afghanistan, mais on lui répondit qu’il serait parti pendant le mois de juin. Pendant les trois semaines du mois de mai passées au travail, il était parti huit jours. Ensuite, son congé d’été a été annulé et ce fut plus qu’il ne pouvait supporter. Un jour, il a demandé à son épouse de ne pas ramener leurs petits garçons à la maison parce qu’il ne voulait pas qu’ils le voient dans l’état où il se trouvait. Il avait détruit son atelier, auquel il tenait tant et il ne pouvait s’empêcher de pleurer. Ensuite, il s’est mis à passer des journées entières au lit.
Son épouse Angelle a été surprise d’apprendre qu’on l’avait diagnostiqué deux ans auparavant comme souffrant d’un trouble d’adaptation. « Je comprends que tout le monde est surmené, mais il avait été diagnostiqué il y avait deux ans […] et qu’ont-ils fait? Ils l’ont envoyé prendre un cours et puis ils l’ont envoyé à l’entrainement. » Il n’a pas été soigné à ce moment-là. « Je ne tiens pas l’armée entièrement responsable », dit-elle. Pour Ted, le devoir passait toujours en premier. « Une grande partie est due aux affectations, au rythme, à la vie. » Cet été, on l’a envoyé à une thérapie de patient hospitalisé pour dépression, trouble d’adaptation et SSPT.
Les soldats comme Philip et Ted ne pensaient pas à l’autonomie en matière de santé comme étant une partie de leurs fonctions. Cela ne faisait simplement pas partie de leur culture militaire. « Sans une direction forte et engagée, les modifications à la culture sont bien plus difficiles à effectuer et elles prennent plus longtemps, dit la protectrice du citoyen par intérim du MDN d’alors Mary McFadyen. « Le leadership mitigé a des conséquences réelles, des fois dévastatrices, pour les particuliers. »
Un rapport récent du Comité de la défense de la Chambre des communes a exalté le progrès identifié dans un sondage des Forces, mené de 2006 à 2008, qui indiquait que 80 p. 100 des sondés n’étaient pas d’accord avec « l’infamie stéréotypée ». Le sondage a aussi montré que la plupart des militaires ne croient pas que les gens qui souffrent de troubles de santé mentale sont faibles ou que leur carrière sera affectée. Il s’agit de tout un contraste par rapport au sondage de 8 441 soldats, mené en 2002, où quatre sur 10 de ceux qui avaient besoin d’aide psychologique refusaient d’en demander.
Mais, remarquant que « les attitudes concernant les problèmes de santé mentale dans les Forces sont toujours principalement mauvaises », le comité a recommandé au ministre de la Défense et au chef d’état-major de la défense de faire ensemble une annonce publique à tous les membres des Forces canadiennes, afin de décrire les efforts importants qui sont faits pour vaincre l’infamie.
La semaine suivante, Natynczyk lançait la campagne de conscientisation sur la santé mentale. Dans un vidéo, sur le site Web forces.gc.ca, il s’adresse au personnel des Forces. « Ce sont ceux qui ont eu de l’aide des collègues et des leaders de leur unité qui ont les meilleures chances de reprendre du service. Je m’attends à ce que les leaders de tous les niveaux créent une atmosphère de compréhension, d’acceptation et de soutien […]. »
Le Bureau des conférenciers conjoints et le SSVSO sont considérés comme les piliers de la campagne Soyez la différence. En même temps, l’unité interarmées de soutien au personnel (UISP), qui a été conçue pour rapetisser certaines des mailles du filet, offre des avantages et du soutien au personnel militaire malade ou blessé et à leurs familles. Grâce à ses 19 Centres intégrés de soutien au personnel (CISP) à travers le pays, l’UISP permet aux militaires d’avoir accès aux mêmes normes de soins, sans tenir compte du service ou du lieu.
Les CISP sont une immense amélioration par rapport à l’ancien système, dit le lieutenant-colonel Joe Pollock, commandant du CISP pour la région de l’Alberta et du Nord du Canada. Le premier CISP a été établi à la BFC Edmonton, en mars. « C’est un progrès révolutionnaire en ce qui a trait au soutien qu’on leur procure », dit-il. L’ancien système était compliqué et désordonné, ajoute-t-il, et « maintenant, il est coordonné et les programmes et les services des Forces et d’ACC sont sous un même toit : les travailleurs sociaux, les thérapeutes, les gestionnaires de cas, le SSVSO et le Centre de ressources pour les familles des militaires […]. Il y a aussi 14 employés d’ACC, un aumônier — et la Légion royale canadienne. Autrefois, tous ces experts étaient dispersés de tous côtés. » Maintenant, quand quelqu’un est affecté à un CISP, une équipe s’occupe du dossier ensemble, qui décide qui va faire quoi et quand.
On espère que ces services vont les aider à conserver le personnel. Par exemple, la formation d’un fantassin coute environ 315 000 $ : un investissement qui pourrait être gaspillé s’il perd confiance et quitte le service. Il y avait un simple soldat de 23 ans, blessé sérieusement à la tête lors d’un accident véhiculaire en Afghanistan, qui a été ramené chez lui. On lui a diagnostiqué un syndrome post-commotion cérébrale et un trouble anxieux. Pendant qu’il récupérait, son unité a aussi été ramenée au Canada, mais les formalités administratives ont retardé le dossier qui l’aurait ramené à son unité. Il a été affecté à la section des « “débiles”, avec les autres personnes brisées ». Ensuite, il a eu une expérience humiliante, quand il est passé à côté de ses amis qui se mettaient en ligne au peloton alors que, lui, il servait du café et des pâtisseries à des officiers. « C’est pas pour ça que je me suis engagé. »
Il décida de démissionner, bien qu’il restait encore neuf mois à son contrat. « Qu’est-ce qui arriverait si j’étais blessé encore? Où est-ce qu’on m’enverrait… à la section des débiles encore? »
Les soldats blessés, affectés idéalement à un CISP près de leur famille, ont dorénavant l’appui d’une unité traditionnelle pendant qu’ils guérissent et qu’ils reprennent des forces, ainsi que l’accès aux programmes et aux avantages des partenaires des services, dont les services de transition et des clients d’ACC, le régime d’assurance-revenu militaire (RARM), les centres de ressources pour les familles des militaires. Les CISP leur offrent une transition vers leur unité régulière ou vers la vie civile.
Peacock, par exemple, a été affecté au CISP d’Edmonton, qui avait déjà servi en ce qui a trait aux formalités administratives et à la réduction du nombre de déplacements à la base. Quand il sera prêt, le programme de travail intégré l’aidera à retourner à l’école ou à se préparer à travailler : « on est encore venu à mon secours tant qu’on a pu ».
« La grande différence entre les années 1990 et cette décennie, c’est le soutien, dit Passey. Le manque de soutien peut être tout aussi traumatisant que l’évènement lui-même », dit-il. Le soutien est très important pour l’endurance, ce qui est crucial quand il s’agit de se protéger des BSO. « Je pense que les Forces vont bien mieux. »
BESOIN D’AIDE?
Le Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes et la ligne d’écoute 24 heures par jour d’Anciens combattants Canada : les deux offrent de l’aide psychosociale 24 heures par jour, à longueur d’année. 1-800-268-7708.
Centres de soutien pour traumatisme et stress opérationnel des Forces canadiennes : Ces centres sont situés partout au Canada et les informations pour communiquer avec eux se trouvent en passant par le lien des services de santé mentale des Forces canadiennes à http://www.forces.gc.ca/health-sante/ps/mh-sm/otssc-cstso/default-fra.asp
Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles, du ministère de la Défense nationale : Il offre des renseignements et des services aux militaires et aux anciens combattants malades ou blessés et à leurs familles. 1-800-883-6094
Soutien social aux victimes de stress opérationnel (SSVSO) : Ce réseau de services est offert aux membres en service et aux anciens combattants (ainsi qu’à la Gendarmerie royale du Canada) et à leurs familles. Il offre un soutien aux pairs, aux familles et de deuil. www.osiss.ca
Cliniques de traumatismes de stress opérationnel d’Anciens combattants Canada : Les renseignements pour communiquer avec les cliniques se trouvent à l’en-tête Santé mentale à www.vac-acc.gc.ca/clientele
Légion royale canadienne : La plus grande organisation de service au Canada, elle a des officiers d’entraide dans tous les coins du pays. Ils se trouvent aux filiales et aux bureaux divisionnaires de la Légion d’un océan à l’autre, ainsi qu’au quartier général, à Kanata (Ont.). Appelez sans frais au 1-877-534-4666 ou consultez www.legion.ca et passez par Bureau d’entraide. Les traumatismes de stress opérationnel, comme par exemple la dépression et le trouble de stress post-traumatique, peuvent donner droit à des avantages d’invalidité ou à une pension. Les agents d’entraide des divisions ou de la direction nationale assistent et représentent les anciens combattants en ce qui a trait à la procédure des demandes. Point n’est besoin d’être membre de la Légion pour obtenir de l’aide.