
En 1917, on promit aux combattants du Canada que le gouvernement s’occuperait des survivants et des blessés. Cette promesse mena à la Loi sur les pensions.
Il y a cent ans, l’adoption de la Loi sur les pensions créa un cadre pour l’aide aux anciens combattants handicapés du Canada. Encore aujourd’hui, c’est elle qui régit les prestations offertes aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la Gendarmerie royale du Canada et de la force régulière qui en ont fait la demande avant 2006.
La Loi sur les pensions comblait un vide, et c’était la façon dont le premier ministre Robert Borden tenait une promesse qu’il avait faite aux militaires du Corps canadien en avril 1917, peu de temps avant la capture héroïque de la crête de Vimy, en France.
« Le gouvernement et le pays considèreront comme leur premier devoir de veiller à ce qu’une juste appréciation de vos efforts et de votre courage soit portée à la connaissance des gens du pays, avait-il dit. Aucun homme, qu’il revienne des Flandres ou qu’il y reste, n’aura de raison valable de reprocher au gouvernement d’avoir abandonné à leur sort les hommes qui ont remporté la victoire et ceux qui ont perdu la vie. »
La promesse avait été faite sans vraiment savoir ce que signifiait « une juste appréciation ». Le gouvernement conservateur de Borden, puis son gouvernement de coalition, après 1917, fut submergé par l’impact de la Première Guerre mondiale sur le Canada. 620 000 hommes et femmes s’enrôlèrent, sur une population de 7,8 millions d’habitants. Environ 66 600 d’entre eux y laissèrent la vie et plus de 172 000 furent blessés ou estropiés.

Le Canada n’avait pas de processus de pensions officiel. Les vétérans de la guerre de 1812, de la rébellion du Nord-Ouest et des raids des Féniens avaient été payés en certificats qui pouvaient servir à acheter des terres pour créer des fermes dans ce qui semblait être à l’époque une quantité infinie de terres inutilisées au Canada. Les pensions qui existaient dépendaient souvent du grade et de faveurs politiques.
Vu le grand nombre d’hommes qui s’enrôlèrent, les familles qu’ils laissaient au pays furent les premières à se trouver dans le besoin.
En aout 1914, sir Herbert Ames, riche homme d’affaires de Montréal et député, créa le Fonds patriotique canadien pour aider les familles des hommes en service actif et de ceux qui étaient handicapés en revenant de la guerre.
Un réseau de bénévoles fut mis sur pied pour visiter les foyers et évaluer les besoins. Une épouse pouvait recevoir de 5 $ à 10 $ par mois, et de 1,50 $ à 6 $ par enfant.
Ces bénévoles se faisaient travailleurs sociaux et donnaient des conseils, qu’on les leur demande ou pas, sur la préparation d’un budget, les soins aux enfants, la nutrition et l’hygiène. Cela se faisait selon des normes morales élevées. Tout ménage jugé indigne pouvait être exclu du programme, sans appel.
En 1915, le gouvernement créa la Commission des hôpitaux militaires (CHM) pour servir les anciens combattants blessés ou malades. Le sénateur James Lougheed, leader du gouvernement au Sénat, en était le ministre responsable. Des édifices furent acquis et transformés en hôpitaux. Une usine fut construite à Toronto pour produire des prothèses.
Les anciens combattants qui avaient la tuberculose à leur retour furent envoyés à des sanatoriums, souvent à la campagne ou l’air était plus pur, disait-on.
Le public ressentait de la sympathie pour les aveugles et les amputés, mais ceux qui avaient des problèmes de santé mentale, ceux qu’on appelait alors les commotionnés, étaient laissés aux soins de leur famille. S’ils n’avaient pas de famille ou si elle ne pouvait pas s’en occuper, ils étaient envoyés aux institutions pour malades mentaux ou déficients intellectuels.
La véritable préoccupation du gouvernement était de faire en sorte que tous ces soldats qui revenaient puissent réintégrer la vie civile, qu’ils reprennent leur emploi pour gagner leur vie par eux-mêmes.
Il y aurait des pensions pour ceux qui avaient un handicap attribué au service militaire, mais elles ne devaient servir à les aider que pendant qu’ils retournaient à leur ancien travail si possible. Dans le cas contraire, une formation de reconversion serait offerte gratuitement.
La philosophie fut résumée dans une affiche d’information produite par la Commission des hôpitaux militaires intitulée What every disabled soldier should know (ce que tout soldat handicapé devrait savoir, NDT). Elle était pleine de maximes optimistes, et même inspirantes (traductions) :
• Qu’il n’y a pas de mot comme « impossible » dans son dictionnaire.
• Que son ambition naturelle de bien gagner sa vie peut être assouvie.
• Que le Service de santé de l’armée canadienne et la Commission des hôpitaux militaires existent pour l’assister dans cette tâche.
• Qu’il doit leur faciliter le travail.
• Que les soins qu’il aura seront les meilleurs et les plus efficaces dont la science est capable.
• Que si son handicap l’empêche de retourner à son ancien travail, il sera formé gratuitement à un nouveau métier.
• Que sa propre volonté et sa détermination lui permettront de réussir.
Dans la liste de promesses, on lisait aussi « que chaque homme handicapé par le service recevra une pension ou une gratification proportionnelle à son handicap ».

Le Canada ne s’étant jamais engagé dans une telle voie, il dut voir à l’étranger ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Les États-Unis étaient passés par la guerre civile plus de 50 ans auparavant et ils versaient toujours des pensions. Borden envoya à Washington le lieutenant-colonel George Adami, professeur de pathologie à l’Université McGill de Montréal, et mentor de John McCrae, pour étudier les pensions militaires.
Un des problèmes dont le gouvernement canadien avait peur, c’était les « veuves à pension », c’est-à-dire les femmes qui épousaient un ancien combattant vieillissant et qui avaient donc droit à une pension à vie après le décès de leur mari. Le dernier soldat américain ayant pris part à la guerre de 1812 mourut en 1905, mais le gouvernement payait encore des pensions aux veuves de cette guerre. La dernière veuve d’un vétéran de 1812 mourut pendant la guerre de Corée.
Le major John Todd, médecin et professeur à l’Université McGill, examina les pensions militaires d’autres pays. Pendant la guerre, il fut affecté au Pensions and Claims Board en Angleterre, le comité des réclamations et des pensions que présidait l’homme d’affaires sir Montagu Allan.
Dans une lettre au Canada, Todd écrivit : « La question la plus grave au Canada, à l’heure actuelle, c’est la question des pensions. Si elle n’est pas retirée de la politique et mise entre les mains d’une commission d’environ trois hommes, nous aurons des problèmes en la matière qui, à notre échelle, fera sembler dérisoires ceux des États-Unis. »
Todd apprit que la France permettait à ses anciens combattants de gagner de l’argent en plus de leur pension, ce qui était considéré comme étant une incitation au travail, alors qu’en Grande-Bretagne, le montant des pensions diminuait à mesure que les revenus des bénéficiaires augmentaient. Il considérait cela comme une incitation à l’oisiveté.
Todd croyait que les pensions devaient compenser le handicap et non pas la perte de revenu. Il devait y avoir des lignes directrices pratiques. La France avait mis en place une table des invalidités fondée sur la science. Un handicap de 100 % serait accordé en cas de perte des deux bras ou des deux jambes, ou des yeux. Un seul œil ou le bas d’une jambe, c’était un handicap de 40 %. La perte des organes reproducteurs était évaluée à 60 %.
Todd produisit un rapport suggérant un système dépourvu de considérations émotionnelles et de patronage. Allan l’envoya à Ottawa, où un comité parlementaire était aux prises avec les mêmes problèmes.
Le rapport fut accepté pratiquement dans son intégralité et le 3 juin 1916 fut créé le Bureau des commissaires des pensions qui se composait de trois personnes. Le Bureau était présidé par le millionnaire montréalais JKL Ross, et Todd et le lieutenant-colonel RH Labatt, membre de la famille de la brasserie du même nom, étaient les deux autres commissaires.
La commission mit en place un bureau à Ottawa et embaucha des professionnels de la santé pour examiner les rapports de médecins et les comparer au dossier médical du demandeur. L’historien Desmond Morton fit remarquer que les examinateurs « pourraient également vérifier s’il y avait quelque invalidité avant l’enrôlement ou des indications d’inconduite ». À titre d’exemple, il écrivit qu’on refusait la pension à la veuve d’un soldat qui s’était noyé parce que le soldat avait nagé en dehors des limites. La maladies vénériennes étaient aussi un motif de refus.
« En 1917, Todd avait mis en place un système pour sauver le Canada de son propre ‘mal des pensions’, écrivit Morton. Si le Parlement donnait aux soldats canadiens les taux de pension les plus hauts du monde, Todd rendait cette générosité facile. A peine 5 % des pensionnés bénéficiaient d’un taux de 100 %; la plupart moins de 25 %. »
Les anciens combattants s’aperçurent bien vite que le système les désavantageait.
Les hommes politiques de toutes les allégeances étaient désireux d’obtenir la faveur des anciens combattants, mais ils faisaient face à une myriade d’opinions. Il y avait les Army and Navy Veterans in Canada, précurseurs des Army, Navy and Air Force Veterans of Canada (ANAVETS), mais il y avait aussi des dizaines d’associations régimentaires qui établissaient chacune leurs propres listes de priorités. Les Amputés de guerre du Canada avaient été formés pour s’occuper des besoins particuliers de ceux qui avaient perdu un membre. Dans les sanatoriums, les anciens combattants tuberculeux avaient formé un réseau de chapitres.
En 1917, une commission parlementaire avait entendu divers groupes d’anciens combattants. L’augmentation du montant des pensions était le seul objectif commun à ceux qui avaient comparu.
Plus tôt cette année-là, la Great War Veterans Association (GWVA) avait été formée. Elle devint rapidement la plus grande association d’anciens combattants et elle parvint à unifier plusieurs organi-sations, créant ce qui allait devenir la Légion royale canadienne.

En 1918, la Commission des hôpitaux militaires devint le ministère du Rétablissement civil des soldats, dont Lougheed était le ministre responsable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ministère fut rebaptisé ministère des Anciens combattants.
Après l’armistice, le Parlement conclut qu’il était nécessaire de créer une loi pour entériner son régime de pensions. Un comité spécial fut formé. La GWVA, qui avait pour secrétaire-trésorier le dynamique Grant MacNeil, avait grossi en nombre, et elle obtint la permission d’être entendue, d’appeler des témoins et de les interroger à l’audience.
La GWVA, qui ne reconnaissait pas de grade parmi ses membres, exigeait que les pensions soient égales, sans tenir compte du grade qu’avait l’ancien combattant quand il était en service.
L’avocat de la Commission des pensions Kenneth Archibald rédigea la loi, laquelle était longue de 30 pages et officialisait une grande partie de ce qui était déjà en place. Le projet de loi fut présenté au Parlement en juin et voté avant les vacances d’été, et la loi entra en vigueur le 1er septembre.
Un simple soldat totalement invalide recevrait 720 $ par année, une veuve, 570 $ et un premier enfant 180 $. « Jusqu’en décembre, quand le Congrès américain accrut les taux d’invalidité américains à un maximum de 1 200 $, les taux canadiens étaient les plus élevés dans le monde », écrit Morton.
Le Bureau des commissaires des pensions était devenu la Commission des pensions. Les commissaires avaient toujours le dernier mot. On considérait qu’un tribunal d’appel serait trop couteux et inutile.
Le lieutenant-colonel John Thompson était le nouveau président, mais il était aussi économe que ses prédécesseurs. Le ton très moralisateur resta intact. Une veuve fut privée de sa pension quand elle accueillit un pensionnaire mâle.
La Loi sur les pensions était loin d’être parfaite. MacNeil accusa la commission d’être biaisée. Lorsque le Parti libéral dirigé par Mackenzie King prit le pouvoir en 1921, il répondit aux plaintes des anciens combattants en créant une commission royale sur les pensions présidée par le ministre et éminent chef de guerre James Ralston. Son rapport accablant, en 1924, conduisit à divers changements, dont la mise en place d’un système d’appel adéquat et la création de ce qui est maintenant le Bureau de services juridiques des pensions.
La Loi sur les pensions, modifiée à de nombreuses reprises, existe depuis 100 ans. Bien que les anciens combattants soient maintenant couverts par la Loi sur le bienêtre des vétérans, la Loi sur les pensions sera toujours considérée comme le point d’origine pour des générations d’anciens combattants et pour ceux qui militent que leur service soit reconnu.
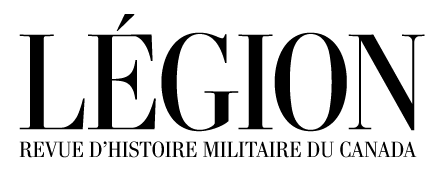
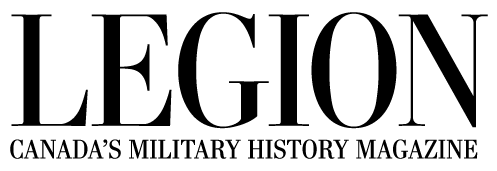







Comments are closed.