
Ce qu’on portait, disait et mangeait au front pendant la Seconde Guerre mondiale
Sept-cent-cinquante-mille Canadiens ont porté l’uniforme kaki à la Seconde Guerre mondiale. Des hommes de toutes les régions du pays se sont soudainement retrouvés dans des baraquements où ils apprenaient à devenir soldats. La transition n’était pas facile, ils devaient apprendre à défiler, à tirer et à combattre. Les dizaines de milliers d’entre eux qui ont pris part aux combats ont dû s’habituer à la violence et à la mort. Voici un aperçu de ce qu’ils portaient, mangeaient et disaient au front.
CE QU’ILS PORTAIENT
Tout d’abord, ils mirent leurs vêtements civils de côté. Tout comme en 1914, il n’y avait pas suffisamment d’uniformes pour les premières unités se préparant à partir pour l’étranger. Les bottes étaient en nombre insuffisant, et certaines unités n’avaient que des uniformes de la Grande Guerre sous la main. Toutefois, à partir de la fin de 1939, les soldats pouvaient porter une tenue canadienne qui était une version améliorée de la tenue de combat de conception britannique. Tous les soldats ont fini par en avoir une peu après. La chemise en serge de laine avait deux poches à la poitrine et un col boutonné. Le pantalon assorti avait des boucles pour la ceinture, des boutons pour les bretelles et des poches pour les cartes et le pansement de combat.
Bien repassé, et orné du rang, de l’unité et des insignes de formation, et agrémenté du nouveau béret réglementaire porté sur le côté, l’uniforme donnait belle allure. Les officiers supérieurs dont la tenue était faite sur mesure étaient encore plus élégants; et certains d’entre eux optaient même pour le barathéa, un tissu plus doux.
Bien que de bonne qualité, la tenue de combat était trop chaude en été et pas assez chaude par temps froid. Au combat, elle absorbait la saleté et la boue, et elle était trempée par temps pluvieux. Les militaires pouvaient la couvrir d’une capote ou d’une parka en hiver, parfois même d’un pourpoint en cuir, d’une veste en peau de mouton ou de survêtements de ski blancs.

Pendant les opérations, une unité de bain et blanchisserie mobile (MBLU) réussissait parfois à s’avancer suffisamment pour distribuer de nouveaux vêtements et permettre aux soldats en sueur, crasseux et parfois infestés de poux de se laver. Le major Stewart Bull de l’Essex Scottish Regiment a décrit l’arrivée d’une MBLU dans son unité, en Normandie : « et là, oh bonheur, il y avait une douche […]. Il y avait du savon à foison, et nous avons enfin pu nous sentir propres. Certains d’entre nous [avons reçu] des vêtements, des sous-vêtements et des chaussettes propres, et nous les avons mis […] c’était un vrai luxe, ce jour-là. »
À partir de 1943, les hommes portaient un béret sur le terrain, kaki pour la plupart, noir pour les unités blindées et brun rougeâtre pour les unités aéroportées. Au combat, les soldats portaient un casque d’acier avec mentonnière et filet de camouflage. Le casque, lourd et incommode, ne conférait aucune protection à la nuque (excepté contre la pluie) et rebondissait quand on courrait.
Les soldats à l’entrainement portaient des salopettes kaki ou en denim, comme en portaient les unités de blindés et celles qui s’occupaient des véhicules et des machines. L’uniforme d’été se composait habituellement d’une chemise et d’une culotte courte kaki. En hiver, les Canadiens s’habillaient pour être au chaud sur le terrain, beaucoup d’entre eux se procurant un pourpoint en cuir ou une veste en peau de mouton.
La tenue de combat était TROP CHAUDE EN ÉTÉ et PAS ASSEZ CHAUDE par temps froid.
Chaque homme avait un harnais à sangles modèle 1937, dont l’entretien exigeait l’application régulière du produit de nettoyage Blanco. À la ceinture et aux sangles sur les épaules, il y avait diverses poches pour les munitions, un petit paquet de premières nécessités, un étui de masque à gaz (souvent abandonné, car les soldats se sont aperçus que le gaz ne serait probablement pas utilisé contre eux), des sachets utilitaires pour des munitions supplémentaires, un brandebourg pour baïonnette et un compartiment pour pelle-pioche. Les officiers avaient un étui à jumelles, un étui à boussole et un étui à pistolet. Le gros havresac du soldat, conçu pour être porté sur le dos, mais généralement abandonné à l’arrière avec les véhicules de transport de l’unité, servait au matériel de couchage, aux couvertures, à la capote et au reste du matériel jugé inutile au combat.

Dans le feu de l’action, les soldats adaptaient leur matériel à ce qui fonctionnait le mieux. Chacun portait une charge de quelque 20 kilogrammes. Le simple soldat avait un fusil 0,303 Lee-Enfield No. 4 Mk I et une ou deux cartouchières en bandoulière contenant 50 cartouches chacune. Il portait habituellement un ou deux chargeurs de 30 cartouches pour les trois ou quatre mitrailleuses Bren de son peloton, au moins deux grenades n° 36 ou n° 69, et probablement des bombes de 2 livres pour le mortier de 2 pouces ou des projectiles de 3 livres pour l’arme antichar de la compagnie. Une bouteille d’eau et une baïonnette étaient accrochées à sa ceinture de toile; beaucoup portaient également un couteau.

Les servants de mitrailleuse Bren devaient trimballer leur arme qui pesait environ 10 kilogrammes, et les radios portaient l’encombrant appareil avec l’antenne révélatrice qui le surmontait. La plupart des sous-officiers avaient une mitraillette Sten; les officiers, une Sten et un révolver. En Italie, ce sont des Tommy (mitraillettes Thompson) qu’on utilisait.
Dans le petit sac du soldat se trouvait un tapis de sol, quelques boites de nourriture prélevées dans les paquets de rationnement, des biscuits de mer pour les urgences, des cigarettes, un briquet, une paire de chaussettes, une trousse de couture (surnommée « housewife » [ménagère, NDT]), des lunettes de secours, du cirage, des lacets, un nécessaire de rasage, une brosse à dents, un préservatif ou deux au cas où une occasion se présente-rait, des gamelles en aluminium, une tasse, un couteau de poche, une cuillère, une fourchette, le courrier, quelques photos, un jeu de cartes et un livret de solde.
Marcher, et même courir, en portant de telles charges, nécessitait une excellente condition physique et une grande endurance.
CE QU’ILS DISAIENT ET CHANTAIENT
Les soldats canadiens ont dû maîtriser le langage étrange de l’armée. Il y avait des abréviations militaires, comme SMR (sergent-major régimentaire), SQMC (sergent quartier-maître de compagnie), CO (commandant), SMC (sergent-major de compagnie) et adj (adjudant) – il s’agissait des officiers et des sous-off (sous-officiers) qui contrôlaient leur vie au jour le jour.
Il y avait des termes argotiques comme « Aldershit, » variante peu flatteuse du nom du camp d’entrainement Aldershot (shit signifiant merde, NDT) en Angleterre. Les Italiens étaient des « Eyties », les Allemands étaient des « Jerries » ou des « boches », et il y avait aussi le « Jerrican » qui servait au transport de l’essence ou de l’eau (parfois même, sans nettoyage intermédiaire). Les soldats espéraient qu’ils seraient « LOB » (laissés hors de la bataille, NDT) quand leur unité passerait à l’attaque. Un homme « LOB » était censé faire partie du noyau autour duquel une unité décimée serait reconstituée. « Snafu » était l’acronyme de Situation Normal : All Fucked Up (ou Fouled Up) (c’est-à-dire Situation normale : c’est la merde, NDT); « recce » se disait pour la reconnaissance; le « meathead » (tête de viande, NDT) était un prévôt ou un policier militaire; le « zombie » était un conscrit pour la défense au pays; un « ring knocker » (anneau heurtoir, NDT) était un diplômé du Collège militaire royal qui profitait de ses relations pour monter en grade.
Les jurons habituels étaient en usage constant, si bien qu’en Sicile, en aout 1943, l’aumônier des Seaforth Highlanders of Canada a tenté de choquer les soldats – pour qu’ils épurent leur langue –, en prononçant un juron particulièrement offensant dans le titre du sermon qu’il a prononcé lors d’un rassemblement pour service religieux obligatoire. Dans une lettre envoyée au pays, il est dit que cela avait donné lieu à « quelques rires nerveux », mais que rien n’avait changé à la longue :« La plupart des hommes mêlent des jurons à leur parler aussi naturellement qu’ils aspirent de l’air dans leurs poumons, et même peut-être sans vouloir mal faire. »
Au défilé, les soldats marchaient au rythme de la musique militaire. Certaines unités avaient apporté des instruments en cachette (il était interdit de les emporter outre-mer), puis ils les avaient sortis en Angleterre, quand la voie était libre. Les régiments de Highlanders avaient leurs cornemuseurs, bien sûr, et à Dieppe et le jour J, certaines unités ont débarqué au son des cornemuses. Cependant, dans les casernes, la plupart des soldats écoutaient les big bands de Benny Goodman ou de Glenn Miller à la radio, pleuraient discrètement quand Vera Lynn chantait The White Cliffs of Dover, ou fantasmaient sur l’extraordinaire Lili Marlene, qui était populaire chez les Alliés comme chez les Allemands. Parfois, le sentiment qu’ils se trouvaient à un front oublié faisait écrire des paroles ironiques aux soldats, comme « We are the D-Day Dodgers in sunny Italy (Nous sommes les tire-au-flanc du jour J, sous le soleil de l’Italie, NDT) ».
Il y avait aussi des spectacles produits par l’armée et mettant en vedette des artistes canadiens. Les comédiens Wayne et Shuster, par exemple, ont fait carrière au Canada, en Grande-Bretagne et près du front en Europe du Nord-Ouest avec le spectacle « The Army Show », fastueuse revue musicale et humo-ristique qui a eu beaucoup de succès.

CE QU’ILS MANGEAIENT
Les soldats étaient bien nourris, mais l’armée n’aspirait pas à la gastronomie. La plupart des soldats canadiens, ayant grandi pendant la dépression, n’avaient jamais connu la bonne chère et ils se contentaient probablement bien de la « bouffe » de l’armée.
Si les cuisiniers de compagnie ne pouvaient pas leur apporter leurs rations sur le terrain, les soldats se nourrissaient grâce au Composite Ration Pack : une caisse contenant assez de nourriture pour 14 hommes pendant 24 heures. Ces rations « compo », emballées en Grande-Bretagne, étaient constituées de biscuits durs, de margarine cireuse, de boites de viande et de légumes, de fromage, de thé, de confitures et de bonbons durs. Un des mets les plus convoitées était un pouding imbibé de mélasse. Il y avait également des allumettes, sept cigarettes pour chaque homme, de l’alcool solidifié, et six feuilles de papier hygiénique par soldat. Les rations n’étaient pas très bonnes, a raconté un soldat par la suite, « mais cela faisait l’affaire et nous survivions ».
Par contre, les bons cuisiniers de compagnie furetaient ici et là pour trouver de quoi enrichir les rations qu’on leur fournissait. Le SQMC faisait transporter la nourriture au front dans de grandes marmites de fer qui tenaient la nourriture au chaud. Le régime des hommes comprenait habituellement beaucoup de pain, de pommes de terre, de haricots et de viande et visait à leur donner au moins 3 000 calories par jour. Bien sûr, a écrit un canonnier avec un gros soupçon d’amertume au sujet de son service : « Nos intendants, les malheureux… se servaient toujours les premiers. »

Les soldats mangeaient « quand ils le pouvaient », a raconté un sergent des Cameron Highlanders. « Si vous aviez l’occasion de prendre un repas chaud, vous le faisiez … mais s’asseoir manger tranquillement, ça, non, ça n’arrivait jamais. Parfois vous aviez à peine le temps de prendre une bouchée et les boches se mettaient à vous bombarder, alors fini, le petit-déjeuner. »
Les soldats fouillaient aussi les maisons des civils à la recherche de nourriture, s’appropriant les comestibles (et autres objets de valeur) qu’ils y trouvaient. Un officier a écrit en Allemagne qu’il avait vu une estafette avec une dizaine de poulets attachés à l’arrière de sa moto, et « deux soldats tirant et poussant un cochon pendant qu’un autre affutait un couteau à une meule. »
Les officiers mangeaient parfois bien quand ils étaient à l’arrière, mais au front, leur ration était la même que celle de leurs hommes. Hal MacDonald du North Shore (New Brunswick) Regiment a écrit, le 22 juillet 1944 : « mon ordonnance est en train de faire frire des galettes de viande : Bully Beef, oignons, pommes de terre et biscuits de mer émiettés. »
La nourriture du mess des officiers, s’il était situé assez loin du front, était meilleure, les suppléments étant payés par le « fonds du mess » de ses membres, et il pouvait même y avoir un diner régimentaire à l’occasion.

Les colis provenant du pays étaient très prisés. Le soldat Geoff Turpin du Régiment royal de Montréal a écrit en Normandie : « J’ai énormément apprécié votre colis, comme vous vous en doutez certainement. C’était celui où il y avait l’assortiment […], le chocolat de Cunninghams, les barres de chocolat […] et les Life Savers […]. McBride (mon compagnon de trou) et moi faisons fondre le chocolat et y trempons les biscuits : des biscuits au chocolat! Ça fait aussi du bon chocolat chaud. »
Mais Turpin avait encore besoin de plusieurs choses de chez lui : « Le problème, en ce moment, ce sont les cigarettes parce que nous ne pouvons acheter que 60 anglaises par semaine. Très bon marché à 20 francs les 60. Mais ce sont toujours mes Winchester que j’affectionne. »
Les organismes de bienfaisance canadiens collectaient des fonds pour envoyer des cigarettes outre-mer, et les proches des soldats pouvaient envoyer 300 cigarettes pour seulement 1 $. Les cigarettes servaient de monnaie d’échange aux Pays-Bas et en Allemagne occupée, où un carton pouvait acheter presque n’importe quoi : des bijoux, des appareils photo Leica, même une prostituée.
Quelques âmes délicates NE POUVAIENT PAS SE RÉSOUDRE À BOIRE À MÊME LE GOULOT.
Parfois, l’armée faisait vraiment preuve d’initiative. À Arnhem, Pays-Bas, pendant l’hiver 1944-1945, quand la guerre semblait interminable, un officier de l’état-major du général Guy Simonds du IIe Corps canadien a organisé « The Blue Diamond », cantine dirigée par l’armée. « La boulangerie produira 2 000 petits pains, 100 tartes et 4 000 beignets par jour, » a écrit l’officier, et « le boucher va hacher assez de viande pour faire 2 000 hamburgers par jour; on utilise 700 livres d’ognons par semaine ». En fait, la cantine a connu un tel succès qu’elle a servi près de 6 000 hambur-gers par jour durant le premier mois.

L’autre préoccupation constante était l’eau. L’infrastructure locale d’approvisionnement en eau avait souvent été détruite et l’on craignait partout l’empoisonnement des réservoirs. Sur le terrain, les cours d’eau étaient bien souvent pleins de cadavres d’êtres humains et d’animaux. Les comprimés de purification donnaient à l’eau un fort mauvais gout. La seule eau véritablement potable provenait des camions-citernes du Corps de l’intendance de l’Armée, mais elle avait toujours un gout de chlore.
Les soldats recevaient de la bière à l’occasion, mais il n’y en avait jamais assez, et ils étaient toujours à la recherche d’alcool, s’appropriant les bouteilles qu’ils trouvaient dans les caches de l’ennemi ou dans les fermes et les maisons. Ils buvaient directement au goulot, se passant la bouteille entre camarades. Quelques âmes délicates ne pouvaient pas se résoudre à boire à même le goulot, et au moins un soldat a raconté qu’il rangeait soigneusement un gobelet de verre lourd dans son sac, l’enveloppant dans ses chaussettes supplémentaires, pour pouvoir boire avec un minimum de bienséance.
À la fin de la guerre, les soldats canadiens sont redevenus des civils. Est-ce qu’ils mangeaient mieux que dans l’armée? Pour la plupart, oui. Est-ce qu’ils juraient moins? Peut-être. Ont-ils oublié leur temps dans l’armée? Certains ont essayé, mais peu ont réussi à le faire. Ce qui est certain, c’est que le service en temps de guerre a marqué tous ceux qui y sont passés.


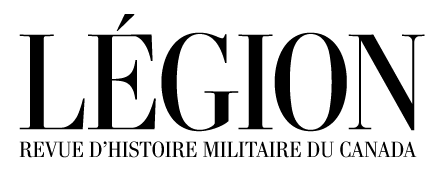
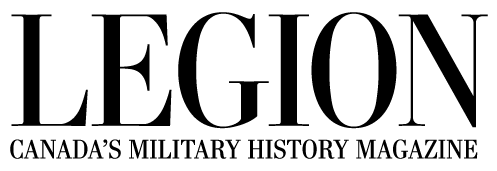







Comments are closed.