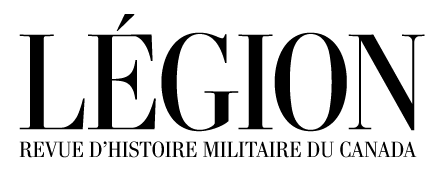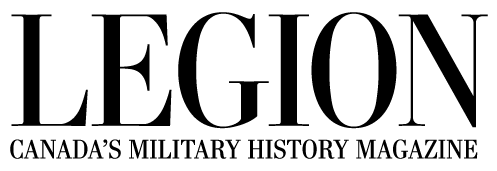![Le monument de la Porte de Menin sert à commémorer près de 55 000 soldats du Commonwealth britannique morts en Belgique dont le lieu du dernier repos est inconnu. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE] Le monument de la Porte de Menin sert à commémorer près de 55 000 soldats du Commonwealth britannique morts en Belgique dont le lieu du dernier repos est inconnu. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE]](../../en/wp-content/uploads/2010/11/BattlefieldsIntro1.jpg)
Le temps était parfait en France au mois d’aout : ciel bleu pour la photographie et nuages moroses pour la peinture. J’étais allée en Europe pour peindre.
Les musées de classe mondiale sont remplis de paysages champêtres normands et flamands. Cette terre a une riche production artistique et agricole. Mais elle est aussi chérie pour une tout autre raison.
C’est là que le monde entier est allé se battre, deux fois plutôt qu’une. Plus de 111 650 Canadiens sont morts aux deux guerres mondiales. Ils sont enterrés là-bas.
En tant qu’artiste, la juxtaposition de la guerre et de la paix m’intéresse. J’imagine les citoyens européens piqueniquant le long des mêmes côtes que les Canadiens ont prises d’assaut, occupés aux choses d’aujourd’hui sur les champs de bataille d’autrefois.
J’aimerais voir si le souvenir existe hors saison, quand personne ne sait que les invités arrivent.
L’air estival est frais. À huit kilomètres au nord-ouest de la ville médiévale d’Arras, en France, les ruines de Mont-Saint-Éloi s’élèvent au loin. Les tours fantomales servaient de poste d’observation aux alliés à la Première Guerre mondiale. C’est là que commence mon voyage.
Aujourd’hui, l’herbe et même les petits arbustes poussent dans les fissures en haut de la façade de pierres, et les pigeons que je dérange s’envolent de leur perchoir tranquille. De cette perspective, les deux pylônes blancs de Vimy sont visibles à l’horizon, au nord-est. Les Français sont sympathiques, serviables. « Toujours droit! », me disent-ils dans les villages et les communes aux maisons de brique rouge de Neuville-Saint-Vaast, Givenchy-en-Gohelle et, finalement, Vimy.
Aux premières lueurs de l’aube, le 9 avril 1917, les Canadiens lancèrent leur attaque à Vimy. Cinq jours après, ils avaient conquis plus de terrain que lors des offensives britanniques précédentes, mais le prix avait été élevé. Plus de 10 000 victimes, dont 3 598 morts. Or, la crête de Vimy est un monument de fierté nationale érigé en l’honneur du succès qui y a eu lieu et qui fait partie de ce qui nous lie en tant que nation.
Le monument massif qui s’élève devant moi brille trop. Je tourne autour, m’abritant les yeux de la main, et je tombe sur une dame âgée qui montre de la main les 11 285 noms gravés sur les murs : les noms des soldats disparus et présumés morts en France à la Première Guerre mondiale.
![Les ruines grises et silencieuses de l’abbaye du mont Saint-Éloi, près de la crête de Vimy. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE] Les ruines grises et silencieuses de l’abbaye du mont Saint-Éloi, près de la crête de Vimy. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE]](../../en/wp-content/uploads/2010/11/BattlefieldsInset1.jpg)
Anne-Marie Bourdrez habite le village avoisinant de Neuville-Saint-Vaast (le lieu du plus grand cimetière de guerre allemand en France) et se rend à Vimy à peu près une fois par mois. Avec l’aide de sa belle-fille, Alice, Anne-Marie m’explique : « Mon beau-père venait ici planter des arbres. Les arbres venaient du Canada. Un arbre par soldat : onze-mille soldats, onze-mille arbres… Les arbres ont grandi, touffus et pleins de branches, alors pendant 17 ans, mon mari est venu ici pendant les vacances pour les élaguer. ». En effet, le terrain est recouvert d’érables immaculés, élagués assez haut pour qu’on puisse bien voir le champ de bataille et les moutons qui y paissent. Dans quelques mois, les milliers d’érables vont devenir rouges, dorés ou orangés.
Il y a des tunnels à 20 mètres sous Arras, qu’on appelle les Boves, où la population s’est abritée pendant les bombardements. Les troupes alliées s’en servaient pour se rendre aux champs de bataille en secret. Juste avant l’assaut du 9 avril 1917, le système de tunnels abritait 24 000 hommes.
Le Mur des Fusillés se trouve au bord d’Arras, au bout d’un sentier ombragé. Il s’agit d’un mémorial dédié aux 218 patriotes français tués à l’extérieur de la citadelle par les occupants allemands entre 1941 et 1944.
Les tranchées de la Première Guerre mondiale s’étendent au nord jusqu’en Belgique, au saillant d’Ypres, où ont eu lieu certains des combats les plus féroces. La portée de l’artillerie allemande était de 10 kilomètres à partir du saillant; la ville de Poperinge s’en trouve à 11 kilomètres et la plupart des édifices semblent intacts. Poperinge est un endroit charmant et la maison Talbot, qui donne sur une rue pavée, n’est pas bien différente de ce qu’elle était lors de son ouverture, le 11 décembre 1915. C’est là que les soldats de la Première Guerre mondiale allaient se reposer du front, où ils buvaient du thé, du chocolat chaud ou du café, jouaient du piano, assistaient à des spectacles et allaient à la chapelle installée au grenier. J’ai passé quelques heures merveilleuses avec Simon Barber, le directeur de la maison Talbot. Il y est bénévole pendant deux semaines par année et il me dit qu’environ « 45 p. 100 des visiteurs ont un lien direct avec le souvenir et les autres y vont simplement pour s’imprégner de l’ambiance de la région. »
La ville d’Ypres est pleine de touristes venus gouter les chocolats et la bière. Le monument de la Porte de Menin est situé à un croisement, où chaque soir sans faute, à 20 heures, les citoyens s’assemblent pour rendre hommage aux morts. Cette cérémonie crépusculaire sert à commémorer ceux qui sont morts à la Première Guerre mondiale et dont le lieu du dernier repos est inconnu. Leurs noms ont été gravés dans le mur de pierres et le monument massif est entouré par des centaines de personnes qui écoutent tranquillement le dernier clairon.
![L’impressionnant mémorial de Saint-Julien, situé où les premières attaques au gaz de la Première Guerre mondiale ont fait des victimes canadiennes. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE] L’impressionnant mémorial de Saint-Julien, situé où les premières attaques au gaz de la Première Guerre mondiale ont fait des victimes canadiennes. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE]](../../en/wp-content/uploads/2010/11/BattlefieldsInset2.jpg)
Le dimanche matin, l’air me donne l’impression que septembre est arrivé et les odeurs se répandant dans les rues pavées me rappellent mon enfance. Aujourd’hui, je me mets à la recherche du « canadien », l’élégant Mémorial de Saint-Julien. Il s’agit d’un pilier en granite gris qui s’élève à 11 mètres, au sommet duquel a été sculpté un soldat canadien, tête penchée par en avant et les mains croisées sur une crosse de fusil. La veille, à la Porte de Menin, j’avais demandé à nombre de gens s’ils savaient exactement où il se trouvait. Les Belges m’avaient souri en disant : « Ah, oui; le beau, le canadien », mais ils ne m’avaient pas dirigée précisément.
Les terres cultivées de Flandre longent la route pittoresque jusqu’au petit village de Saint-Julien. Là, dans la campagne, à sept kilomètres d’Ypres, un fermier grand et mince d’une bonne soixante-dizaine d’années sort arroser ses plantes et dévisa-ger l’étrangère au bord de la route. Je m’approche de lui pour le saluer, et balbutie dans un français limité pour lui demander de m’indiquer le chemin du monument. Il continue d’arroser ses plantes, comme si je ne l’intéressais pas, ou comme s’il ne m’avait pas comprise. Puis il me demande comme si de rien n’était : « D’où viens-tu? d’Allemagne? » En entendant « Canada », il laisse son arrosoir et son anglais s’améliore. Il m’indique la direction de ses grandes mains bronzées. « À droite, à un kilomètre ou deux d’ici », dit-il. Et le voilà : mon mémorial préféré. Les 2 000 hommes de notre pays morts lors des premières attaques au gaz de la guerre sont commémorés ici. Il y a des conifères en forme de cône et sur des milles à la ronde s’étendent des champs comme dans les prairies du Manitoba.
Je me faufile dans ma petite voiture à travers les champs de maïs et de pommes de terre sur les routes de campagne de Passchendaele. Les maisons sont en briques, avec des jardins soignés et des rideaux blancs qui volent au vent dans les fenêtres ouvertes. Aux abords de la ville, il y a une petite affiche verte de la Commission des sépultures de guerre qui pointe un champ de maïs. C’est un peu surréel. Un tunnel d’un peu plus d’un mètre de haut a été creusé dans un champ. Une bande de gazon s’étend sur 90 mètres, à peu près comme un tapis vert. Ensuite, la bande étroite tourne à gauche et s’étend sur 15 mètres de plus. À part des corbeaux qui croassent et du froissement des tiges, tout est silence. Là, au milieu d’un champ de maïs, se trouve un monument dédié au 85e Bataillon (Nova Scotia Highlanders).
![La belle basilique restaurée – y compris sa statue dorée – à Albert, en France. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE] La belle basilique restaurée – y compris sa statue dorée – à Albert, en France. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE]](../../en/wp-content/uploads/2010/11/BattlefieldsInset3.jpg)
Cette petite clairière n’est qu’à quelques kilomètres du cimetière de Tyne Cot, le plus grand cimetière militaire du Commonwealth du monde. Sur les 12 000 morts qui y sont enterrés, il n’y en a qu’environ 3 500 qui ont été identifiés. Plus de 1 000 Canadiens s’y trouvent et des dizaines de personnes circulent parmi les tombes pour leur rendre hommage.
Cette partie du saillant s’étendait le plus vers les positions ennemies et les combats y ont été féroces. Les Canadiens y lancèrent leurs premières offensives planifiées en juin 1916. Nos soldats sont aussi commémorés à la côte 62 (Bois du Sanctuaire). Un garçon blond explore la colline avec ses grands-parents flamands. Ils l’emmènent à « beaucoup, beaucoup » de monuments situés dans cette région de Flandre et ils sont étonnés que je sois venue de si loin.
Le village d’Albert entoure une magnifique cathédrale dont le dôme du clocher est surmonté d’une statue de la Vierge soulevant son enfant à bout de bras. Pendant la Première Guerre mondiale, la ville a été bombardée jusqu’à en être presque ensevelie sous les décombres, mais le clocher et les murs de l’église sont restés debout. La vierge dorée, déstabilisée, pendait parallèlement au sol pendant la plus grande partie de la guerre. D’après la légende, la guerre se terminerait quand elle tomberait. Aujourd’hui, elle est à nouveau debout, offrant son bébé aux cieux et la basilique qu’elle couronne, reconstruite, est magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur.
Le premier jour de la bataille de la Somme fut le jour le plus sanglant de la Grande Guerre pour l’armée britannique. C’est un jour gravé dans la mémoire collective des Terre-Neuviens et honoré à Beaumont Hamel. Le 1er juillet 1916, 780 hommes du Newfoundland Regiment furent envoyés à l’assaut et, en moins d’une demi-heure, il n’en restait que 110. Les routes au nord et à l’est d’Albert sont surnommées le circuit du souvenir, une boucle qui passe par Beaumont Hamel, Thiepval et Courcelette avant de revenir à Albert. Les morts y sont commémorés partout.
Les noms de plus de 72 000 soldats du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud dont le lieu de sépulture est inconnu sont inscrits sur le monument de Thiepval.
![Le cimetière de fosse commune de Régina est situé sur un coteau paisible au-dessus du village français de Grandcourt. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE] Le cimetière de fosse commune de Régina est situé sur un coteau paisible au-dessus du village français de Grandcourt. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE]](../../en/wp-content/uploads/2010/11/BattlefieldsInset4.jpg)
Le temps change lors de mon passage. La pluie est froide et drue alors que je conduis le long d’une route en terre battue vers un autre champ de céréales à la recherche du cimetière de fosse commune de Régina, près de Courcelette. C’était la tranchée allemande la plus longue du front pendant la guerre. Il fallut deux mois d’attaques par les divisions canadiennes avant de tomber, le 11 novembre 1916, entre les mains de la 4e Division canadienne. Cinq-cent-soixante-quatre Canadiens y sont enterrés.
Un garçon d’à peu près 10 ans aux longs cheveux blonds et à la peau dorée saute de l’énorme tracteur qu’il conduit et m’aide à ouvrir la porte de fer mouillée. Il ne me dit qu’un seul mot : « Canada? ». J’acquiesce et il me sourit tout en m’indiquant d’un geste d’entrer. Ce cimetière se trouve en plein milieu du champ de céréales qu’il est en train de récolter. Sans se soucier de la pluie, il remonte sur son engin énorme et tire sa remorque à travers les tiges jaunes pour aller rejoindre la moissonneuse-batteuse. Ce champ isolé me semble un bon endroit pour quelque chose qui porte le nom de Régina.
La bataille de la Somme a couté 24 000 victimes au Canada. Les Allemands l’appellent dat Blutbad (le bain de sang). Presque un siècle plus tard, le nom de Dieppe évoque les mêmes sentiments dans notre pays. Aujourd’hui, les falaises de Dieppe servent de toile de fond aux nombreuses personnes qui prennent un bain de soleil, mais pour les Canadiens, elles sont à jamais une amère icône de la guerre. Le 19 aout 1942 à l’aube, la force alliée lança un assaut à Dieppe. Neuf heures après, c’était fini, surtout parce que les péniches de débarquement ne pouvaient plus s’approcher des falaises, à cause de la grêle de balles pro-venant de ces dernières, pour aller au secours d’autres survivants. Sur les 5 000 Canadiens qui ont pris part au raid, 907 ont perdu la vie et presque 1 950 ont été faits prisonniers.
![Le ministre des Anciens Combattants, Jean-Pierre Blackburn, salue Madame Monique Bourgois au monument canadien à Dieppe. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE] Le ministre des Anciens Combattants, Jean-Pierre Blackburn, salue Madame Monique Bourgois au monument canadien à Dieppe. [ILLUSTRATION : JENNIFER MORSE]](../../en/wp-content/uploads/2010/11/BattlefieldsInset5.jpg)
Entre la plage et le Square du Canada, petit parc situé à l’ombre des falaises, il n’y a qu’une petite promenade. Une octogénaire guillerette s’assied à côté de moi sur un des bancs du parc. Elle porte un tailleur crème et taupe élégant et un chapeau de paille couvre ses cheveux roux frisés. Toulouse Lautrec me vient un instant à l’esprit; il n’a jamais peint une dame habillée aussi convenablement que celle-ci. Grâce à mes quelques mots de français et à son anglais bien meilleur, je découvre qu’elle habite à Dieppe depuis plus de 60 ans, et elle me dit avec fierté que son mari en a été le maire pendant 18 ans. « On avait beaucoup, beaucoup de cérémonies pour les Canadiens » pendant ce temps-là, me dit-elle. Elle me demande timidement si je sais qu’un ministre canadien important va venir aujourd’hui. Il se trouve que Jean-Pierre Blackburn, ministre des Anciens Combattants, va faire une escale inattendue à Dieppe cet après-midi.
« Qu’est-ce qui vous amène en France », me demande-t-il en riant quand il m’aperçoit parmi la foule de journalistes et de citoyens français. Je lui présente la petite dame au chapeau de paille et tous les reporters français nous entourent. Madame Monique Bourgois, émue à la suite du petit moment passé avec le ministre, se tient seule dans le jardin en murmurant « Nous nous souviendrons d’eux. Je viens parce que nous nous souvenons, nous nous souvenons, nous nous souvenons… » Je parle à une autre femme quelques instants et, quand je me retourne pour lui dire aurevoir, elle est partie.