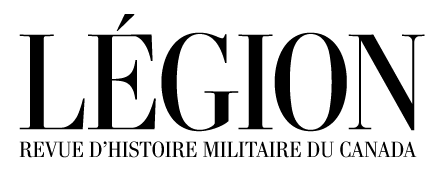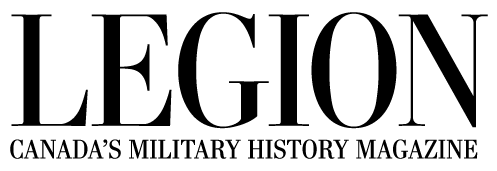![. [ILLUSTRATION : FRED SEBASTIAN] . [ILLUSTRATION : FRED SEBASTIAN]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2009/12/OSIIIntroJF.jpg)
Susan Binnie est sur un fauteuil de dentiste et elle demande si elle pourra y rester quand le dentiste aura fini — juste pour profiter de la quiétude. Elle habite à St. Albert, au nord-ouest d’Edmonton, avec ses deux filles de neuf et 14 ans, et son mari, un ancien combattant qui souffre de trouble de stress post-traumatique (TSPT) depuis 15 ans. Binnie sait très bien que si une personne souffre de TSPT, la famille au complet en souffre. Alors elle s’imprègne de quiétude quand elle peut.
Angelle Peacock de Morinville (Alb.), a deux petits garçons. Elle aussi supporte un TSPT. Son époux militaire, Ted, s’en fait soigner et, à l’occasion, elle a le sentiment d’avoir trois petits garçons, surtout quand elle doit rappeler à son mari de manger ou de prendre une douche.
Les deux femmes décrivent d’autres occasions où un comportement typiquement infantile a déclenché des accès de colère ou des rappels d’images chez leur mari. Elles se démènent toutes les deux avec le travail à temps plein et les problèmes familiaux qui exigent d’elles une attention à temps plein.
Ces femmes — et des centaines d’autres au Canada — ne peuvent pas se tourner vers les collègues au travail ou vers des amis, pour obtenir de l’aide parce que les gens qui ne vivent pas dans l’ombre du trouble de stress post-traumatique ne comprennent tout simplement pas. « Ils me demandent “pourquoi ne parts-tu pas?” » dit Binnie. Et Peacock ajoute : « Il m’est arrivé, en me réveillant la nuit, de voir que mon mari a enlevé une fenêtre et qu’il est dans la cour en train de “se battre avec les méchants”. Comment pourrait-on dire, le lendemain, au travail, à la pause café, “ Vous savez ce qu’il se passe chez moi? ” ».
« On n’entend pas des “Oh, comment faits-tu ou des Oh, tu devrais le quitter” » aux réunions régulières de groupes du réseau de soutien aux familles du Programme de soutien social des blessures de stress opérationnel (SSBSO), dit Binnie.
« On ne se fait pas prendre en pitié », dit Peacock. Et ces femmes n’ont que faire de la pitié : elles veulent de l’aide et elles en obtiennent auprès des gens qui ont été à leur place. « Ce qu’elles disent, c’est “Au secours. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a vécu comme ceci?” Puis les histoires et les stratégies sortent », ajoute Elizabeth Atkins, coordonnatrice de la région occidentale du réseau de soutien par les pairs à l’intention des familles à Edmonton. Les réunions servent à obtenir des renseignements sur d’autres ressources collectives, les programmes d’Anciens combattants Canada (ACC) et des Forces canadiennes, ainsi que sur la Légion royale canadienne et son bureau d’entraide. Et les membres s’échangent leurs numéros de téléphone, de sorte qu’il y a toujours quelqu’un à l’autre bout du fil si l’on passe un mauvais quart d’heure.
« Les femmes de militaires sont des fournisseuses de soins; la description de leur travail, c’est d’être un soutien, quoi qu’il arrive », dit-elle. Quand leurs maris, blessés, rentrent au bercail, « elles se souviennent des bons gars; elles se souviennent de qui elles ont épousé et elles l’aiment toujours. Alors c’est leur travail de les soigner ». Une telle compréhension n’a absolument rien à voir avec ce que Atkins a obtenu quand son propre mari a été blessé en Bosnie, en 1993, dans le temps où personne ne parlait de BSO. « Il y a encore du chemin à faire, mais l’information existe, et l’isolement n’est plus aussi grave. » Mais encore plus important, les BSO ne sont plus cachées; on en parle ouvertement.
Le programme de SSBSO national a été créé en 2005, à la suite d’une analyse des besoins des Forces canadiennes qui a servi à reconnaitre l’incidence des BSO sur les familles des militaires et l’importance qu’il y a à les soutenir. Il est fondé sur le programme de soutien social par les pairs aux victimes de stress opérationnel (SSVSO) qui a été créé en 2001 pour les militaires et les anciens combattants. Les pairs-conseillers des deux programmes ont de l’expérience personnelle des BSO, soit parce qu’ils ont souffert d’une blessure, soit parce qu’ils ont vécu avec quelqu’un qui en a souffert d’une. « Ils ont de la “crédibilité des rues” », dit le lieutenant-colonel Stéphane Grenier, une victime de BSO qui a pris part à l’élaboration du programme.
« C’est juste qu’ils comprennent », dit Binnie.
Les familles doivent supporter les modifications de personnalité et les comportements insolites, comme les montées de colère extraordinaires, les problèmes d’alcool, les problèmes d’insomnie, les sautes d’humeur, l’incapacité de se concentrer, l’hyper-vigilance, la honte et le chagrin, le manque d’énergie ou d’appétit, les idées de suicide. Chaque famille a son propre cocktail de chagrin et de stress. « Il n’existe pas de solution passe-partout », dit Atkins, qui a aidé quelque 130 familles au cours des cinq dernières années, en évaluant les besoins, en rencontrant des clients au café, en organisant et en animant des groupes en soirée, et en offrant son aide. Elle espère que les nouveaux centres intégrés de support au personnel (CISP) des Forces canadiennes absorberont une partie de la besogne. Le militaire est en train « de s’efforcer de les rendre plus conviviaux pour les familles » qui peuvent aussi tirer partie de la philosophie de « soutien à guichet unique » dans le cadre de laquelle tous les services de soutien pour les conjoints sont rassemblés en un seul lieu.
Angelle Peacock espère que les centres intégrés de support au personnel vont être une amélioration par rapport au vieux système qui était si frustrant. « Il n’était certainement pas convivial », dit-elle, en nous racontant ses déplacements d’un bureau à l’autre, les formulaires qu’elle devait remplir, le repérage des dossiers qui en deux ans ont rempli un tiroir double de sa cuisine. Ensuite, « il fallait aller voir beaucoup de gens qui portaient l’uniforme et qui ne voulaient pas s’occuper de la femme ». Supporter les symptômes de Ted et se heurter aux pesanteurs de la bureaucratie pour lui procurer l’aide dont il avait besoin a été très frustrant pour toute la famille, même si le commandant et l’unité de son mari lui ont été d’un très grand soutien
« Ce sont les familles qui doivent se faire les avocats », dit le sénateur Roméo Dallaire, général à la retraite et défenseur en ce qui concerne les BSO, qui a souffert d’une blessure lui-même au Rwanda pendant les années 1990. « Le blessé ne peut pas même s’occuper de lui-même, encore moins démêler quels documents doivent être remis, quand il faut le faire et à qui il faut parler » et il faut que tout cela se fasse plutôt rapidement.
« Les familles doivent acquérir l’assurance qu’elles peuvent s’en occuper », ajoute Atkins, qui les aide à comprendre quand le bon moment d’intervenir arrive, et comment le faire pour que ça se passe bien.
Le SSBSO n’attend pas obligatoirement le diagnostic pour offrir son aide et les services sont confidentiels. Au besoin, les épouses peuvent obtenir de l’aide sans que le militaire le sache. « On peut avoir des symptômes sans qu’il y ait de diagnostic. Leur vie est quand même bouleversée. Ils ne dorment pas bien, réagissent toujours à ce que font les enfants, conduisent toujours comme des idiots […] si la famille a des problèmes, nous pouvons lui donner un coup de main », nous explique Atkins, qui dit que le SSBSO ne refuse personne.
Cependant, le soutien, ce n’est pas de la thérapie. La ligne d’écoute téléphonique du ministère de la Défense nationale et d’ACC peut aider les familles qui affrontent une crise, mais pour ce qui est de l’aide à long terme, de beaucoup de services aux familles, « il faut que le militaire en service ou l’ancien combattant la demandent eux-mêmes », dit Atkins. Malheureusement, beaucoup de personnes qui souffrent de BSO ne savent pas qu’ils ont besoin d’aide, ou ils s’obstinent à tout faire tout seuls, ou bien ils sont incapables de s’occuper du traitement des documents pendant qu’ils sont très malades. « Les familles se désagrègent devant nous parce que nous n’arrivons pas à les atteindre, à cause des formalités administratives. »
Lors d’une interview qu’il nous a accordée cette année, le général chef d’état-major de la défense, Walter Natynczyk, déclarait qu’il savait fort bien quelles difficultés les familles de militaires supportent au front intérieur et qu’il faut faire davantage pour le personnel des services et leur famille (En déplacement avec le chef d’état-major de la défense, juillet/aout). Les services de soutien mis en place pendant l’année qui vient de passer sont vus comme un pas dans la bonne direction.
Les militaires endommagés en service commandé n’en méritent pas moins, dit Dallaire, dont la famille a eu besoin de thérapie pour s’en tirer. “Nous n’avons pas de système qui serve à stabiliser à nouveau les familles et les individus quand ils reviennent.” Il croit que les Forces devraient élaborer des « meilleures pratiques » pour le soin des familles des membres qui souffrent de BSO et que le gouvernement devrait « se préparer à payer pour que ces pratiques soient utilisées pour les individus et leur famille ».
Ce genre d’aide n’était pas disponible aux anciens combattants des générations précédentes ni à leur famille. « Une grande partie des jeunes gens avec qui j’ai grandi ont été élevés dans des familles où le mal, la douleur, étaient transmis aux enfants par les parents », dit le ministre d’Anciens combattants Canada, Greg Thompson, à l’occasion d’un symposium sur les BSO en 2007. « Ils étaient toujours présents. »
En ce temps-là, les anciens combattants et leur famille devaient s’en tirer tout seuls, tout simplement, et la Légion s’efforçait de les aider, ajoute Dallaire. « Je pense que la Légion a sauvé mon père et a sauvé ma famille des traitements physiques bien pires que ceux dont elle a soufferts. » Les anciens combattants allaient aux filiales où ils rencontraient les autres qui avaient eu des expériences semblables. « C’était une thérapie autogène », dit-il. Ils parlaient de leurs problèmes entre eux et « malheureusement, buvaient et se médicalisaient tout seuls. »
« On appelait ça la “BS table” (table des histoires à dormir debout), un endroit où les anciens combattants se racontaient des histoires et prenaient un verre, dit Doug Lawrence, un ancien agent d’entraide de filiale qui a passé 13 mois en Corée en 1951 et 1952. Dans le cadre de cette camaraderie, « on savait qu’on n’était pas tout seul. Dans le temps, on ne savait pas qu’est-ce que c’était. » Et ils étaient nombreux qui savaient ce qu’il fallait faire. « Je me suis mis à boire; on boit tous. »
Les vétérans de la guerre de Corée et de la Deuxième Guerre mondiale ont souffert pendant des dizaines d’années et ils avaient des symptômes de BSO sans savoir ce qui n’allait pas, encore moins s’ils pouvaient obtenir de l’aide. Lawrence et George Mann, qui a servi en Europe du Nord-Ouest dans les Fusiliers de Sherbrooke à la Seconde Guerre mondiale, ont subi toute une gamme de symptômes de TSPT. Mann a des cauchemars depuis 65 ans. Lawrence et lui parlent des accès de colère inattendus, des sautes d’humeur et de leurs effets sur leur famille. « Je me réveillais en hurlant, dit Mann. Des fois, ma femme devait pratiquement me défoncer les côtes pour me réveiller. » Lawrence dit qu’il envoyait des coups lors de ses cauchemars, alors son épouse dormait dans une autre chambre.
Le TSPT a été diagnostiqué chez Mann quand il a succombé à une dépression lors d’un voyage en France, en 2002. C’est arrivé pendant les services de commémoration pour les soldats canadiens assassinés à l’abbaye d’Ardenne en 1944. Il en avait connu six, et il a fini par obtenir de l’aide il y a cinq ans, après avoir essayé de se suicider. Les deux anciens combattants ont une pension d’ACC pour leurs blessures.
Les 19 nouveaux centres intégrés de support au personnel des Forces canadiennes sont une occasion de plus pour la Légion de servir les militaires, les anciens combattants et leur famille. « Ça va certainement améliorer notre visibilité chez les jeunes soldats et leur famille », remarque Gerry Finlay, un officier d’entraide de la Division de l’Alberta-Territoires du Nord-Ouest qui a ouvert un bureau au CISP de la garnison d’Edmonton.
Les CISP, conçus en tant que « services à guichet unique » pour les militaires malades ou blessés, ont pour but d’aider le personnel des Forces qui récupère d’une maladie ou d’une blessure graves pendant leur transition effectuée soit lors du retour au travail, soit vers la vie civile. Les réguliers, les réservistes, les membres qui prennent leur retraite et leur famille, tous ont droit d’accès aux CISP où les attendent une gamme de services et d’avantages des Forces, d’ACC et d’organisations comme la Légion. La Légion réagit vite pour procurer un soutien d’urgence aux familles des militaires en service, guider les membres des Forces en ce qui a trait aux demandes d’avantages d’ACC et apporter un soutien aux nouveaux anciens combattants qui reprennent la vie civile dans les petites collectivités, dit Finlay.
Souvent, quand un militaire se fait soigner pour une BSO, les habitudes et la structure de la famille se désagrègent. Pendant que le militaire tire avantage du soutien et des services du MDN, « il se peut que la famille souffre en cachette ». Mais la Légion peut les aider en offrant des fonds en urgence pour l’abri, la nourriture et le transport et en reliant la famille avec une filiale locale comme soutien communautaire. « Nous nous efforçons de stabiliser la situation », dit Finlay.
Au dire du lieutenant-colonel Joe Pollock, commandant régional de l’unité interarmée de soutien au personnel de l’Alberta et du Nord canadien, « la Légion est un partenaire parfait. « C’est réciproque. » Les membres des Forces canadiennes peuvent compter sur l’aide de la Légion et la Légion a accès aux membres en service qui s’apprêtent à devenir des anciens combattants.
La Division de la Colombie-Britannique/Yukon de la Légion a aussi élaboré un moyen direct d’aider les anciens combattants et leur famille à s’occuper des BSO. Au milieu des années 1980, le Dr Marvin Westwood rassemblait plusieurs groupes d’anciens combattants dans un programme financé partiellement par la Légion pour parler de comment leur expérience militaire les avait formés. « Ils ont reconnu que la guerre les avait affectés d’autres manières, dit le psychologue de l’Université de la Colombie-Britannique. Ils disent que “ceci aurait dû se passeril y a 60 ans”, quand ils ont quitté le service. »
Westwood et la Légion ont poursuivi l’idée, et créé le programme de transition des militaires et des anciens combattants canadiens, qui a aidé environ 170 membres des services et anciens combattants à « larguer du leste » du service militaire et à faire leur vie. Le programme sert à offrir gratuitement de l’orientation collective confidentielle, à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et à l’Université de Victoria, à Victoria et à Kelowna. « Si nous nous sommes lancés là-dedans, c’est parce qu’il y avait des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui souffraient encore, et ce genre d’aide, ça n’existait pas avant, dit le président de la Division de la Colombie-Britannique/Yukon, Dave Sinclair. Ensuite, on s’est aperçus qu’il y avait beaucoup de mainteneurs de la paix qui avaient besoin d’aide. »
« On se concentre sur la transition », dit Westwood. Des groupes de six à huit, plus les animateurs, se réunissent lors de séances intensives, en fin de semaine, pour parler de comment les traumatismes les ont affectés. Ils élaborent des habiletés d’adaptation, trouvent des appuis et sont adressés à des services supplémentaires au besoin. Leurs conjoints, légitimes ou de fait, sont invités pour apprendre comment les traumatismes affectent tous les membres de la famille. Les couples acquièrent de nouvelles aptitudes à communiquer.
On s’attendait à ce que le programme diminue, surtout à cause de l’augmentation du nombre de programmes sur les BSO offerts par ACC et les Forces. Mais la demande a continué. « Je pense que l’inclusion des conjoints en est une raison », dit Sinclair. Le modèle est intéressant aussi, dit Westwood. « On ne l’annonce pas comme si c’était un programme thérapeutique (alors) on n’y associe aucun stigmate. » Les ateliers de groupe sont confortables, car les militaires sont habitués à faire partie d’un groupe qui les appuie. Et ils ont un réseau de soutien tout fait à leur départ. « Les changements chez ces gens sont inouïs. »
Sinclair a vu des familles — au bord de l’abîme — se faire renforcer. Il a vu des alcooliques brisés, incapables de garder un emploi, finir par avoir une carrière productive. « Ils se sont repris en main. »
Il s’agit d’un investissement que la Légion est fière d’effectuer. « Le soutien financier vient seulement de la Légion », dit Westwood. Sinclair fait remarquer que les psychologues qui participent aux séances le font gratuitement, ce qui empêche les couts de grimper. Les 90 000 $ du programme sont ramassés parmi les filiales de la région où le programme est réalisé.
Il existe bien d’autres options aujourd’hui pour les gens souffrant de BSO et pour leur famille, et il est important qu’ils en profitent le plus vite possible, dit le psychologue Curt Hillier de St. John’s (T.-N.) dont la clientèle comprend de nombreux anciens combattants et soldats qui, certains, auraient dû se faire aider des années auparavant. Dans 30 à 50 p. 100 des cas on peut s’attendre à ce que ça finisse par une rémission complète. » D’un autre côté, les données américaines indiquent qu’environ 30 p. 100 des gens souffrant d’un TSPT « en gardent les symptômes pendant six ans ou plus […] à jamais dans certains cas. »
Il espère que ces statistiques s’amélioreront grâce aux nouveaux programmes des Forces qui ont pour but de préparer les militaires avant les traumatismes qui arrivent en service commandé, de les soigner au front quand ils souffrent d’une BSO et d’intervenir plus rapidement quand les symptômes sont observés.
Des fois, les gens souffrant de BSO n’en reconnaissent tout simplement pas les symptômes. Il arrive souvent qu’ils n’obtiennent de l’aide qu’après que le conjoint a posé un ultimatum. Pour les anciens combattants qui refusent de se faire aider, le rétablissement risque d’être plus long et jonché des vestiges d’une famille brisée.
Blessures invisibles
Le stress opérationnel est inclus dans la description des fonctions des militaires. Quand ils vont au combat, qu’ils maintiennent la paix ou qu’ils répondent à des urgences, il leur arrive d’être témoins d’évènements horribles, d’être terrifiés, de se sentir impuissants, de perdre des gens pour qui ils ressentent de l’affection. Des fois, ils sont obligés de se comporter contrairement à leurs valeurs morales personnelles.
La plupart n’en souffrent que pendant un certain temps; quelques jours ou quelques semaines après, ils acceptent ce dont ils ont fait l’expérience et reviennent à la normale. Mais pour certains d’entre eux, ces expériences laissent des séquelles : dépression, anxiété, trouble de stress post-traumatique.
Les chercheurs s’aperçoivent que de tels troubles de stress opérationnel (BSO) suscitent des modifications physiques dans le cerveau, des blessures invisibles, des blessures causées par leur propre corps lors de sa réaction à un stress bouleversant.
La réponse du corps au stress — qu’on appelle des fois la réaction d’évasion ou de lutte — offre la meilleure chance de survie dans des situations de vie ou de mort. Quand on perçoit le danger, c’est comme si on appuyait sur un bouton d’urgence qui inonderait le corps d’adrénaline, pour augmenter la glycémie, élever la pression artérielle et accélérer la fréquence cardiaque, et de cortisol, pour lui procurer des élans d’énergie, surexciter les sens, diminuer la sensibilité à la douleur.
Quand il n’y a plus de danger, d’autres produits biochimiques sont déchargés dans le corps pour lui redonner son équilibre, mais, dans le cas d’une BSO, c’est comme si le corps ne sait plus comment le faire.
L’exposition prolongée au cortisol tue les cellules de l’hippocampe, la partie du cerveau chargée du stockage des souvenirs et de l’apprentissage. Le TSPT et la dépression diminuent le métabolisme dans le cortex préfrontal et frontal, qui règle les émotions et la réponse à la peur. C’est cet endommagement qui, pense-t-on, est responsable de la peur quand il n’y a plus de danger, des cauchemars, de la revivification des souvenirs, des explosions de colère, de la tristesse que l’on ne peut contrôler, des souvenirs importuns, de l’hypervigilance.
Les scintigraphies cérébrales des militaires souffrant de TSPT indiquent des différences dans les activités du cerveau par rapport à celles des soldats qui n’en souffrent pas, ce qui mène à des conjectures comme quoi il serait possible un jour de déceler les gens qui risquent d’être blessés plus que les autres, ou d’utiliser les scintigraphies cérébrales pour les diagnostics.
Mais « on n’est pas obligé de se rendre au niveau du diagnostic pour savoir qu’il y a eu un impact et qu’on a besoin d’aide », dit Norman Shields, un conseiller en recherche du Centre national des BSO à Montréal. C’est une des raisons pour lesquelles le MDN et ACC préfèrent le terme global blessure de stress opérationnel plutôt que TSPT. On devrait se concentrer sur l’aide aux patients plutôt que sur leur classement. « Pour nous, c’est davantage une question de savoir si on dort la nuit, si on s’inquiète […] tant que c’est lié au service commandé, ils ont le droit de venir se faire aider ici. »
Et c’est important de se faire aider, car les BSO ont des conséquences à long terme inattendues.
« Le stress en général a une incidence immense sur notre système immunitaire », dit Shields. Les recherches indiquent que les gens qui souffrent d’une BSO risquent davantage de développer un syndrome métabolique, précurseur du diabète de type 2, l’hypertension, une cardiopathie, la maladie d’Alzheimer.
Les médicaments pour soulager les symptômes mis à part, les soins comprennent la thérapie cognitivo-comportementale, qui aide les gens à déceler les pensées altérées et les réactions négatives et à les remplacer par des pensées rationnelles et un comportement plus inoffensif; l’EMDR (intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires) qui, croit-on, règle le système de traitement de l’information du cerveau qui permet aux expériences dérangeantes de se faire intégrer dans la mémoire et traiter émotionnellement; la thérapie au propranolol, où l’on utilise un médicament pour l’hypertension afin de refouler la reconsolidation du souvenir traumatisant; et la thérapie de groupe et familiale, qui offre du soutien et enseigne de nouvelles aptitudes servant à supporter les symptômes.