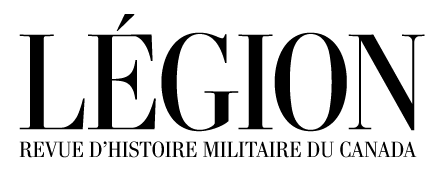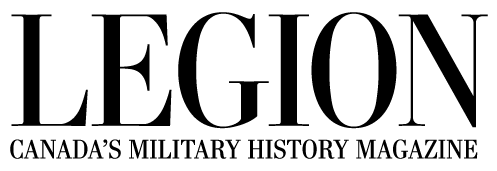![Les péniches de débarquement mettent le cap sur la Normandie, le 6 juin 1944. Remarquez les piles de bicyclettes. [PHOTO : GILBERT ALEXANDER MILNE, LIBRAIRIE ET ARCHIVES CANADA–PA135966]](http://www.legionmagazine.com/en/wp-content/uploads/2009/04/crossingintro.jpg)
En début d’après-midi, le 5 juin 1944, nous avons pris le départ de la côte sud de l’Angleterre. Nous n’avons appris où nous allions qu’une couple d’heures après, quand nous avons ouvert les ordres scellés après avoir changé de panne entre le continent et l’île de Wight.
Ce n’est qu’alors que nous avons appris où nous allions et, bien que nous ne le savions pas à ce moment-là, l’opération allait modifier le cours de la guerre. Nous faisions partie de la plus grande force terrestre, aérienne et marine jamais combinée et nous faisions voile vers la Normandie (France).
Maintenant, en cette année de mon 88e anniversaire, dans le confort de ma maison à Saint-Lambert (Québec), je contemple cette immense période — 65 ans pour être juste — qui sépare mon aujourd’hui de ce jour-là. Bien que force détails se soient estompés, je me rappelle de certains évènements — et de certains visages — des 5 et 6 juin 1944.
J’avais 23 ans; je n’étais qu’un gamin, avec des connaissances en trigonométrie, dans l’artillerie où j’étais l’assistant d’un officier du 14e Régiment de campagne.
Nous traversions la Manche dans une barge de débarquement de chars d’assaut (LCT), un bateau fait pour rouler sur la terre ferme (ou tout au moins près de la côte) où il ferait tomber sa rampe de proue pour déposer des hommes et des engins au cœur des combats. Je me souviens encore de la carte où étaient indiqués les endroits importants, y compris ceux où iraient nos premières pièces. Nous étions à peu près 40 à bord, y compris l’équipage de la LCT, avec quatre canons automoteurs de 105 mm, un char de commandement et une chenillette porte-Bren, ainsi qu’un groupe de liaison d’infanterie.
La mer était houleuse ce matin-là et nombreux étaient les hommes qui ont dû s’arrêter de jouer au poker ou aux dés, pour aller soulager leur estomac par-dessus bord.
Des ballons de la taille de grosses voitures étaient fixés au-dessus de nous avec des câbles pour déconcerter les avions ennemis volant à basse altitude.
Nous ne pouvions pas dormir et j’ai participé à la plus grande partie de Red Dog de ma vie. C’était une partie de poker à mises élevées qui a duré toute la nuit. Presque tout le monde à bord a joué jusqu’à ce qu’ils soient « complètement fauchés », y compris les officiers supérieurs. Les autres observaient et j’ai fini avec une somme équivalant à 3 000 $ canadiens dans les poches. C’était beaucoup d’argent en ce temps-là et, d’avoir tant gagné, je me sentais — à tort ou à raison — plutôt vulnérable par rapport à ceux qui avaient fait moins bien que moi. Mon succès était probablement dû à la chance du débutant parce que c’est la seule fois que j’ai joué au Red Dog. J’avais tout parié : des livres anglaises et des francs français.
À la fin de la partie, quand le jour se levait, nous avons eu une vision fantastique. De tous les côtés, à perte de vue, il y avait des navires alliés assemblés en une immense armada.
Peu de temps après, on nous a donné la tâche de tirer un barrage devant notre infanterie qui se lançait à l’assaut des plages normandes de Bernières-sur-Mer. Nous n’étions pas encore très près du rivage à ce moment-là, alors ce n’était pas facile de tirer par-dessus la tête des fantassins qui passaient à l’attaque. La LCT était fortement secouée, alors pour obtenir une bonne ligne de tir, il fallait maintenir le cap et la vitesse. Notre boulot était d’effectuer un tir de harcèlement pour venir en aide aux Queen’s Own Rifles of Canada qui atterrissaient à la plage Juno un peu après 8 h.
Je me souviens d’avoir vu des chars amphibies à double propulsion. Ces engins étaient flottables et à hélices, conçus pour fendre les flots en surface jusqu’à ce qu’il atteignent la plage. Malheureusement, il y en a qui ont coulé dans la mer forte. J’ai aussi remarqué des péniches d’où on lançait des fusées, et j’ai entendu le son de locomotive que les gros obus, lancés par un navire de guerre que nous ne pouvions voir, faisaient en passant au-dessus de nos têtes. Vu tout le bruit qui me martelait alors, je n’ai jamais eu honte de faire une demande à Anciens combattants Canada, des années plus tard, pour perte auditive.
Il était à peu près 9 h quand notre LCT a frappé une mine. L’eau était profonde de six pieds environ et la rampe de la LCT a été détruite. Elle a coulé à pic, mais nos véhicules n’ont pas calé parce que leurs côtés et leur pot d’échappement avaient été allongés. La chenillette porte-Bren du régiment d’infanterie que nous transportions sortit de la LCT qui s’enfonçait, mais elle fut détruite par une mine.
J’étais dans le char, debout dans la tourelle, et j’ai vu la chenillette porte-Bren sauter et retomber à l’envers. C’était comme une immense baleine qui aurait sauté hors de l’eau et serait retombée. Peu de temps après, nous allions nous mettre à la recherche de survivants et peut-être remorquer la chenillette jusqu’à la plage, mais le maitre de plage nous interdit de nous arrêter. Il savait ce qu’il fallait faire mieux que nous et je suppose qu’il ne voulait pas nous voir subir le même sort.
En regardant vers la côte, de l’autre côté de la plage sablonneuse, je vis beaucoup de soldats morts ou mourants avant la digue en béton. C’était terrible.
Notre groupe a atteint la plage à 9 h 25 et y est resté une bonne heure, en proie aux obus et aux balles volant au-dessus de nos têtes. Ce fut finalement notre tour de passer par une petite brèche dans la digue de Bernières-sur-Mer. Nous n’avons été mitraillés, par un avion ennemi volant en rase-mottes au-dessus de la plage, que deux fois.
Un de nos gars a été tué d’une balle à la tête pendant que nous étions coincés dans un bouchon. Il était devant nous, et la balle était venue d’une maison qui a été démolie par la suite. C’est une Française qui avait tiré et nous avons entendu une rumeur comme quoi c’était la petite amie d’un soldat allemand.
Le champ où notre batterie devait se rendre était occupé par une autre batterie, alors nous avons fini par entrer dans un champ qui avait été miné. C’est grâce à un garçon français de 14 ou 15 ans, qui nous a dit que les Allemands l’avaient obligé à placer les mines, que nous avons pu manœuvrer dans le champs. J’ai persuadé le jeune homme, avec mon fusil, de s’assoir sur l’avant du char et de nous montrer par où passer.
Ce soir-là, les avions allemands sont arrivés et ont semé la confusion dans les dépôts de munitions. C’était tout un feu d’artifice; vraiment effrayant. Nous avons aussi découvert à ce moment-là que nos francs français ne servaient pas à grand-chose. La seule monnaie acceptable était la cigarette.
Il y a eu des erreurs bien sûr, faites par tous les grades, mais nous avons triomphé. Et il ne faudrait jamais oublier tous ces braves jeunes hommes qui ont restés là-bas il y a 65 ans.