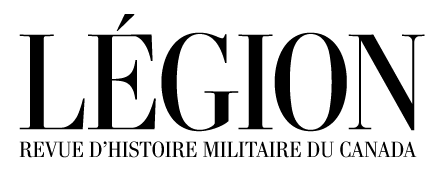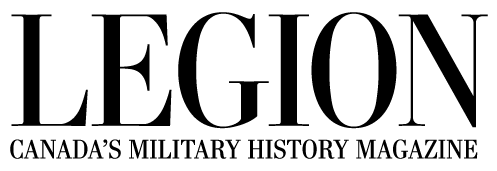Visible de l’école blanche tristement célèbre qui est à l’épicentre de la sédition dans la province de Kandahar, la force canadienne rassemblée hâtivement entre dans la zone létale. Une fusée de signalisation ennemie passe en travers des éléments antérieurs de la Compagnie Charles et il n’y a pas beaucoup de mots polis pour décrire ce qui arrive ensuite.
Rick Nolan meurt le premier. Cet adjudant du 7e peloton, ses coeur et âme, se trouve sur le siège passager du G-Wagen au blindage léger quand une grenade propulsée par fusée passe à travers le pare-brise. Un infirmier et un interprète afghan, assis sur la banquette arrière, sont blessés gravement tous les deux. Le caporal Sean Teal, hébété mais pas vraiment blessé, s’élance dans une pluie de balles pour chercher des secours. Le G-Wagen ne bougera plus jamais.
Le suivant qui meurt est Shane Stachnik. Ce sergent du génie se tient dans la trappe du guetteur aérien de son véhicule quand un obus de canon sans recul de 82 mm les fait sauter. La plupart à l’intérieur sont blessés ou rendus inconscients et la radio du véhicule sombre dans le silence. L’indicatif d’appel Écho 3-2 est hors de combat.
Le tir des ennemis cachés dans leurs tranchées et leurs édifices fortifiés vient de trois côtés. Les Canadiens sont enveloppés. Les balles soulèvent la poussière comme au cinéma. Des fusées arrivent en hurlant. Chaque arme canadienne qui peut encore servir tire vers les lueurs de départ au loin.
Un véhicule blindé canadien, plein de blessés et de morts, quitte la zone d’abattage en reculant à toute vitesse mais il s’écrase dans un fossé où il est atteint par plusieurs RPG. L’indicatif d’appel 3-1 Bravo est immobilisé et mourant. Il ne quittera jamais le fossé.
Les radios sont pleines de cris, certains demandent un infirmier, d’autres demandent de l’aide. Pendant que les coups de feu et les explosions continuent, nombre de soldats se portent au secours de leurs amis blessés, se concentrant sur leur propre mission de sauvetage, leur propre guerre. Le temps est déréglé. Il passe trop vite ou il passe trop lentement; les heures semblent être des minutes et il y a des secondes qui n’en finissent pas. Des hommes blessés se traînent au sol à la recherche d’un abri. Il y a des actes de courage inimaginable de tous côtés.
Il y en a quand même d’autres qui vont mourir. Le simple soldat William Cushley, farceur légendaire et ami de tout le monde semble-t-il, est tué aux côtés de l’adjudant Frank Mellish du 8e peloton, qui, ayant appris que son ami Nolan était en difficultés s’était avancé pour l’aider.
Les heures passent. Un officier traverse le terrain à découvert en sprintant, armé de son pistolet seulement, à la recherche de son camarade. L’ennemi continue de tirer. Le sergent-major de compagnie tombe.
Ils continuent le combat malgré les calamités qui arrivent l’une après l’autre. Et les blessés s’empilent. Certains sont touchés plusieurs fois. Certains autres ont des blessures qu’on ne peut voir.
Pendant tout ce temps est diffusée dans le réseau la voix calme du major Mathew Sprague, le commandant de la compagnie qui, bien que sous le feu de l’ennemi lui-même, dirige ses hommes à travers le chaos et demande des frappes aériennes et un bombardement de l’artillerie. Mais l’ennemi est trop bien enfoui et trop bien caché. Il lance un feu très nourri, bien que mal dirigé heureusement, sur la force canadienne prise au piège.
Quand une bombe de 1 000 livres égarée, larguée hors de la cible par un aéronef de la coalition, rebondit à travers les lignes canadiennes et s’arrête devant eux, il ne leur reste plus qu’à reculer.
Le capitaine Derek Wessan appelle Sprague à l’indicatif d’appel 3-9. “On doit quitter cet h—–e d’endroit”, dit-il. “Et puis ensuite il faut faire exploser la place.”
Sur les 50 soldats canadiens qui sont entrés dans la zone létale ce jour-là, pas moins de 10 ont été blessés, quatre ont été tués et au moins six sont devenus des victimes du stress.
Même avec un an de recul, il est difficile pour qui que ce soit de bien comprendre ce qui s’est passé ce jour-là.
Ce qu’on sait avec certitude, c’est que cinq soldats qui ont participé à cette bataille ont obtenu la plus haute décoration canadienne pour bravoure, la Médaille de la vaillance militaire, et un autre, le caporal Sean Teal, a obtenu l’Étoile de la vaillance militaire, la deuxième plus grande récompense du Canada, à peine en dessous de la Croixde Victoria. Il y a aussi un soldat qui a été cité à l’ordre du jour.
L’embuscade à l’école blanche a eu lieu le 3 septembre 2006, le deuxième jour de l’opération Méduse, laquelle était la première opération de combat de l’OTAN et la plus grande opération de combat du Canada depuis la guerre de Corée.
Il est clair que c’était une bataille immense où l’héroïsme était présent malgré les grandes difficultés. Mais ce qu’on ne connaît pas aussi bien, ce sont les circonstances qu’on a préfigurées pour cette bataille. C’était un combat où l’instinct stratégique d’un général, son intuition par rapport à la forme de la bataille, l’a mené à abandonner un plan minutieux et contredire ses commandants tactiques sur le terrain en lançant la Compagnie Charles dans une attaque épouvantable contre un ennemi supérieur en nombre dans une position défensive bien établie.
Nous allons raconter cette histoire en détail et d’autres encore, dans un rapport en trois parties sur la bataille du Panjwai qui commence par le contexte de l’opération Méduse et la controverse en arrière-plan qui a donné lieu à la pénible attaque du 3 septembre.
L’opération Méduse était la plus grande opération en Afghanistan depuis 2002 et elle avait pour raison d’être de disperser ou détruire des centaines, sinon des milliers d’insurgés qui s’étaient assemblés à environ 20 kilomètres au sud-ouest de la ville de Kandahar, dans le district du nom de Panjwai.
En 2006, le Panjwai était le centre du territoire de la sédition. Pendant toute une génération de membres des services canadiens, mentionner Panjwai va presque certainement rappeler les souvenirs difficiles concernant des petits villages et un terrain défensif complexe, les hostilités intraitables et les interminables bombes des bas-côtés routiers. Sur les 66 Canadiens tués en Afghanistan depuis 2002 (avant le 10 juillet 2007), presque la moitié sont morts au Panjwai.
Le Panjwai est le foyer spirituel et littéral du mouvement des taliban. C’est le berceau de leur leader qui n’a pas encore été trouvé, le mollah Mohammed Omar, et l’endroit où le mouvement a commencé, au milieu des années 1990.
La rivière Arghandab et la ville de Bazaar-e-Panjwai sont au centre du district. Le Panjwai, bordé au sud par un désert, est dominé par quelques montagnes singulières, dont Masum Ghar et Mar Ghar.
Depuis l’invasion de l’Afghanistan en 2001, la province de Kandahar avait été principalement une responsabilité américaine. Quand le groupement tactique canadien s’est dirigé au sud de Kaboul vers Kandahar au début de l’année 2006, il a vite découvert que les activités des taliban étaient très nombreuses et qu’elles avaient pour centre le Panjwai.
Durant les premiers six mois de la nouvelle mission, la première faction (comprenant surtout des soldats de la Princess Patricia’s Canadian Light Infantry) s’est battue avec des insurgés de façon routinière dans le Panjwai et ses alentours.
L’opération Méduse devait changer tout cela. Ce devait être la victoire décisive de la bataille du Panjwai.
Le brigadier-général David Fraser contrôlait Méduse à partir de son quartier général situé au terrain d’aviation de Kandahar, la base de la coalition étalée aux abords de la ville de Kandahar. Fraser n’était pas seulement le Canadien le plus haut gradé sur les lieux, il était aussi le commandant de l’OTAN en Afghanistan du Sud.
Sur le terrain, le groupement tactique était commandé par le lieutenant-colonel Omer Lavoie, le commandant du 1er Bataillon du Royal Canadian Regiment à l’expression coriace, un homme qui d’après certains de ses subalternes est le comble du soldat. La composante canadienne de sa force comprenait le 1RCR, et un effectif du 2e Régiment du génie, de la 2e Royal Canadian Horse Artillery, des infirmiers de la 2e Ambulance de campagne et plusieurs membres du personnel de soutien, ce qui faisait en tout quelque 1 050 Canadiens.
Alors que les difficultés se brassaient depuis un certain temps au Panjwai, quand Lavoie et le groupement tactique du RCR sont arrivés à Kandahar au début du mois d’août 2006, au moment où l’OTAN remplaçait les États-Uniens dans le sud, la situation en était à un point crucial. S’attendant à mener une campagne contre les insurgés en Afghanistan, Lavoie fut surpris quand il découvrit que des centaines, peut-être même des milliers, de combattants ennemis s’étaient rassemblés juste à l’extérieur de la ville de Kandahar.
“Nous avons pris les choses en main tout juste au moment du transfert à l’OTAN”, dit Lavoie. “Alors je pense que les taliban ont décidé de soit tester l’OTAN, soit démontrer qu’elle n’était pas résolue à mener des opérations de combat dans la même mesure que l’avaient fait les forces des États-Unis.”
Quelques heures après la cérémonie du 19 août où il prenait le commandement du groupement tactique canadien, Lavoie voyait la vraie situation au Panjwai de ses propres yeux.
Quelques jours auparavant, Lavoie avait ordonné à une force de la grandeur d’une petite compagnie d’aller camper au point élevé de Masum Ghar et d’observer la région pour voir si l’ennemi s’y manifestait.
Trois heures après avoir pris le commandement, vers les 7 h, Lavoie recevait un message comme quoi entre 300 et 500 insurgés étaient en train d’attaquer sa force au Masum Ghar. “Ce qui est arrivé, bien sûr, c’est que les taliban, voyant nos véhicules sur notre colline et n’aimant pas cela, décidèrent de lancer une attaque importante”, dit Lavoie. “Je suis finalement arrivé à la position vers 4 h. Au bout du compte, nous avons tué quelque 100 taliban sans qu’il y ait de victime de notre côté, alors c’était un bon commencement.
“Mais ce que cela avait d’important, c’est qu’il s’agissait d’un puissant message pour nous, donc pour l’OTAN aussi, que s’ils pouvaient assembler une telle force pour cette attaque, la proportion d’ennemis dans la région était bien supérieure à ce que nos prédécesseurs avaient indiqué, alors la bataille du 19 août au Panjwai devint le précurseur de Méduse.
“Presque immédiatement, j’ai été rappelé par le commandant de la brigade (Fraser) qui m’avertit qu’une importante opération de combat dans le Panjwai allait avoir lieu pour battre et repousser cet élément ennemi; ainsi, en ce qui me concerne, c’est à ce moment-là que Méduse a commencé.”
À Kandahar, Fraser aussi remarquait le revirement des tactiques des taliban.
“Nous avons aussi découvert que les taliban avaient changé leurs tactiques. Ils ont changé, du petit groupe éclair, au groupe conventionnel plus imposant à déloger. Leur intention était de prouver au monde et au gouvernement Karzai qu’ils pouvaient s’occuper de nous. C’était le point culminant de l’idée qu’ils avaient en 2006, je n’appellerai même pas ça un plan de campagne. C’est comme ça qu’ils voulaient terminer les combats cette année-là, même terminer les combats complètement. Ils pensaient pouvoir gagner à ce moment-là.
“Ce qu’ils ne savaient pas c’est que j’avais deviné leur plan, je connaissais leurs intentions”, dit Fraser. “J’avais déterminé qu’ils voulaient que je les attaque directement, façon Première Guerre mondiale, en payant un prix énorme en soldats afghans et de la coalition. Mais ce n’était pas une façon acceptable d’opérer à mes yeux.
“Alors nous nous sommes adaptés et avons écrit un plan qui s’opposait à leurs intentions, conçu dans le but de pallier aux dommages collatéraux aux Afghans ainsi qu’à leurs champs et à leurs huttes, et aussi de pallier aux risques pour mes soldats, les afghans tout comme ceux de la coalition.
“Nous avons mis les wagons en cercle, pourrait-on dire, autour des taliban, et nous les avons obligés à lever la tête pour pouvoir la couper.”
Le plan de Méduse était sérieux et semblait assez solide. En tout, il y aurait presque 1 400 soldats de la coalition sur le terrain dans le groupement tactique et des milliers d’autres allaient les appuyer. D’après Fraser, il a passé une grande partie du mois d’août à planifier.
“Il s’agissait d’un effort important, du point de vue de la brigade; j’ai fais venir au Panjwai des troupiers de toute ma brigade, laquelle comprenait des soldats de neuf pays à travers quatre provinces, parce que je n’allais pas permettre aux taliban de gagner. J’en avais la ferme intention. Je me suis dis ‘Vous êtes tombés sur un os en voulant vous mesurer à Dave Fraser, parce que je vais vous battre ici’.”
Sur le terrain, il y avait plusieurs forces distinctes prêtes à se ruer sur l’ennemi. La force canadienne de Lavoie était composée par la Compagnie Charles au sud, qui passerait par Bazaar-e-Panjwai, et par la Compagnie Bravo au nord, qui attaquerait vers le sud. La Force opérationnelle 31, qui comprenait des soldats de la coalition (surtout des Special Forces des États-Unis) et la Force opérationnelle Grizzly, une compagnie américaine, se trouvaient à un flanc. Avec une section danoise en position à l’ouest et une compagnie hollandaise patrouillant le périmètre au nord, l’ennemi était bien encerclé.
L’opération Méduse commença aux premières lueurs du 2 septembre par une attaque sur deux axes, l’effort principal fait au sud. Là-bas, principalement, Sprague et la Compagnie Charles devaient saisir les hauteurs autour de Panjwai (Masum Ghar et Mar Ghar) et isoler la ville de Panjwai elle-même. Ils allaient avancer jusqu’à la rive sud de la rivière Arghandab mais ne la traverseraient pas.
“Nous avons pris le départ à 5 h 30. Toute l’opération était basée sur mon heure H; je l’avais choisie à 6 h : l’heure que j’avais l’intention de lancer mes forces pour prendre Masum Ghar”, dit Sprague. “En effet, à 6 h exactement, Masum Ghar était à nous. À 6 h 15, j’ai déclaré qu’il n’y avait aucune structure de vie de l’autre côté de la rivière, à Pashmul, sauf des groupes d’insurgés avec lesquels nous nous mimes à échanger des coups de feu.”
D’après le plan d’origine, ayant pris les positions élevées autour de Panjwai et au nord, il allait falloir plusieurs jours au groupement tactique pour frapper les taliban, qui étaient alors encerclés dans une petite zone, quelque cinq kilomètres carrés à peu près, jusqu’à ce qu’ils se rendent.
Toutefois, ce plan préparé si minutieusement commença à se transformer presque immédiatement.
“Dans les instructions d’origine de la brigade, une fois que j’eus confirmé qu’il n’y avait pas de civil, une frappe aérienne utilisant des munitions guidées de précision devait être lancée simultanément contre 10 ou 20 noeuds de commandement et contrôle des insurgés”, dit Sprague. “Quelle qu’en soit la raison, cela n’eut pas eu lieu et la frappe a été annulée par la brigade.”
Malgré tout, aux deux points élevés, les Canadiens préparèrent des lignes de feu avec leurs véhicules blindés et se mirent à tirer sur les cibles d’occasion de l’autre côté de la rivière tout au long de la matinée et de l’après-midi du 2 septembre.
“L’objectif à ce moment-là”, dit Lavoie, “une fois que la région eut été prise et l’ennemi bloqué au nord et au sud, était de continuer d’engager le combat pendant les prochains trois jours, surtout grâce à l’appui aérien offensif et aussi grâce à l’artillerie au feu direct, ce qui, de mon point de vue, aurait déterminé où se trouvait vraiment l’ennemi, et cela aurait aussi diminué sa capacité de se battre avant que notre force principale se lance au combat.”
Et ce n’était pas n’importe quoi qu’on attaquait. Si Kandahar est le centre stratégique en Afghanistan et le district de Panjwai, la clé de Kandahar, la région autour de la ville de Bazaar-e-Panjwai qui comprend le petit village de Pashmu, est en plein coeur de la situation.
C’était, en gros, l’objectif Rugby, la région de l’autre côté de la rivière Arghandab au centre de laquelle se trouvait l’école blanche où quelques heures plus tard la Compagnie Charles, ayant traversé la rivière, allait tomber dans une embuscade.
L’objectif Rugby est un endroit que les Canadiens connaissaient bien. Le 3 août 2006, la PPCLI avait été impliquée dans une bataille infernale à cette école blanche où quatre soldats ont trouvé la mort (le sergent Vaughn Ingram, le caporal Christopher Jonathan Reid, le caporal Bryce Jeffrey Keller et le simple soldat Kevin Dallaire) et six autres ont été blessés. Durant ce même combat-là, la première Étoile de la vaillance militaire canadienne a été décernée au sergent Patrick Tower.
“C’est ce terrain que l’ennemi avait décidé de défendre”, dit Fraser qui, ayant été le commandant le 3 août, tout juste un mois avant, était tout à fait conscient de ce qui était arrivé ce jour-là. “C’est à Rugby que, d’après notre évaluation, les taliban voulaient que nous nous battions. C’était leur terrain de combat principal. La structure de leur défense avait été conçue pour que nous arrivions en traversant la rivière Arghandab par le sud et que nous combattions à Rugby. Et l’école était au centre de la zone qui avait de grands champs d’abattage à l’est et au nord.
Vu l’histoire récente de l’objectif Rugby et l’accumulation évidente des forces de l’ennemi dans la région, le groupement tactique désirait prendre son temps avant d’aller au territoire des taliban. D’après le plan, il avait beaucoup de temps.
“On avait prévu une série de déceptions et de feintes durant ces trois jours pour faire réagir l’ennemi”, dit Lavoie, “pour voir où il se trouvait et ainsi planifier l’attaque finale.”
Mais cela ne devait pas arriver. Le plan allait se transformer.
Vers 14 h, le 2 septembre, Fraser fit un tour au Masum Ghar pour étudier la situation. À ce moment-là, les activités des insurgés avaient diminué.
Voyant cela, Fraser donna l’ordre de traverser l’Arghandab. Bien que beaucoup parmi les gars qui se trouvaient sur place s’inquiétassent d’une entrée dans le territoire ennemi avec si peu de préparation, conformément aux ordres, peu de temps Sprague menait le 7e peloton et un détachement d’ingénieurs après au lit de la rivière pour planifier la traversée.
Ensuite, la consigne fut donnée au 7e peloton de camper dans le lit de rivière pendant la nuit. Cela fut dûment arrangé et les membres du peloton commencèrent à s’allonger. Toutefois, peu de temps après, les leaders supérieurs réunis au Masum Ghar décidèrent que laisser le peloton tout seul au bord du territoire ennemi n’avait aucun avantage tactique et il fut retiré à la nuit tombante.
Vers minuit, Fraser ordonnait à nouveau à Lavoie de se lancer à l’attaque de l’autre côté de la rivière.
D’après les gars sur le terrain, cet ordre était encore moins judicieux. Mais pour Lavoie, réussir à faire retarder cet ordre était tout un exploit. D’après plusieurs sources, la conversation concernant le mérite de lancer une attaque à minuit sur l’impulsion du moment, contre ce qui était probablement les positions ennemies les plus fortement défendues en Afghanistan, s’échauffa fortement.
À la radio Lavoie dit à Fraser que de traverser maintenant n’était pas une bonne idée. C’était trop risqué. Ils ne connaissaient ni le courant d’eau ni la profondeur et aucun passage à gué n’était marqué et ils n’avaient aucune information de la position de l’ennemi.
Bien que la position de Lavoie lui a valu le respect de ses soldats, ce ne fut pas chose facile.
“(Lavoie) et moi avons eu des entretiens plutôt sérieux parce que nous parlions du combat le plus dur auquel nous ayons participé de toute notre carrière militaire”, dit Fraser. “Alors le fait que nous puissions avoir une discussion aussi franche est une indication du degré de confiance et de coopération qu’il y avait entre nous, que nous n’avions pas peur de dire ce que nous avions en tête. Et c’est nécessaire, parce qu’étant commandants, la vie de soldats et d’Afghans est entre nos mains. Nous discutions du grand pas qu’était la traversée de la rivière, métaphoriquement et littéralement, pour aller achever les taliban.”
Néanmoins, cet argument ne servit qu’à faire retarder l’attaque de minuit. Les ordres furent modifiés pour que l’attaque ait lieu à l’aube le 3 septembre, 48 heures avant ce qui avait été prévu au plan et sans le bombardement promis.
Les hommes qui ont dû obéir à ces ordres se posent encore des questions, lesquelles peuvent être résumées ainsi : pourquoi abandonner le plan et lancer l’attaque plus vite que prévu?
En effet, il est difficile de comprendre pourquoi il fallait se dépêcher : les taliban étaient piégés et encerclés, et il ne restait qu’à les décapiter. Comme le remarque Fraser lui-même, le point central de la stratégie des taliban était de les attirer dans un conflit coûteux au sol.
De dire un des officiers du RCR, il ne s’agissait pas d’une force menaçant d’envahir Ottawa qu’il fallait neutraliser coûte que coûte. “Pourquoi se précipiter?” demande un autre officier du RCR. “Nous savons où ils se trouvent, c’est une zone de feu libre.”
En effet, il n’avait pas besoin de se précipiter. Bien que Fraser soit d’accord qu’il y avait une certaine pression pour faire avancer les choses, il dit que ce n’était pas vraiment un facteur.
“La pression venait de partout. J’ai dit à mes supérieurs que nous allions faire les choses comme nous avions l’intention de faire les choses. Ça allait prendre du temps, et ça prit beaucoup de temps.”
À la place, la décision d’avancer le moment de l’attaque fut basée, en grande partie, sur le sentiment de Fraser comme quoi l’ennemi avait été affaibli et qu’on pouvait en profiter.
“Alors les renseignements que je recevais, et aussi les informations que les autres commandants de la force opérationnelle qui faisaient partie de cette bataille, pas seulement Omer Lavoie, et en parlant à des Afghans : on était prêts. On en était à un point où on pouvait en terminer avec ça. Ouais, on aurait pu suivre le plan, mais, je le répète, on commence à ignorer l’ennemi, ce qu’il fait, quels renseignements sont sur place.
“On se guide sur un certain plan pour se battre avec l’ennemi. On ne bat pas un plan. Si on se bat avec un plan, on néglige l’ennemi et on échoue. On a beaucoup de victimes et on échoue. Les plans ne servent qu’à faire réfléchir et à contacter l’ennemi. Et l’ennemi a un vote. Alors, le (1er septembre) ou le (2 septembre), j’ai décidé que la situation se modifiait de sorte que nous pouvions attaquer. Le 2 septembre, j’ai donné l’ordre (à Lavoie) d’attaquer. C’était plus tôt que ce qui était prévu d’après le plan. Eh bien, ça m’est égal le plan.”
Malgré le fait, rendu évident le lendemain matin, que l’évaluation de la situation par Fraser s’est avérée optimiste, l’essentiel pour le général volatil c’est qu’il croit qu’il n’y avait rien à gagner en bombardant pendant 48 heures de plus.
“Eh bien, j’ai écouté ce qu’ils avaient à dire”, dit-il à propos de ses commandants tactiques prudents. “Je savais qu’il y avait beaucoup d’ennemis là-bas. Mais, voyez-vous, combien peut-on en tuer en deux jours de bombardement supplémentaire. Comment le savoir? On devine.
“Qu’importe si on attaque le 2, le 3, le 4, le 5, ou le 6, devinez quoi mesdames et messieurs. C’est difficile de traverser une rivière et aller dans une région défensive principale où les taliban qui veulent se battre attendent. Quel que soit le jour choisi pour traverser la rivière, ça aurait été dévastateur.”
Il se peut que ça aurait été dévastateur, mais d’après les soldats qui l’ont fait, l’événement aurait été bien différent s’ils avaient suivi le plan originaire. Comme le remarque Sprague, le temps supplémentaire aurait donné aux Canadiens plusieurs avantages en plus de réduire, ou même de détruire, les édifices qui allaient donner de si bons abris et d’endroits où se cacher aux taliban.
“Nous aurions pu profiter de ce temps pour faire des feintes, pour forcer les insurgés à réagir à notre manoeuvre. Nous aurions pu manoeuvrer pour les attirer dans des positions où notre puissance de feu aurait pu les décimer ou tout au moins nous aurions pu voir leurs réactions à notre mouvement.”
“Comme le dit le vieux proverbe, ‘le temps passé en reconnaissance est rarement perdu’. Nous n’avons fait aucune reconnaissance. Ainsi donc, nous n’avons pas eu de plan tactique parce que nous n’avons pas eu l’occasion d’en tirer un.”
Malgré les arguments de ses commandants tactiques, Fraser ne s’est pas laissé dissuader.
“La décision a été ‘on va y aller’ et 26 ans d’expérience dans sept opérations différentes me disaient que c’était le moment d’y aller et d’en terminer avec ça.”
Au bout du compte, bien sûr, la seule chose qui ait presque été terminée a été la Compagnie Charles.
Quant à Lavoie, il avait pris position, et vaillamment, mais les ordres sont les ordres et, d’une façon ou une autre, l’attaque devait avoir lieu.
“C’est mon commandant”, dit Lavoie. “Et j’imagine que dans son esprit c’est ça qu’il fallait faire.”
Alors à l’aube, le lendemain, c’est-à-dire le 3 septembre, Sprague a réuni les leaders de son peloton et les officiers de soutien pour passer la consigne rapidement. Avec moins de 15 minutes pour tirer un plan, on ne pouvait pas vraiment dire plus que ‘nous allons traverser. Suivez-moi.’ Ce serait un assaut façon Première Guerre mondiale, face aux armes à feu, bien que sur une plus petite échelle. C’était la charge de la Compagnie Charles.
Alors, avec bien peu de procédure de combat, pas de reconnaissance, et des renseignements qui étaient insuffisants ou même complètement faux, Sprague fit descendre sa force de la rive et dans la rivière. Il s’agissait de la première attaque d’armes mixtes mécanisée de la grandeur d’une compagnie contre une position fixe depuis la guerre de Corée, au milieu de la toute première bataille de l’OTAN, et elle n’avait rien à voir avec la manière dont on les avait entraînés. Elle était précipitée et il y avait beaucoup de risques; la doctrine était tombée à l’eau.
Les sapeurs firent leurs brèches à travers la rivière et sur la rive d’en face, et Charles avança au ralenti jusqu’aux champs de l’autre côté.
Il s’avança dans le territoire ennemi, ne sachant pas ce qui allait arriver.
Tout était calme. Il ne se passait rien encore.
Dans le prochain numéro : les histoires intimes main du combat désespéré de la Compagnie Charles et la malchance interminable de l’unité qui a subi presque 50 victimes en tout juste un peu plus de 24 heures.