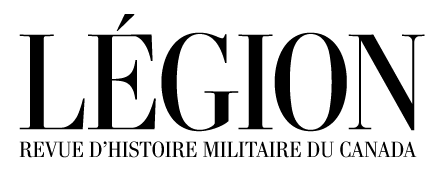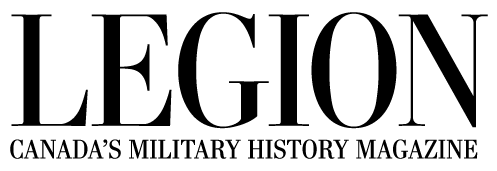Aussi ancienne que la guerre elle-même, la captivité de guerre a connu de nombreuses variations, progrès ou reculs, selon les lieux et les époques. Au cours de l’Humanité, des prisonniers de guerre furent sacrifiés aux dieux, d’autres exécutés pour l’exemple. Certains furent asservis, soumis à un labeur perpétuel et exténuant, alors que d’autres furent recrutés et combattirent par la suite au sein de l’armée qui les avait capturés. Des captifs furent libérés sans condition, d’autres, échangés contre rançon. En fait, durant la plus grande partie de l’histoire humaine, le sort des soldats capturés a été confié à la bonne ou à la mauvaise volonté du geôlier, sans restriction aucune. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, à l’instigation du Comité international de la Croix-Rouge, des lois internationales sont néanmoins instaurées dans le but de réglementer la conduite de la guerre : la Convention de Genève de 1864 et celles de La Haye de 1899 et 1907. Celles-ci tentent timidement de protéger les victimes de la guerre, particulièrement les civils et les prisonniers de guerre. Mises à l’épreuve lors de la Grande Guerre, elles démontrent bientôt de nombreuses lacunes que l’on tente de compenser par la Conférence de Genève de 1929. Imparfaits, ignorés et bafoués par certaines nations, ces accords démontrent tout de même une volonté “d’humaniser” les conflits.
À l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, si la captivité de guerre continue d’être généralement mal vécue, particulièrement par les officiers, la plupart des nations ne considèrent plus le soldat capturé comme un paria. Bien sûr, des exceptions existent : les Soviétiques considèrent leurs soldats capturés comme des traîtres à la patrie, pendant que les Japonais voient les leurs–et ceux de l’ennemi–comme étant déshonorés, indignes. Par ailleurs, le front de l’Est, qui oppose deux “races” et deux idéologies ennemies, voit se dérouler les pires barbaries, au mépris de toute législation. D’autres entorses se produisent et des massacres continuent d’avoir lieu, la plupart du temps aussitôt après la capture, lorsque la fureur des soldats, consécutive à la bataille, ne s’est pas encore estompée.
Cela dit, dans la plupart des pays occidentaux engagés dans le conflit, des structures sont mises en place afin d’aider physiquement et psychologiquement les soldats capturés à l’étranger. Au Canada, le YMCA met sur pied la War Prisoners’ Aid (aide aux prisonniers de guerre) et des parents de prisonniers s’associent et forment la Canadian Prisoners of War Relatives Association (association canadienne des parents des prisonniers de guerre). Mais de toutes les organisations non gouvernementales (ONG) du pays s’étant impliquées dans l’aide aux captifs, c’est la Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) qui s’est, de loin, la plus démarquée. Elle a consacré 47 des 121 millions de dollars de son budget de guerre aux prisonniers de guerre provenant du Canada et du reste du Commonwealth et, dans une moindre mesure, aux internés civils et aux autres prisonniers alliés. Ses interventions prendront deux dimensions : l’une matérielle, directement fournie aux captifs, et l’autre plutôt technique, généralement destinée à leurs parents.
L’aide matérielle s’est principalement traduite par trois sortes de “colis”, ainsi que par quelques autres envois. Chronologiquement, le premier colis reçu par le prisonnier canadien est le “colis de captif” : un paquet contenant de menus objets–brosse à dents, rasoir, savon–et des sous-vêtements, notamment. Il fournit au prisonnier le strict nécessaire en attendant les premiers colis personnels envoyés par sa famille, pour lesquels les délais d’expéditions sont beaucoup plus longs.
Le deuxième type de paquet, le plus connu, est le “colis de vivres”. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et quelques autres pays du Commonwealth en ont produit, avec de légères différences entre eux. Selon des sondages menés auprès d’anciens captifs de diverses origines, peu après leur libération, c’est le colis canadien qui aurait été le plus apprécié. Le Canada en a produit plus de 16 000 000 durant la guerre, à Toronto, Montréal, Hamilton, London, Winnipeg et Windsor. À son apogée, au cours de l’année 1944, la production a atteint près de 200 000 colis hebdomadairement, soit suffisamment pour que les prisonniers provenant du Commonwealth en reçoivent, en principe, un par semaine.
Coûtant en moyenne 2,50 $, le “colis de vivres”, qui pesait 5 kilos, contenait 15 articles de nourriture et 1 savon. Son contenu avait été étudié pour être le plus nutritif possible, tout en considérant les contraintes de poids et d’espace. Il contenait 2000 calories quotidiennes pour 7 jours. Des livres de recettes furent même rédigés spécialement et envoyés aux captifs pour leur permettre de tirer le meilleur parti possible de son contenu. Des colis spéciaux, contenant plus de vitamines, ont également été mis au point pour les malades et les convalescents. Un système d’accusés de réception et de listes de vérification servait à s’assurer que le colis était reçu en bon état et par la bonne personne. Comme ils étaient très bien conçus et solidement emballés, on pouvait en empiler des quantités incroyables et les conserver plus de 15 mois à des températures extrêmes, notamment sous le soleil du désert.
Ces colis ont dépassé leur objectif qui était la nutrition. Par exemple, les boîtes de conserve de lait, une fois vidées, martelées, découpées et assemblées, ont été utilisées par les prisonniers pour fabriquer des trousseaux de cuisine complets, avec assiettes, bols, chaudrons et poêles. Elles étaient également utilisées pour l’aération des tunnels creusés pour les évasions. On rapporte même qu’un système de chauffage fut construit par des captifs en trois mois, grâce à ces boîtes, et qu’il aurait suscité l’admiration des autorités du camp. Par ailleurs, les soldats capturés ont pu, à l’occasion, corrompre certains de leurs geôliers en leur offrant nourriture et cigarettes.
Finalement, en 1945, la SCCR s’est mise à la production du troisième type de colis : le “colis de la libération”. Probablement à cause de la longueur du voyage de retour, beaucoup plus importante, seuls les captifs d’Asie en ont reçu. Ce paquet aurait contenu des vêtements et des accessoires d’hygiène, de quoi tenir le temps du voyage.
Outre ces trois colis, la SCCR a acheminé aux prisonniers, en collaboration avec la Croix-Rouge britannique, des vitamines, des médicaments et du matériel médical. Elle leur a aussi fait parvenir des vêtements, et même de l’équipement sportif, des instruments de musique, des livres et des jeux de société. Parfois, de l’argent était fourni à la Croix-Rouge britannique afin que ce matériel soit acheté en Europe. L’apport loisir fut toutefois négligeable puisqu’il relevait plutôt du YMCA. De concert avec d’autres organismes, la SCCR a contribué à l’éducation des prisonniers en fournissant des manuels et du matériel scolaire. Grâce à la participation de la presse canadienne, un journal d’information a été créé spécialement pour eux.
Le raccompagnement des soldats canadiens libérés, depuis l’Europe ou l’Asie, a été assuré par des responsables qui les suivaient avec jeux et cantines, pour s’assurer qu’ils mangeaient bien et ne s’ennuyaient pas. Ce même service fut aussi fourni aux Britanniques rapatriés depuis l’Asie et transitant par le Canada.
De son côté, l’aide indirecte s’est souvent faite par l’intermédiaire des familles des captifs. Par exemple, le Bureau d’investigation de la Croix-Rouge fut créé à Ottawa en janvier 1942, avec la collaboration du ministère des Affaires extérieures et du Comité international de la Croix-Rouge. Son principal mandat était de répondre gratuitement aux demandes de renseignements, émanant de la population canadienne, sur le sort d’un prisonnier de guerre, d’un interné civil ou d’un disparu.
Aussi, par l’intermédiaire de nombreuses publications, la SCCR divulguait une grande quantité de renseignements pratiques. Des brochures, par exemple, ont traité des façons de communiquer avec les prisonniers ou de ce qu’il était possible de leur envoyer. On distribuait aussi aux parents le journal The Prisoner of War (le prisonnier de guerre), qui contenait des consignes, des caricatures, des nouvelles des camps, des extraits de lettre, et beaucoup d’autres choses. À l’origine, le journal était exclusivement produit par la Croix-Rouge britannique, mais à partir de novembre 1942, on retrouve une édition à moitié canadienne. Avant cette date, 15 000 exemplaires du journal étaient envoyés d’Angleterre lors de chaque parution, mais ce mois-là, le bateau assurant la livraison fut coulé par un sous-marin. Seul un exemplaire, envoyé en catastrophe par avion, est arrivé au Canada. Avant que des copies en soient tirées, le journal fut modifié. Par la suite, vu le succès et l’intérêt suscité, la SCCR a répété l’expérience.
La SCCR a également ?uvré auprès des parents des captifs pour la confection des “colis du plus proche parent”, un colis personnel envoyé tous les trois mois par la famille du soldat capturé. C’était un paquet contenant des vêtements, de menus objets et, à une certaine époque, de la nourriture. La SCCR a facilité ces envois en remplaçant les articles qui avaient été confisqués par la censure par des articles autorisés, en ajoutant des produits si le paquet n’atteignait pas la limite de poids permise et en donnant des formations et des conseils sur la confection de ce paquet. Si un prisonnier n’avait pas de parent ou si ce dernier était trop pauvre, la Croix-Rouge le prenait en charge en attendant qu’il soit “adopté” par quelqu’un d’autre.
Cela dit, aider les prisonniers n’a pas été une mince affaire, puisque plusieurs problèmes ont surgi, particulièrement dans la confection et l’envoi des colis de vivres. Matériellement, on a dû faire face à des pénuries qui ont obligé les responsables à trouver des substituts ou à acheter des denrées à l’étranger. On a même rationné le personnel militaire au Canada pour avoir davantage de nourriture à offrir aux captifs. Sur le plan technique, à part quelques exceptions, le Japon a refusé toute coopération jusqu’aux derniers mois de la guerre. De leur côté, l’Allemagne et l’Italie ont généralement bien répondu, mais on a tout de même éprouvé certaines difficultés. La censure allemande a, par exemple, refusé certains emballages qu’elle ne pouvait contrôler, et il est arrivé que, dans les camps, la distribution des vivres serve de monnaie d’échange à la bonne conduite des captifs. Pour éviter l’emmagasinage de vivres pouvant servir lors d’une éventuelle évasion, les autorités ont parfois poinçonné les conserves afin que leur contenu soit consommé rapidement. Et il ne s’agit là que d’une partie des nombreuses difficultés rencontrées. On pourrait également évoquer les relations parfois houleuses de la SCCR avec d’autres ONG, et même avec le gouvernement fédéral.
La productivité et l’efficacité de l’aide aux prisonniers de guerre peuvent être attribuées à plusieurs facteurs, dont le premier est certainement la participation populaire. La SCCR a su mobiliser un grand nombre de bénévoles, les transportant dans des autobus empruntés ou leur confiant quelque ouvrage à faire chez eux, à temps perdu. C’est ainsi que des femmes au foyer accomplissaient certains petits travaux entre une lessive et un repas, alors que des écoliers besognaient pendant les récréations. Tout ça a donc permis que la plus grande partie du travail soit faite gratuitement et que les fonds soient vraiment utilisés dans l’achat de denrées plutôt que dans leur transformation. De plus, les locaux ont été aménagés de manière à éviter les pertes de temps et d’espace, et à ce que les colis de vivres soient empaquetés à la chaîne. De grosses compagnies ont également pu se donner une bonne image publique en assurant le transport des denrées à peu de frais ou en les fournissant. Finalement, des campagnes de financement bien montées et convaincantes ont permis d’amasser les sommes nécessaires à l’entreprise. La SCCR a donc tiré le maximum de chaque dollar tout en amenant près du sixième de la population à s’engager dans ses activités : une logistique efficace a été mise au point, sans être bureaucratique et coûteuse.
Évidemment, les effets de cette aide ont été positifs; de nombreuses lettres, conférences et entrevues en témoignent. Ils furent d’abord bénéfiques à court terme en permettant la survie d’un grand nombre de prisonniers qui, autrement, auraient certainement succombé à la faim, au froid, à la maladie ou aux blessures. En leur offrant des loisirs, en leur montrant que leur pays ne les avait pas oubliés, la SCCR a également contribué au maintien du moral des prisonniers. Cela a pu amoindrir, chez certains, les effets du “syndrome des barbelés”, qui se traduisent par un état dépressif et un désintérêt de tout. L’aide prodiguée par la Croix-Rouge fut aussi bénéfique à moyen terme, c’est-à-dire après le retour des soldats libérés. D’abord, l’éducation des prisonniers dans les camps a permis de récupérer une jeunesse perdue en fournissant les outils nécessaires à l’obtention d’un bon emploi. En diminuant l’écart, autant que possible, entre la vie dans les camps et la vie civile, ces actions ont permis de maintenir le moral et la santé des soldats capturés et de faciliter leur retour à la vie civile.
On peut aussi croire aux effets à long et à très long terme, non seulement pour les prisonniers, mais également pour la société en général. Effectivement, cette aide a permis une diminution des coûts sociaux dans l’après-guerre parce que plusieurs anciens prisonniers, en relativement bonne forme physique et mentale, n’ont pas dus être pris en charge par l’État. Donc, plus d’argent a pu être investi dans la reconstruction, et on a pu compter sur la participation et sur l’expertise de ces anciens combattants rescapés.
Il faut tout de même prendre en compte que, là où l’aide était fournie, donc acceptée par les autorités des camps concernés, les captifs étaient généralement bien traités. Leur bon état n’est donc pas dû exclusivement à l’aide apportée mais aussi aux conditions de vie relativement acceptables déjà instaurées. Or, là où les prisonniers de guerre étaient assujettis aux pires conditions de vie, ni la SCCR, ni aucune des autres Croix-Rouge alliées, ne sont parvenues à s’imposer. Leur secours y auraient pourtant été d’autant plus salutaire. Ce fut par exemple le cas dans les camps japonais.
En conclusion, l’aide fournie par la Société canadienne de la Croix-Rouge aux prisonniers de guerre a pris diverses formes. Des millions de colis et des tonnes de denrées en vrac envoyés aux camps ont assuré aux prisonniers canadiens, à ceux provenant des autres pays du Commonwealth, et dans une moindre mesure, aux autres Alliés, une alimentation variée et équilibrée. Ils ont facilité leur convalescence et leur ont permis de garder le moral dans les moments les plus durs. Malgré des obstacles récurrents–dus principalement à des pénuries de matériel, à la destruction des infrastructures et à la mauvaise volonté des pays geôliers–cette aide a pu être menée à bien, du moins sur le théâtre européen.
Beaucoup reste encore à dire. L’aide apportée par la SCCR aux prisonniers alliés, et particulièrement à ceux provenant de la France Libre, n’a été le sujet d’aucune recherche, malgré la disponibilité des sources. Le rôle de la population et des médias dans l’?uvre de la Croix-Rouge a également été sous-évalué et il mériterait d’être reconnu à sa juste valeur. Les liens unissant la Croix-Rouge canadienne aux autres Croix-Rouge alliées demeurent nébuleux, de même que ses relations avec le gouvernement fédéral.
En fait, le rôle de la plupart des organismes humanitaires canadiens durant la Seconde Guerre mondiale a été particulièrement négligé par les historiographes, à quelques exceptions près. Jonathan Vance est l’un des seuls historiens sérieux à avoir apporté un éclairage sur cette dimension de l’histoire militaire. Pourtant, alors que le déroulement– parfois à la minute près–des grandes batailles n’a plus rien de secret, il paraît incongru que les activités de ceux et celles ayant permis la survie de millions d’individus, une fois que les canons se sont tus, demeurent inconnues. Leur travail et leur dévouement ont été, et demeurent cruciaux, durant les conflits, car à leur manière, à défaut de l’avoir enrayée, ils ont su humaniser la pire des calamités.