
Mackenzie King était indubitablement un singulier personnage. Ainsi, l’homme qui fut le premier ministre du Canada au pouvoir le plus longtemps rendait visite à des médiums pour tenter de communiquer avec les morts, notamment des dirigeants politiques, de vieux amis et sa mère. Il en aurait tiré plus de réconfort que de conseils. Célibataire, il ne pouvait se tourner vers sa moitié, cela comblait donc un vrai besoin.
King avait aussi des traits obsessionnels : il notait si les aiguilles de l’horloge étaient ensemble (ou décalées) lorsqu’il prenait des décisions, et examinait les formes que dessinaient sa crème à raser ou les feuilles de thé dans sa tasse. Ses terriers irlandais (tous nommés Pat) qui se sont succédé étaient caressés, choyés et vénérés. Il tint un journal pendant plus de 50 ans, son autre confident, ce qui était sa manière d’indiquer ce qu’il avait fait ou, plus important encore, ce qu’il avait empêché au jour le jour.
Mais, King n’était pas fou. Il fut élu chef des libéraux en 1919 en partie parce qu’il avait été fidèle à Wilfrid Laurier lors du débat sur la conscription pendant la Grande Guerre. Cela comptait aux yeux des Québécois francophones. Et il avait écrit un livre, Industry and Humanity (L’industrie et l’humanité, NDT) presque illisible (et peu lu), mais qui, aux yeux des délégués au congrès, faisait de lui un expert des conflits sociaux qui avaient secoué le Canada après la Première Guerre mondiale.
Ensuite, King remporta les élections de 1921, perdit les suivantes de justesse quatre ans plus tard, et reprit le pouvoir en 1926. Il fut évincé en 1930, obligeant les conservateurs à gouverner pen-dant les pires années de la Grande Dépression, mais redevint premier ministre en 1935. King n’était peut-être pas très charismatique, et il n’avait pas offert au Canada un bilan de remarquables réussites, mais c’était un gagnant.
Lorsque les Allemands envahirent la Pologne début septembre 1939 et que la Grande-Bretagne déclara la guerre, le 3 septembre, King sut que le Canada devait se joindre aux combats. Il avait cependant promis que « le Parlement déciderait ». Le pays, tout en restant dominion de l’Empire britannique, contrôlait sa politique étrangère grâce au Statut de Westminster de 1931. Alors, le Canada n’entra pas (encore) en guerre.
Le Parlement la prit, cette décision, et le pays se joignit au conflit le 10 septembre. Le délai de réflexion, les promesses qu’il s’agirait d’une guerre « à responsabilité limitée » et qu’il n’y aurait pas de conscription pour le service outre-mer, tout cela avait une grande importance, surtout au Québec, où la plupart des gens n’étaient pas enthousiastes à l’idée de prendre part aux combats.
La politique du chef de l’État avait cependant préparé les francophones à accepter que le Canada devienne l’un des belligérants, ce que souhaitaient la plupart des Canadiens anglophones. L’unité nationale comptait pour King et son Parti libéral.
Il fut facilement réélu en mars 1940 avec 51 % du vote populaire et 179 des 245 sièges à la Chambre des communes.
Son cabinet de guerre était fort, avec de solides ministres libres de gérer leurs ministères. Clarence (C.D.) Howe contrôlait la production en temps de guerre. Ernest Lapointe était son lieutenant au Québec et, après sa mort fin 1941, Louis St-Laurent le remplaça et fut nommé ministre de la Justice. Le colonel J. Layton Ralston, officier fantassin qui s’était distingué pendant la Première Guerre mondiale, dirigea le ministère de la Défense de 1940 à la fin de 1944. James L. Ilsley était un ministre des Finances compétent, et Jimmy Gardiner était à la tête de l’Agriculture.
En outre, les principaux fonctionnaires de King, Graham Towers à la Banque du Canada, Arnold Heeney au Bureau du Conseil privé, Oscar D. Skelton et Norman Robertson aux Affaires étrangères et Clifford Clark aux Finances, lui fournirent les idées qui façonnèrent l’effort de guerre. Et qui transformèrent à jamais le Canada.
Mais, la responsabilité limitée que King avait prévue finit rapi-dement aux oubliettes.
Les nazis envahirent le Danemark et la Norvège en avril 1940, puis les Pays-Bas et la France en mai. Au début du mois de juin, la Grande-Bretagne était au bord de la défaite. La 1re Division canadienne en Angleterre, bien que partiellement entrainée, était presque la seule force pouvant résister à ce que la plupart considéraient comme l’inévitable invasion de l’ile par les Allemands. L’effort de guerre canadien devait alors changer.
La conscription pour la défense intérieure fut promulguée par la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales en juin, et les premiers conscrits se présentèrent en octobre. La marine envoya tout ce qu’elle pouvait outre-mer, l’Aviation royale du Canada déploya ses quelques escadrilles et le Programme d’entrainement aérien du Commonwealth britannique accéléra ses efforts. L’armée intensifia le recrutement, créant des bataillons, des brigades et des divisions aussi vite qu’elle le pouvait. Les fonds, à sec pendant la dépression et rares en 1939-1940, n’étaient plus un problème, et les industries de guerre canadiennes se lancèrent dans la fabrication de tout : camions, armes à feu, navires, avions.
King et le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, conclurent également des accords. Tout d’abord, celui d’Ogdensburg, en aout 1940, pour créer un plan de défense conjoint Canada–États-Unis.
Ensuite, la déclaration de Hyde Park, l’année suivante, qui garantissait que les deux pays travailleraient ensemble à la production en temps de guerre et que le Canada ne manquerait pas d’argent américain pour acheter ce qu’il lui fallait.
King négocia lui-même ces deux traités avec FDR, avec qui il entretenait des liens d’amitié. Et ceux-ci étaient cruciaux.
En 1943, le Canada était devenu une puissance militaire.
On comptait 10 000 réguliers dans les trois services avant la guerre. Et tout à coup, la Première Armée canadienne était en Grande-Bretagne, des escadrilles d’avions volaient dans tous les théâtres de la guerre, et la Marine royale du Canada affrontait des U-boot et escortait des convois.
Parallèlement, les usines et les exploitations agricoles produisaient de grandes quantités d’armes et de nourriture. Les salaires et les prix étaient étroitement règlementés, les impôts augmentaient chaque année et les Canadiens, forts du plein emploi, achetaient des obligations d’épargne en nombre record pour financer tout l’équipement. C’était une guerre totale, gérée par le gouvernement de King.
Mais, pour beaucoup de gens, la guerre totale devait rimer avec la conscription pour le service outre-mer. La plupart des conservateurs et certains libéraux (dont une poignée au cabinet) le préconisaient aussi vivement. Début 1942, le premier ministre décida d’organiser un plébiscite en posant une question quelque peu indirecte : « Êtes-vous en faveur de libérer le gouvernement de toute obligation découlant de tout engagement passé limitant les méthodes de recrutement d’hommes au service militaire? ». Cela équivalait à dire « oui » ou « non » au service obligatoire.
Au Québec, une grande majorité se prononça pour le non; une majorité semblable dans le reste du pays dit « oui ». Et King répondit « peut-être », prononçant le 10 juin au Parlement ce qui est peut-être sa phrase la plus célèbre : « la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription. »
Comment définirait-il la nécessité? Au début de cette année-là, les pertes étaient relativement faibles et l’armée ne livrait pas encore de combats soutenus (à l’exception de la catastrophe à Hong Kong et de la débâcle imminente à Dieppe), il y avait donc peu d’arguments crédibles en faveur du service obligatoire. Mais, la plupart des gens s’attendaient à des pertes, notamment dans l’ARC, qui effectuait des raids de bombardiers au-dessus de l’Allemagne, et dans la MRC, qui combattait les U-boot en Atlantique Nord.
À la mi -1943, la 1re Division et une brigade blindée débarquèrent en Sicile; en septembre, elles se joignirent à l’invasion de l’Italie, et la 5e Division blindée les y rejoignit peu après. Les combats à Ortona, à Noël, furent intenses, et la campagne d’Italie progressa lentement.
Les Alliés pénétrèrent en France le 6 juin 1944, la 3e Division canadienne et une brigade blindée jouant un rôle essentiel pendant le débarquement. Au cours des deux mois suivants, la 2e Division d’infanterie et la 4e Division blindée s’engagèrent dans la bataille et les pertes furent lourdes. Les combats qui avaient pour but d’ouvrir l’estuaire de l’Escaut au trafic maritime eurent lieu en octobre et en novembre, et ils menèrent à de nouvelles pertes importantes. Il y eut quelque 5 000 morts en Normandie, et les Canadiens subirent plus de 6 000 autres pertes aux combats de l’Escaut; sans compter les nombreuses victimes parmi les fantassins en Italie, où eurent lieu les combats acharnés nécessaires pour briser les lignes allemandes Hitler et Gothic. En automne 1944, c’était la crise au front et au Canada.
Le flot des renforts créé par l’armée se basait sur ce qu’elle prévoyait comme pertes. Les planificateurs s’attendaient à de lourdes pertes parmi les fantassins, ainsi qu’à un nombre important de victimes parmi les troupes d’appui à cause des attaques aériennes des Allemands. Toutefois, la Luftwaffe avait quasiment été chassée du ciel et, par conséquent, il y avait plus de soldats aux arrières que nécessaire alors que le nombre des fantassins était insuffisant. Où, demanda le gouvernement à ses généraux, pourrait-on trouver des fantassins? Seulement parmi les troupes de défense intérieure, répondirent-ils.
King en fut horrifié, car il croyait que la guerre était presque gagnée. Le ministre de la Défense, Ralston, et au moins sept autres ministres insistèrent tout de même pour que les conscrits de la défense inté-rieure soient envoyés à l’étranger.
King congédia brutalement Ralston lors d’une réunion du cabinet, et nomma le général Andrew McNaughton à sa place. Les ministres qui avaient voté pour la conscription étaient stupéfaits. McNaughton avait dirigé l’armée de 1939 à la fin de 1943, et il n’était pas en faveur de la conscription. Il entreprit de chercher des volon-taires parmi les hommes de la défense nationale, mais il échoua.
Peu après, quelques officiers supérieurs parlèrent du manque de fantassins aux médias, ce que King interpréta comme des signes précurseurs d’une révolte de militaires. Il sentait également qu’il risquait de perdre l’appui des ministres proconscription. Il fit volte-face le 22 novembre 1944, annonçant que 16 000 conscrits, assez pour répondre aux besoins de l’infanterie, seraient déployés outre-mer. Tout aussi important, King solidarisa son cabinet et son caucus, perdant seulement le ministre de l’Aviation, Charles G. Power. La crise politique était terminée, et une pause hivernale dans les combats donna le temps à l’armée de se rétablir et de renouveler ses rangs.
Une fois l’enjeu de la conscription réglé, King pouvait passer à d’autres questions auxquelles il attachait de l’importance. Il croyait en la création de l’État-providence, et comme une élection était prévue en 1945, il estimait que de nouveaux programmes pourraient l’aider à séduire les électeurs. Son gouvernement avait mis en place l’assurance-chômage en 1940, une étape de son vaste plan.
Pendant ce temps, le ministre
des Anciens Combattants, Ian Mackenzie, avait également travaillé sur la création d’avantages pour les militaires, et la Charte des anciens combattants était prête à être dévoilée. Elle offrait de tout aux gens qui avaient servi : argent, vêtements, éducation, formation, terre, du soutien pour lancer une entreprise et des soins médicaux gratuits. Cette initiative, bien meilleure que les offres qui avaient été faites aux vétérans de la Grande Guerre, était aussi bonne que n’importe quel programme pour ancien combattant dans le monde, et bien meilleure que la plupart d’entre eux. Le fait que les femmes y étaient traitées sur un pied d’égalité avec les hommes était également notable.
Les allocations familiales, premier programme universel du pays, étaient également remarquables, car elles étaient versées directement aux mères. Pour certaines, l’allocation familiale était le seul argent qui leur appartenait de droit, et elle fut appuyée partout au pays, sauf par certains critiques de l’opposition qui faisaient valoir que les familles nombreuses du Québec et des hommes qui ne se battraient pas en profiteraient. Bien des Québécois avaient, en effet, des familles nombreuses, mais l’enrôlement militaire dans la province était d’environ trois fois supérieur à celui de la Première Guerre mondiale. Le paiement moyen par enfant était de 5,94 $ (soit environ 100 $ d’aujourd’hui) par mois. Donner des fonds aux mères pour qu’elles les dépensent pour leurs enfants servirait à maintenir l’économie, et les entreprises et les agriculteurs canadiens en profiteraient aussi.
Le gouvernement de King se préparait également à faire face à un ralentissement de l’économie d’après-guerre très redouté. Le produit national brut du Canada avait plus que doublé pendant le conflit, mais la fin de la production de munitions et le retour d’hommes et de femmes au pays pourraient avoir un impact négatif. Des sommes importantes furent consacrées à la construction de logements pour les anciens combattants, au soutien des agriculteurs et à l’aide aux entreprises pour convertir les lignes de production à la fabrication des temps de paix. Parallèlement, les bureaucrates dressaient des plans pour de grands projets gouvernementaux qui pourraient employer des milliers de personnes.
« Vous, les socialistes, avez des projets, déclara un député libéral à un ami de la Fédération du Commonwealth coopératif (CCF), mais j’ai les factures ici, dans ma poche. »
King convoqua des élections pour le 11 juin 1945, un mois après le jour de la victoire en Europe, alors que la guerre contre le Japon continuait et que le Canada se préparait à y engager des forces. Cela conduisit les progressistes-conservateurs à demander la conscription pour le Pacifique; le CCF, quant à lui, s’attendait à bien faire avec sa plateforme socialiste.
King, cependant, faisait campagne, comme il le dit, « non pas du point de vue des promesses, mais de rendement ». Ses candidats exhortaient les électeurs à « finir le travail » et appelèrent à l’unité nationale et à la sécurité sociale. Le résultat fut serré. King obtint une mince majorité avec 118 sièges; les conservateurs en eurent 66 et le CCF, 28. Les libéraux remportèrent également la majeure partie du vote militaire.
Cette victoire a été interprétée comme une reconnaissance des réalisations de King qui avait dirigé le Canada dans son étonnant effort de guerre. Il avait maintenu l’unité dans le pays, contrairement à Robert Borden, premier ministre à la Grande Guerre. La nation, sous sa direction, produisit des résultats spectaculaires dans les champs de bataille, en mer, dans les airs et dans les usines et les fermes du front intérieur.
King fut donc un chef à un moment où il fallait l’être.

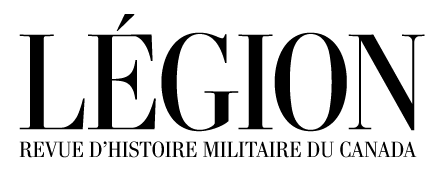
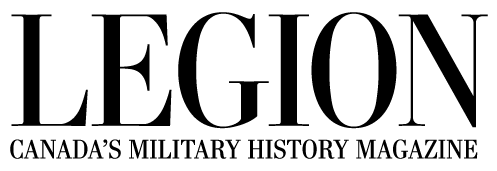



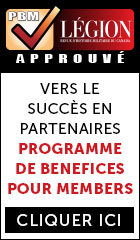




Comments are closed.