Bien qu’animé par une passion indéfectible pour l’aviation, Fred Ashbaugh se retrouva vite décontenancé, voire décou-ragé, lorsqu’il aborda le Plan d’entrainement aérien du Commonwealth britannique.
Le jeune agriculteur albertain s’était enrôlé en 1940, à l’âge de 21 ans, parce que « c’était la guerre, et [il] n’aimait pas ce que faisaient les Allemands ». L’armée de l’air, confia-t-il, lui semblait être la meilleure option.
Ce programme novateur visant à faire du Canada un vaste terrain d’entrainement pour aviateurs militaires fut mis sur pied en quelques mois, et ses recrues passaient par un dépôt des effectifs à Toronto.
Le « dépôt des effectifs n° 1 » n’avait rien de supérieur. Situé dans le bâtiment Coliseum sur le terrain de l’Exposition nationale canadienne, il pouvait accueillir jusqu’à 5 000 personnes.
« Ça a été un choc », a raconté M. Ashbaugh lors d’un entretien en 2009 dans le cadre de la Collection d’histoire orale militaire canadienne compilée par Reginald H. Roy, historien à l’Université de Victoria. « Nous étions dans l’étable à vaches, sur deux niveaux. Nous étions entassés là-dedans […]. La nourriture était infecte. C’était vraiment déroutant.
« Ils avaient une sorte d’accord avec un traiteur qui pouvait faire les meilleurs œufs caoutchouteux que vous ayez jamais goutés de votre vie. La seule chose qui était vraiment bonne là-bas, c’est qu’on pouvait boire du lait tant qu’on voulait. Et on pouvait manger du pain et du beurre à volonté. Mais, le reste de la nourriture était infecte. »
Dans les premiers temps, il s’agissait d’une formation militaire, sans vol ni combat. Les recrues apprenaient à se laver, à se raser, à faire briller leurs bottes, à polir leurs boutons, à entretenir leurs uniformes et à respecter les ordres. Il y avait deux heures d’éducation physique quotidiennes et des formations sur la marche, des exercices avec le fusil, des manœuvres à pied, de l’instruction sur le salut et autres activités militaires de routine.
Il y aurait bientôt quatre autres bassins de formation : Brandon (Man.), Edmonton, Québec et Lachine (Qc). La nourriture s’est même améliorée. Mais, Fred Ashbaugh était alors déjà plus près du front et à l’orée de ses 62 missions de combat dans cette Europe occupée par les nazis où il pilota des bombardiers Stirling et Wellington.
D’autres dépôts finirent par être ajoutés : Picton (Ont.), Swift Current (Sask.), Penhold (Alb.) et Souris (Man.). Deux dépôts du Service féminin furent établis : l’un à Toronto en octobre 1941 et l’autre, un an plus tard, à Rockcliffe (Ont.).
La France était le dernier domino à tomber lors de la guerre éclair des nazis à travers l’Europe continentale. Du 26 mai au 4 juin, quelque 338 226 soldats alliés, pour la plupart britanniques, avaient été évacués de la plage de Dunkerque, la majeure partie de leurs armes et de leur équipement abandonnée à l’envahisseur.
Le joyau potentiel de la couronne auquel aspirait Hitler, la Grande-Bretagne, se trouvait juste de l’autre côté de la Manche. Début juillet, les premières étapes d’une invasion allemande prenaient forme alors que la Luftwaffe intensifiait sa campagne de destruction des forces aériennes britanniques avant de lancer un assaut amphibie sur les plages.
On le savait depuis des mois. Et les planificateurs militaires prévoyaient, ce qui semble évident aujourd’hui, que les iles britanniques ne seraient pas un bon endroit où former les pilotes et les équipages dont on avait tant besoin. Il fallait chercher ailleurs. Le Canada offrit ses services.
Le 17 décembre 1939, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande signèrent un accord pour créer le Plan d’entrainement aérien du Commonwealth britannique : le PEACB, ou tout simplement, « le Plan ».
Le choix se porta sur le Canada en raison de ses conditions météorologiques et de ses grands espaces propices à l’aviation, ainsi que de son approvisionnement suffisant en carburant, de sa capacité de production d’avions et de pièces, de sa proximité relative aux théâtres de guerre européens et possiblement du Pacifique, et de l’absence de menace ennemie.
L’ambitieux programme prévoyait à l’origine trois écoles de formation, 13 écoles élémentaires de pilotage, 16 écoles de pilotage militaire, 10 écoles d’observation aérienne, 10 écoles de bombardement et de tir, deux écoles de navigation aérienne et quatre écoles de radionavigants. Le gouvernement construisit 7 000 hangars, casernes et salles d’exercices.
La plupart des écoles d’entrainement disposaient de trois pistes de 30 mètres (100 pieds) de largeur et de 762 mètres (2 500 pieds) de longueur chacune. La quantité de béton utilisé aurait pu servir à construire une autoroute à deux voies entre Ottawa et Vancouver.
Les quatre gouvernements se parta-gèrent les couts de 2,2 milliards de dollars du Plan (environ 43 milliards de dollars de 2024), mais le Canada en régla la majeure partie : 1,6 milliard de dollars (36 milliards de dollars d’aujourd’hui).
À son apogée, fin 1943, 104 000 membres du PEACB dirigeaient 107 écoles et 184 unités de soutien dans 231 lieux d’un bout à l’autre du Canada. Le programme faisait voler 3 540 avions et servait même à former des Norvégiens, des Polonais et des Français en exil.
Le Canada devint ce que le président américain Franklin D. Roosevelt appelait « l’aérodrome de la démocratie ».
Le premier cours de formation canadien fut donné à Toronto le 29 avril 1940, et 39 diplômés en sortirent cinq mois plus tard. Ils restèrent tous au Canada en tant qu’instructeurs ou pilotes d’état-major. Les premiers observateurs canadiens, une trentaine, envoyés à l’étranger en octobre 1940, étaient des diplômés de l’école de Trenton, en Ontario.
Les recrues passaient un test d’apti-tude standard : le test de classement de l’Aviation royale du Canada. Des études secondaires de rattrapage permettaient aux stagiaires de 17 et 18 ans d’atteindre le niveau scolaire qu’exigeait l’ARC.
On assignait souvent des « tâches à l’aérodrome » aux stagiaires pour les occuper. Certains étaient envoyés dans des usines pour compter écrous et boulons, d’autres étaient répartis dans des écoles de pilotage ou dans d’autres installations de l’ARC pour effectuer des travaux de garde, de nettoyage, de peinture ou de polissage d’équipement. Les « tâches à l’aérodrome » pouvaient durer plusieurs mois.
Fred Ashbaugh, qui allait être décoré en tant que pilote de bombardier, fut même envoyé monter la garde au Nouveau-Brunswick pendant 28 jours.
Des détachements de formation préalable du personnel navigant furent établis dans les campus d’université du pays pour dispenser l’enseignement en mathématiques, en physique, en anglais et dans d’autres matières demandées par l’ARC aux recrues du personnel navigant n’ayant pas reçu l’éducation nécessaire. Cela réduisit considérablement les échecs plus tard dans la formation.

Au bout de quatre ou cinq semaines, un comité de sélection décidait si les stagiaires seraient placés dans le volet du personnel navigant ou dans celui des équipes au sol. Les candidats radiotélégraphistes-mitrailleurs étaient envoyés directement dans une école de radionavigants; les observateurs aériens (navigateurs) et les candidats pilotes rejoignaient l’une des sept écoles préparatoires de l’aviation où ils passaient les quatre premières semaines du programme, qui durait entre 26 et 28 semaines.
Ils étaient soumis à une série de tests, dont un entretien avec un psychiatre, un examen physique M2 de quatre heures, une séance dans un caisson hypobare et un « vol d’essai » dans un simulateur Link.
« Toute la série était une sélection, déclara Fred Ashbaugh. Les instructeurs surveillaient tout le monde tout le temps […], ils prenaient de petites notes. »
En classe, les candidats pilotes et observateurs aériens étudiaient la navigation, la théorie du vol, la météorologie, les fonctions d’officier, l’administration de l’aviation, l’algèbre et la trigonométrie.
Ensuite, ils passaient à l’école élémentaire de pilotage – il y en avait 32 – où les clubs de pilotes dispensaient aux stagiaires, au fil des huit semaines, une formation de base de 50 heures de vol sur des avions-écoles simples, tels que le Havilland Tiger Moth, le Fleet Finch ou le Fairchild Cornell.

Les diplômés du programme « apprendre à voler » enchainaient avec 16 semaines dans une école de pilotage militaire, où ils passaient huit semaines dans une escadrille d’entrainement intermédiaire, six semaines dans une escadrille d’entrainement avancé et deux semaines dans l’une des 30 écoles de bombardement et de tir, le tout admi-nistré par l’ARC ou par la Royal Air Force.
Les espoirs du pilotage de chasse étaient formés à l’aide d’avions nord-américains Harvard et Yale. Les pilotes de bombardiers, les pilotes côtiers et les pilotes de transport stagiaires fréquentaient d’autres écoles où ils apprenaient à piloter des avions multimoteurs Airspeed Oxford, Avro Anson et Cessna Crane.
Les apprentis navigateurs passaient huit semaines dans l’une des 10 écoles d’observation aérienne, un mois à l’école de bombardement et d’artillerie (il y en avait 11) et un mois à l’école de navigation (il en existait six). Les écoles d’observation aérienne étaient dirigées par des civils sous contrat avec l’ARC; la CP Airlines, par exemple, dirigeait les nos 7, 8 et 9, bien que les instructeurs fussent membres de l’ARC.
La navigation à l’estime et le pilotage visuel étaient les techniques de base enseignées tout au long des années de guerre. Formés dans des Avro Anson, les navigateurs en herbe utilisaient des cartes aéronautiques, des boussoles magnétiques, des montres, des journaux de voyage, des crayons, des rapporteurs d’angle Douglas et le calculateur de navigation à l’estime Dalton, un appareil manuel rond sans rien de semblable aux calculateurs modernes.
Deux écoles de formation au sol de mitrailleurs de bord furent créées à Trenton (Ont.) et à Québec pour combler le manque inquiétant de mitrailleurs de bord à l’étranger. On y dispensait un cours préparatoire de six semaines sur l’utilisation et l’entretien des mitrailleuses lourdes, ainsi que des exercices d’entrainement physique et un entrainement aux armes légères.
Les radiotélégraphistes mitrailleurs passaient 24 semaines à l’école de radionavigants où ils apprenaient la théorie et la pratique de la communication sans fil, notamment la signalisation à l’aide de lumière et de drapeaux en plus de la radio. Ils finissaient par quatre semaines dans une école de bombardement et de tir.
Les écoles de reconnaissance générale formaient des pilotes et des observateurs aériens en patrouille océanique. Les pilotes passaient les 8 à 14 dernières semaines dans des unités d’entrainement opérationnel où ils apprenaient à piloter des avions de chasse, comme le Hawker Hurricane ou le Fairey Swordfish. Ils y étaient formés par de vrais pilotes d’avion de chasse qui avaient été affectés aux unités d’entrainement opérationnel après des opérations. Ils n’étaient pas tous ravis de se retrouver là.
À 21 ans, Fred Ashbaugh était relative-
ment vieux pour une recrue.
Il a raconté que la nourriture et les con-ditions de vie dans les écoles élémentaires de pilotage étaient « plutôt rudes ».
« C’était horrible, dit-il. Mais, les forma-tions au pilotage et au sol étaient très bonnes. »
Son premier vol fut sur un Fleet Finch, en novembre 1941, avec un instructeur du nom de Moon qui fit faire une boucle et une vrille à l’avion – « Je pense qu’il voulait savoir si j’allais vomir ou pas; mais non […]. J’ai adoré ça. »
Il prit seul les commandes dans un Fleet Finch après 11 heures de formation de pilotage.
« C’était assez effrayant. À ce moment-là, on est là-haut tout seul, avec 10 à 12 heures de vol, et il faut atterrir sans abimer l’appareil. Alors, une fois qu’on est sur le plancher des vaches, on pousse un grand soupir de soulagement.
« C’était très excitant, et c’était très gratifiant. »
Fred Ashbaugh partit le 4 janvier 1941 à Summerside, sur l’Île-du-Prince-Édouard, pour suivre une formation de pilotage militaire.
« Nous étions la toute première classe à Summerside, confia-t-il à Reginald H. Roy. Quand nous sommes arrivés, il n’y avait pas d’instructeur, pas d’avion, il n’y avait rien. »
L’établissement était commandé par un lieutenant d’aviation qui, n’ayant pas de personnel pour former ses troupes, leur accorda des laissez-passer de 48 heures. « Nous lui avons dit : “Désolé, nous n’avons pas d’argent”. Il y avait eu un problème avec notre solde, nous n’avions pas été payés.
« Alors, il s’est arrangé avec une banque pour nous donner chacun un chèque de 5 $. Imaginez un peu : 5 $ pour un laissez-passer de 48 heures. Il a dit [au directeur de la banque] : “Je sais que je n’ai pas assez en banque, pourriez-vous m’avancer ça?”
« Et le directeur de la banque lui a répondu oui, bien sûr. Parce que nous étions les élus de Dieu : les premiers aviateurs avec nos petits titres d’épaule blancs.
« Nous sommes tous allés au village et avons encaissé nos chèques de 5 $. Et la plupart d’entre nous avons passé toute la fin de semaine à Summerside, et nous avions encore de l’argent en poche quand nous sommes retournés au poste parce que les gens nous avaient bien accueillis. Ils avaient été merveilleux. L’hôtel nous facturait 25 ou 50 cents par chambre. »
Les avions, des Harvad, ne sont arrivés que deux semaines après. « C’était comme passer d’une Austin à une Mercedes, a déclaré Fred Ashbaugh. Là, on a plein d’instruments devant soi, alors que dans un Fleet Finch il y a une aiguille, une bille et un indicateur de vitesse.
« Et, bien sûr, c’était un avion assez puissant et tout à fait acrobatique. Oh, c’était un bel appareil qu’on pilotait; un peu compliqué, mais beau. »

La classe de stagiaires – dont la moitié du dominion de Terre-Neuve, engagés dans la RAF – se déroula sans heurt : pas d’accrochage, pas de raté, et pas de
conflit rapporté avec les gens du coin.
Fred Ashbaugh obtint son brevet de pilote le 9 avril 1941.
La province, où l’alcool était interdit (elle n’a abrogé l’interdiction qu’en 1948), permit l’attribution d’une demi-bouteille d’alcool par diplômé. Le maire et le lieutenant-gouverneur organisèrent une fête pour les nouveaux pilotes, dont l’un sortait avec la fille du maire.
Le groupe repartit le 25 avril. De fortes chutes de neige gênèrent le groupe de stagiaires qui les suivirent : plusieurs avions s’écrasèrent, et l’un d’entre eux rata complètement l’ile pour atterrir sur le ventre en Gaspésie.
Contrairement à la plupart de ses camarades de classe qui gagnèrent leurs épaulettes d’officier et restèrent au Canada pour devenir instructeurs, Fred Ashbaugh, sergent à l’époque, partit pour l’Angleterre où il s’attendait à être pilote de chasse. Les autorités avaient d’autres idées en tête.
« Quand nous sommes arrivés là-bas, ils voulaient des pilotes de bombardier, pas des pilotes de chasse […]. J’étais un peu plus âgé, et j’étais donc censé être plus stable, je suppose, alors [j’ai été envoyé] sur les bombardiers. »
Il arriva à Liverpool, en Angleterre fin juin 1941 et prit le train de Bournemouth le lende-main matin, puis il déménagea au bout d’une semaine pour aller s’entrainer en tant que deuxième pilote sur le bimoteur Wellington, piloté par un Australien avec trois membres d’équipage britanniques. C’était sa première expérience avec un équipage du Commonwealth.
Son premier vol dans un Wellington, le 27 juillet 1941, dura 20 minutes : un circuit et un atterrissage. La plupart des vols traversaient le pays, mais le 7 aout, un moteur s’arrêta et ils finirent dans la mer Celte, à 200 kilomètres de la côte sud-ouest de l’Angleterre.
« Nous nous en sommes tous tirés, à l’exception du radiotélégraphiste, car un amerrissage d’urgence, c’est comme frapper un mur de briques, a-t-il déclaré. C’est vraiment horrible. »
Leur première affectation était sur des quadrimoteurs Stirling, mais l’équipage fut démantelé et ses membres envoyés ici et là. Par un coup du sort, leur pilote australien, le sergent de section Clarence Henry Muir, fut transféré à une escadrille du Bomber Command en tant que deuxième pilote. Il prit son nouveau poste un samedi. Le dimanche, il était mort.
Fred Ashbaugh fut second pilote à bord de deux Stirling de l’Escadrille 149 peu de temps après, mais quelques missions plus tard, il eut son propre avion avec son propre équipage. Il avait inscrit 150 heures de vol dans son journal de bord.
À son apogée, fin 1943, 104 000 membres du PEACB dirigeaient 107 écoles et 184 unités de soutien dans 231 lieux d’un bout à l’autre du Canada.
Sa première mission en tant que pilote commandant de bord eut lieu le 10 avril 1942, au port français du Havre, occupé par les Allemands, où il largua seize bombes de 500 livres à une altitude de 4 800 mètres (16 000 pieds).
Il se familiariserait bientôt avec de rudes conditions : les projecteurs, le tir de DCA, les chasseurs de nuit et les premières techniques de navigation. « Beaucoup de champs de navets ont été bombardés. » Et encore plus d’installations ennemies.
Fred Ashbaugh est décédé le 2 janvier 2019. Il avait 99 ans. Son épouse Pat et lui étaient mariés depuis 73 ans.
Le mur commémoratif de 91 mètres du British Commonwealth Air Training Plan Museum en forme de profil d’aile, à Brandon, au Manitoba, porte les noms de 19 256 membres d’équipage du Commonwealth tués au cours de ces années orageuses de conflit, le plus sanglant de l’histoire.
Quelque 856 stagiaires périrent au cours des cinq années du Plan. En 1944, cependant, le taux d’accidents mortels était tombé à un pour 22 388 heures de vol.
Le Plan d’entrainement aérien du Commonwealth britannique, qui prit fin le 31 mars 1945, est encore l’un des plus importants programmes de formation aéronautique de l’histoire. Il servit à former près de la moitié des membres d’équipage qui devaient servir dans les forces aériennes du Commonwealth pendant la Seconde Guerre mondiale, 131 533, pour être exact, et 72 835 d’entre eux étaient canadiens.


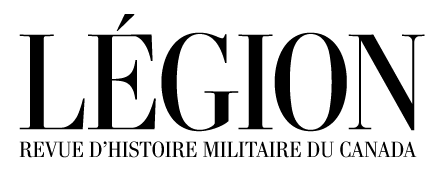
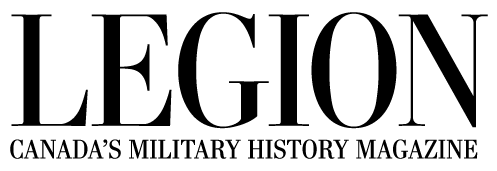




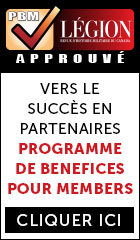




Comments are closed.