
Àl’orée de la fin de la guerre en Europe, le gouvernement libéral dut se prononcer sur d’importantes questions militaires. Quel rôle le Canada jouerait-il dans la guerre contre le Japon après la défaite de l’Allemagne? Comment les soldats seraient-ils rapatriés, et dans quel ordre? Quel rôle, le cas échéant, le Canada aurait-il en Allemagne occupée?
Une réponse fut donnée à cette dernière question en décembre 1944. Le Canada affecterait une division de fantassins et 13 escadrilles de l’Aviation royale canadienne à l’occupation du Reich vaincu. Tout comme la division de fantassins qui serait formée pour aller combattre au Pacifique, la Force d’occupation de l’Armée canadienne (FOAC) devait se composer de volontaires désirant faire carrière dans l’armée. Si, comme on s’y attendait, les volontaires manquaient, le personnel clé et les soldats qui avaient gagné le moins de points d’appréciation pour le rapatriement seraient affectés à la division.
En fin de compte, il y eut 6 160 volon-taires, dont 565 officiers. Les rangs de la future 3e Division (FOAC) furent donc gonflés par 631 officiers et 13 280 soldats du rang qui étaient en bas de l’échelle de priorité pour le rapatriement.
Ottawa avait convenu que les conscrits expédiés en Europe au cours des cinq der-niers mois de la guerre seraient également inclus dans la FOAC. La 3e ressemblait à une division du temps de la guerre : trois brigades de trois bataillons d’infanterie, des régiments d’artillerie et la gamme complète d’armes et de services composée de 20 071 hommes de tous les grades. Si besoin était, elle pouvait se battre, car nul ne savait comment réagiraient les Allemands.
Les Canadiens avaient combattu au Nord-Ouest de l’Europe dans le 21e groupe d’armées sous les ordres du maréchal Bernard Montgomery, et il fut convenu dès le départ que la FOAC ferait partie du XXXe Corps britannique dans la région d’Emden-Wilhelmshaven, dans le Nord-Ouest de l’Allemagne. Aucun calendrier n’avait été déterminé, mais le gouvernement savait que Londres, en difficulté financière, allait vouloir que le Canada reste le plus longtemps possible.
Néanmoins, bon nombre des soldats au plus bas de la liste de rapatriement souhaitaient rentrer chez eux. Plus d’autres hommes de la Première Armée canadienne quittaient l’Europe aussi rapidement que possible, plus il allait être compliqué de soutenir une force relativement petite loin du Canada. Enfin, les Britanniques, les Américains, les Soviétiques et les Français supervisaient les mesures prises pour l’ennemi vaincu dans leurs zones, mais le Canada, nonobstant sa contribution à la victoire, ne serait pas consulté par les grandes puissances sur le sort des Allemands.

C’était le major-général Christopher Vokes qui commandait la FOAC. Major à son arrivée en Europe, il avait dirigé une brigade lors de l’invasion de la Sicile et avait commandé la 1re Division canadienne en Italie à la fin de l’automne 1943. Après décembre 1944, il dirigeait la 4e Division blindée canadienne au nord-ouest de l’Europe.
Le 13 juillet, dans le théâtre de la garnison à Aurich, en Allemagne, le général Vokes expliqua à ses officiers et à ses hommes ce qu’il attendait de la FOAC : « Tous les Canadiens [seraient] jugés sur le comportement des hommes de tous les grades. Pour inspirer le respect à tous les Allemands ainsi qu’aux autres forces d’occupation, il [fallait] une supervision constante et une discipline irréprochable. La 3e Division d’infanterie du Canada, dit-il [devait] être la “vitrine” de l’Armée canadienne. »
En pratique, selon le brigadier Robert Moncel, Vokes dirigeait sa force d’occupation comme un seigneur de la guerre. Il organisait des fêtes turbulentes, ajouta-t-il.
Les tâches assignées à la FOAC étaient vastes, allant du désarmement de la Wehrmacht à la prise en charge de personnes déplacées, en passant par l’élimination du parti nazi et l’évacuation des prisonniers de guerre alliés. À plus long terme, les occupants furent également chargés de rééduquer la jeunesse allemande et de compromettre la capacité des Allemands à relancer une guerre.
La force d’occupation travaillait avec les officiers du gouvernement militaire qui avait été établi le jour de 1945 où les Alliés entrèrent en Allemagne, ainsi qu’avec ses équipes des affaires civiles. Le plus important était de contrôler les soldats allemands qui s’étaient rendus et de les renvoyer chez eux. Le processus mis en place, 3 000 membres de la Wehrmacht étaient traités et relâchés tous les deux jours. Toutefois, de nombreux soldats allemands avaient échappé à la garde à vue ou évité d’être faits prisonniers. Il fallait les trouver et les contrôler pour déterminer s’ils avaient été dans la SS ou avaient commis des crimes de guerre.
Pour capturer ces hommes, la FOAC organisa des descentes, des opérations coordonnées menées de nuit et sans avertissement. On encerclait les lieux et un contrôle rigoureux de tous les habitants était effectué aux premières lueurs. Toute personne sans certificat de libération ou sur qui pesaient des soupçons devait être remise au personnel du gouvernement militaire ou détenue en tant que prisonnier de guerre.
La tâche suivante, encore plus ardue, consistait à aider les dizaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés dans la zone de la FOAC. Le régime nazi avait établi des camps de concentration sur tout son territoire. Les installations d’extermination se trouvaient dans l’Est, mais les camps, tels que celui de Bergen-Belsen, près de la région contrôlée par les Canadiens, avaient choqué les gens qui avaient vu les morts empilés et l’effroyable état des survivants. Ces personnes devaient désormais être soignées et renvoyées chez elles ou, si ce n’était pas possible, logées jusqu’à ce que leur destination ait été déterminée.
Il y avait aussi des ouvriers importés par le Reich pour travailler dans les usines ou les exploitations agricoles, certains venus volontairement, mais beaucoup plus amenés comme des esclaves. Ceux d’Europe de l’Ouest étaient généralement renvoyés facilement chez eux. Toutefois, les choses étaient plus compliquées pour ceux d’Europe de l’Est : nombreux étaient ceux qui, traités brutalement par les Allemands, voulaient se venger avant de rentrer chez eux. Les Polonais, en particulier, cherchaient à se venger des civils, et il y eut des cas de pillage, de vols violents, d’agressions sexuelles et de meurtres. La FOAC faisait son possible pour rétablir l’ordre. Elle finit par devoir établir un camp d’isolement sur l’ile de Borkum pour de tels criminels.
Ensuite, il y avait environ 2 000 prisonniers de guerre soviétiques qui avaient été affamés et brutalisés dans des camps de prisonniers. Désormais, beaucoup circu-laient librement. Les ententes entre les Alliés stipulaient que ces soldats devaient être rapatriés en URSS, et le gouvernement militaire avait « les services pour les renvoyer en Russie, est-il écrit dans le journal de guerre de la FOAC. Mais, soit par ignorance, soit par désir de rester en Allemagne, ils n’en avaient pas profité ». La FOAC avait donc « reçu l’ordre de prendre part à ce rapatriement ».
Les Soviétiques essayaient d’échapper aux autorités pour pouvoir se venger des Allemands. La FOAC envoya des patrouilles pour prévenir les crimes : elle cerna une fois 30 Soviétiques qui pillaient des exploitations agricoles, violaient femmes et filles, et assassinaient des civils. Parfois, les Canadiens montraient peu de compassion pour les civils, et certains applaudissaient même les anciens prisonniers qui « rendaient un peu la pareille aux Boches ». Comme le dit prosaïquement un soldat : « les Russes bottaient le cul des civils allemands. »
Les nazis avaient plongé le monde dans une longue guerre cruelle, et seuls les crimes les plus graves faisaient l’objet de poursuites. La plupart des déplacés et des prisonniers de guerre évadés ne furent pas souvent punis, et les Soviétiques finirent par être renvoyés chez eux.
Parfois, les Canadiens montraient peu de compassion pour les civils, et certains applaudissaient même les anciens prisonniers qui « rendaient un peu la pareille aux Boches ».
Malgré les représailles, les Allemands dans la zone d’occupation canadienne affichaient généralement une attitude acceptable. La plupart des personnes âgées étaient résignées à leur sort. La guerre avait été perdue, mais ce n’était pas de leur faute, prétendaient-elles; c’était seulement à cause de l’erreur qu’avait faite Hitler d’attaquer l’Union soviétique avant d’achever la Grande-Bretagne. Mais, selon les responsables canadiens, certains des hommes de moins de 30 ans à qui l’idéologie nazie avait été inculquée pendant 12 ans vouaient une haine implacable aux vainqueurs. Et les Allemands évitaient généralement de coopérer avec ces derniers.
Les ordres de non-fraternisation du maréchal Montgomery n’aidaient pas : aucune relation informelle avec la population, pas de liaisons avec les femmes, pas de bonbons pour les enfants. Enfreindre ces ordres pouvait entrainer une punition pour les soldats, ce qui était incontestablement préjudiciable au moral.
Les soldats voyaient bien que les enfants (et leurs parents) avaient faim, et ils voulaient les aider pendant les mois qui suivirent la reddition, lorsque la nourriture se faisait rare et qu’ils n’avaient qu’à peine plus de 1 500 calories par jour et par personne. Mais, comme le major Elmer Bell l’écrivit dans une lettre envoyée chez lui depuis l’Allemagne, donner du chocolat aux enfants « serait un petit début de fraternisation et le gaspillage de tout le produit de nos pertes et de nos sacrifices ».
Les difficultés des civils allemands pouvaient être exploitées, et elles le furent. Il était difficile de trouver des cigarettes, et les soldats canadiens troquaient celles qu’ils obtenaient gratuitement contre des appareils photo, de l’alcool, des bijoux, des œuvres d’art, des jumelles, des montres. On pouvait mettre la main sur n’importe quoi, semblait-il, en échange de 100 à 1 500 cigarettes. C’était de la petite bière, cependant, par rapport au matériel, aux vêtements et aux denrées alimentaires volés à l’armée et refourgués au marché noir. Ce n’est qu’au printemps 1946 que ce fut contrôlé (« car d’autres responsabilités étaient d’une plus grande priorité », est-il noté dans le journal de guerre de la FOAC).

Les Canadiens, eux aussi, voulaient rencontrer du monde. Stanley Winfield, de l’ARC, écrivit que, même si la consigne de non-fraternisation était en vigueur,
« les Fridolines ont tiré un avantage certain de cet ordre et n’y ont vu qu’une merveilleuse occasion de prendre leur revanche. Elles allaient se promener là où elles savaient que se trouveraient des soldats alliés […] et se montraient aussi enjouées et désirables que possible. »
Il était difficile de résister à la tentation. Et vu l’approvisionnement abondant en cigarettes qui pouvaient leur servir de monnaie d’échange, de nombreux soldats obtenaient ce qu’ils voulaient. Pourtant, peu d’entre eux furent punis. Néanmoins, les soldats de la FOAC allaient fréquemment en permission non loin, aux Pays-Bas ou au Danemark, où les gens étaient amicaux, où les femmes s’intéressaient à eux et où les cigarettes leur ouvraient encore des portes. Les hommes pouvaient se payer une fin de semaine à Amsterdam ou à Copenhague pour 2 000 cigarettes seulement, avec nourriture, boissons, hébergement et compagnie d’une dame tout compris.
On finit par s’habituer à la nouvelle réalité et, à la mi-juillet 1945, la consigne de non-fraternisation fut assouplie avant d’être éliminée. Le décret du XXXe Corps britannique disait, avec un humour vraisemblablement fortuit, qu’ils « pouvaient maintenant parler à tous les Allemands dans les lieux publics et dans les rues, parce que, grâce aux rapports entre les deux peuples, on espère conduire les Allemands à un mode de vie démocratique […] n’entrez pas chez eux ni ne les recevez chez vous ».
Il fut rapporté que les Allemandes étaient menacées par leurs compatriotes si elles fréquentaient des Canadiens. Mais, les cigarettes étaient une récompense efficace pour les risques pris, et de nombreux soldats eurent vite des liaisons. En février 1946, il était noté dans le journal de guerre de la FOAC : « La fraternisation s’accroit, et même les officiers parlent à voix basse de telle “ belle blonde ” remarquée au centre-ville ». Plusieurs hommes, est-il dans le texte, ont exprimé leur désir d’épouser des Allemandes.
Ils avaient vraisemblablement réussi à « entrer chez elles ».
Malgré les demandes faites aux Canadiens à plusieurs reprises par les Britanniques pour qu’ils restent en Allemagne, Ottawa décida que l’engagement prendrait fin au début de 1946. Les premiers soldats partirent pour l’Angleterre le 23 mars; les derniers s’en allèrent le 8 juin. La FOAC avait fait son devoir, et les Canadiens étaient tous de retour chez eux peu après. La guerre était enfin terminée.

LE BATAILLON CANADIEN DE BERLIN
Bien qu’elles ne fassent pas officiellement partie de la Force d’occupation de l’Armée canadienne, les troupes canadiennes ont également servi en Allemagne d’après-guerre dans ce qu’on a appelé le « bataillon de Berlin ». Tirés d’unités aux Pays-Bas qui attendaient d’être rapatriées, des hommes du Argyll and Sutherland Highlanders, du Fusiliers Mont-Royal et du Loyal Edmonton Regiment furent déployés pour représenter le Canada au défilé britannique de la victoire dans la capitale allemande le 21 juillet 1945.
Les soldats, installés dans une maison de retraite de la ville, avaient peu de tâches officielles autres que la pratique de leurs exercices et l’entretien de leur équipement. Ils étaient par ailleurs libres d’aller voir les lieux en ruine.
Le sergent Kurt Loeb écrivit qu’il avait trouvé des souvenirs à la Chancellerie du Reich, y compris des dossiers de correspondance personnelle du ministre allemand de l’Intérieur du début de la guerre. Et chaque soldat, semblait-il, avait une collection de médailles allemandes.


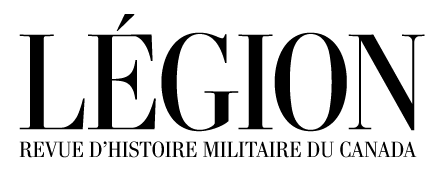
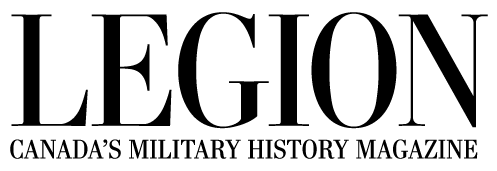






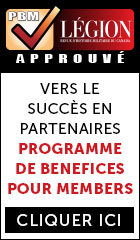




Comments are closed.