
La Loi sur les mesures de guerre est entrée en vigueur le 4 aout 1914 pour permettre au cabinet de passer outre la Chambre des communes et le Sénat, et de gouverner par décret en cas de « guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelle ou appréhendée ».
C’est le dernier mot de cette définition qui a causé le plus de problèmes. Si le cabinet voyait une menace en quelqu’un ou quelque chose, il pouvait agir unilatéralement en dehors de la loi et des piliers centraux de la démocratie. Le gouvernement pouvait censurer des publications, arrêter, détenir ou expulser des individus sans procès, contrôler le commerce et saisir des biens propres.
Et il l’a fait. Le pays a été confronté aux horreurs de la première guerre moderne, et consécutivement, il a interdit des centaines de publications, interné des milliers de civils et confisqué leurs biens.
La Loi sur les mesures de guerre a été utilisée à nouveau en 1939. Elle a servi à censurer des journaux et d’autres périodiques, ainsi qu’à démanteler plus de 30 organisations religieuses, politiques ou culturelles. Cependant, ce qui reste gravé dans les mémoires, ce sont les dizaines de milliers de Canadiens d’origine allemande, italienne ou japonaise qui ont été internés et dont les biens ont été confisqués; certains d’entre eux ont même été expulsés après la guerre.
Dans les temps modernes, en 1973, le premier ministre Pierre Trudeau a recouru à la Loi sur les mesures de guerre pour faire face à la crise du Front de libération du Québec (FLQ). Cette année-là, le FLQ a enlevé le délégué commercial britannique James Cross puis, quelques jours après, Pierre Laporte, ministre du Travail du Québec. Le premier ministre Robert Bourassa a demandé à Trudeau d’invoquer la Loi sur les mesures de guerre, qui a été proclamée le 16 octobre. Des centaines de personnes ont été arrêtées ce matin-là.
Le FLQ s’était habilement fait passer pour une grande organisation et avait suscité beaucoup d’estime chez les nationalistes. Mais, quand le corps de M. Laporte a été retrouvé dans un coffre, cette mansuétude s’est évanouie. Des années après ce qu’on a nommé la crise d’Octobre, il a été établi que le FLQ ne comptait qu’environ 35 membres.
L’invocation de la Loi sur les mesures de guerre pour suspendre les droits et les libertés civiles d’une population était controversée, et Trudeau a annoncé qu’il la modifierait, mais cela ne s’est pas fait pendant son mandat.
En 1988, quatre ans après le départ de Trudeau, la Loi sur les mesures de guerre a été remplacée par la Loi sur les mesures d’urgence. Il y a des différences cruciales entre les deux : le cabinet ne peut plus agir seul, et toute mesure est soumise à la Déclaration des droits et à la Charte des droits et libertés. Elle prévoit également une indemnisation pour les personnes touchées par la Loi. La même année, le premier ministre Brian Mulroney présenté des excuses aux Canadiens japonais pour leur traitement pendant la guerre et a accordé une indemnité de 21 000 $ à chaque survivant.
La Loi sur les mesures de guerre a toujours suscité la controverse, car il était si facile d’abuser de ces pouvoirs en faisant fi des protections démocratiques. La Loi sur les mesures d’urgence ne s’est révélée que légèrement moins controversée.
Le premier ministre Justin Trudeau l’a invoquée en février 2022, car des manifestants anti-vaccins occupaient Ottawa depuis plusieurs semaines. Il s’agissait de sa première mise en application. Les manifestants ont été arrêtés ou expulsés de la ville sous escorte. Mais, cette décision a donné lieu à une enquête pour savoir si cela avait été nécessaire et si la loi devrait être modifiée.

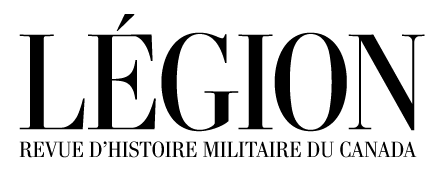
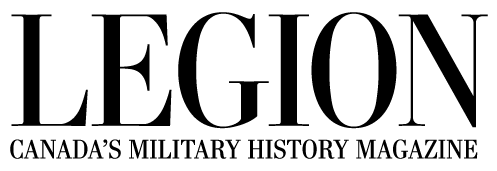


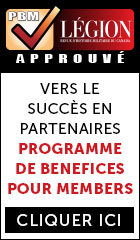




Comments are closed.