¹ On enseigne aux soldats à se camoufler lors de leur formation en techniques de campagne. On leur donne une liste de contrôle sur les principes de base qu’ils doivent utiliser pour se cacher de l’ennemi : éviter de montrer sa silhouette, les ombres, l’espacement, le brillant, etc. La liste s’intitule Pourquoi les choses se voient. Pour beaucoup de soldats canadiens, surtout ceux du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, l’expression fait partie de la langue de tous les jours. On l’utilise pour faire remarquer pourquoi quelque chose ne va pas, par exemple si un avant-poste manque de piles, qu’on ne peut trouver de fournisseur, et que toutes sortes de choses essentielles ne fonctionnent plus. Un soldat qui entend parler de cette situation se moquerait en disant : « pourquoi les choses se voient ». C’est un synonyme de bévue.
![LE PPCLI AU PANJWAYE, PROVINCE DE KANDAHAR, 2009. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2014/01/Afghan1.jpg)
Pour ce qui est d’endurer la guerre en Afghanistan, j’ai atteint mes limites en aout 2010. Un vendredi, je buvais de la bière à Ottawa, sur la rue Elgin, et quelques jours après, j’étais couché dans la poussière au Panjwaye, les balles sifflant au-dessus de ma tête, et je venais de voir une bombe faire sauter deux Canadiens.
Quelques jours après, j’accompagnais des soldats qui allaient tuer des insurgés et, coup de malchance, je me suis trouvé dans la section de la patrouille qu’on envoyait servir d’appât afin de respecter l’exigence absurde des règles d’engagement concernant les « Canadiens en danger imminent ».
Et voilà. Je ne voulais plus rien savoir de tout ça. Ce n’était pas un choix fait après mûre réflexion; c’était simplement comme ça. J’ai passé la semaine suivante à jouer à des jeux vidéos avec des ingénieurs de la BOA (base d’opérations avancée), évitant les patrouilles et manigançant pour trouver une place dans un hélicoptère qui me ramènerait à la base aérienne de Kandahar afin de ne plus prendre de risque avec les saloperies d’EEI.
Pendant cette semaine-là, un combat s’est déroulé juste à côté de la base. L’ennemi attaquait un avant-poste de l’armée nationale afghane (ANA) de l’autre côté de nos barbelés. Je n’ai pas quitté le perron de ma tente. Les soldats me regardaient tous de travers, se demandant évidemment pourquoi il y avait là un reporter que la guerre ne semblait pas intéresser.
De toute façon, il n’y avait pas de trajet en hélicoptère : les tempêtes de sable interdisaient tous les vols jusqu’à nouvel avis. Je devais donc partir en convoi en passant par le pays des bombes.
Le convoi a été la cible d’une bombe avant d’avoir fait un kilomètre. Le véhicule devant le mien a été frappé par un EEI et je ne sais trop comment, je me suis frappé la tête contre le toit d’acier, ce qui a vraiment désenchanté ma colonne vertébrale et quatre de mes dents ont été cassées. On ne voyait plus très bien à cause de la poussière. Nous sommes restés assis dans le VBL (véhicule blindé léger) en nous regardant les uns les autres. Des voix paniquaient à la radio.
Je pense que l’Afghan dans la jeep qui nous précédait a perdu une partie du bas de son corps. Le Hummer avait été bien maltraité. Ou en tout cas, c’est ce que m’a dit un soldat. On ne m’a pas laissé sortir du VBL, alors je ne sais pas vraiment. Même si l’on m’avait permis de sortir, je ne crois pas que je l’aurais fait.
J’ai encore de longs rêves, des rêves complexes où je me trouve dans une petite base du Panjwaye : les soldats préparent la défense; l’assaut arrive; la base est occupée; chacun ne pense qu’à survivre. Les cauchemars ne me déran-geraient pas tant que ça si ce n’était de leur effet épuisant.
Une fois, j’ai bavardé avec un soldat après quelques bières. « Il me semble que je suis mort en Afghanistan et que personne ne me l’a dit, que personne ne le sait, dit-il. Et je suis quelqu’un d’autre maintenant, je vis la vie de quelqu’un d’autre. »
J’ai fait signe que oui et je lui ai dit qu’il m’arrivait d’avoir des cauchemars. « Charmant », dit-il.
![LE SERGENT DWAYNE MacDOUGALL À SALAVAT, 2009. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2014/01/Afghan2.jpg)
Une visite à Kaboul, mars 2013
C’est au début du printemps qu’il faut aller en Afghanistan. Il y a la fraicheur et le calme, et les insurgés n’ont pas encore atteint le summum de la malveillance; les cols par lesquels ils traversent les montagnes en provenance de leurs bases au Pakistan sont encore presque entièrement gelés.
Ce n’est peut-être pas vrai.
Je pense que les poseurs de bombes roulent sur les routes ces jours-ci. Mais le truc des cols gelés, c’est ce que disent les gens pour expliquer le phénomène de la saison des combats en Afghanistan, qui est comme une ligue de sports où la violence n’a pas de limite et toutes sortes de gens y meurent.
Quoi qu’il en soit, au printemps, le grabuge n’est que sporadique et, en conséquence, tout le monde rêve que cette année sera enfin plus paisible que d’habitude. Statistiquement, chaque année est presque toujours pire que la précédente, mais ce n’est pas grave parce que l’important, à ce moment-ci, c’est l’optimisme lui-même.
Actuellement, plus de dix ans depuis le début de la guerre, Kaboul est deve-nue une belle ville exotique. Les rues sont pleines de gens, embouteillées sans cesse, occupées sans relâche. Au point où ça semble être contre nature. C’est pas possible que les passions soient soulevées à ce point-là.
Quand on observe tous ces gens, c’est prodigieux. Il y a des mecs branchés, habillés dans le style des films de Bollywood avec les pantalons serrés qui brillent, les cheveux gominés et qui plastronnent comme dans une disco, au beau milieu d’écolières et de barbus rétro pro-venant des provinces. Et n’importe où l’on porte les yeux, les gens qu’on ne peut pas voir, mais qui sont là, les gens qui veulent vous tuer.
Je m’étais promis à plusieurs reprises de ne jamais y retourner, mais je me trouvais de nouveau en Afghanistan, en mission donquichottesque, à la recherche de réponses à quelques grandes questions exceptionnellement idiotes. La guerre d’Afghanistan est la plus longue à laquelle le Canada ait participé, mais on ne saurait expliquer ce qui est vraiment arrivé. Est-ce une guerre juste? Pourquoi y sommes-nous allés? Pourquoi le public canadien semble-t-il si confus en ce qui concerne son objectif? Quelle était la stratégie du Canada en Afghanistan? Qu’est-ce que tout ça voulait dire? Cela en valait-il la chandelle?
Il est maintenant clair à mes yeux qu’on ne peut pas très bien répondre à ces questions. Mais je ne m’en apercevais pas au moment où je me les posais parce que je me trouvais à Ottawa, en réunion. Si les guerres compliquées comme celle d’Afghanistan nous apprennent facilement quelque chose, c’est que plus on en est loin, plus on est présomptueux de croire les comprendre. Et ce qui n’est peut-être pas une coïncidence, la plus grande partie de la planification concernant la guerre, si planification il y a eu, s’est aussi passée loin du bruit des bombes.
Il est fatal de mener une guerre sans la volonté de la gagner.
— Douglas MacArthur
La victoire existait surtout dans l’esprit des gens qui se trouvaient loin du champ de bataille. Et c’est devenu étrangement difficile à s’en débarrasser, quelles que soient les preuves apportées par le champ de bataille lui-même. C’était une illusion entretenue par des chiffres manipulés et des discours tellement démagogiques qu’on pourrait presque les qualifier de mensongers. La réalité était ainsi : nous ne perdions pas, mais nous ne gagnions pas non plus. Malheureusement, cela voulait dire que nous allions perdre par manque de temps.²
² C’est un vieux dicton sur la guerre et la lutte contre l’insurrection. Je suis presque sûr que ce n’est pas moi qui l’ai inventé, mais je ne sais pas qui.
Au moment où vous lisez ceci, le temps s’est écoulé : les troupes reviennent au pays. Les derniers soldats, au moins d’après ce qui est prévu actuellement, seront partis au mois de mars au plus tard, et même eux, ce seront les traînards : la plupart sont déjà partis.
Si bizarre que ce soit, combattre manquera à la plupart des soldats que je connais, si ça ne leur manque pas déjà. Mais je ne pense pas que ce soit la guerre qui va leur manquer, si ça tient la route.
C’était une guerre dans un endroit lointain rébarbatif, dont les raisons ne sont pas très bien connues par les gens au nom de qui elle a été soutenue, et elle n’a été appuyée qu’en partie par ces mêmes gens. En tant que reporter qui va et vient entre le Canada et l’Afghanistan, il me semble qu’il y a un décalage important entre ce que le public sait de la guerre et ce qu’il se passe vraiment là-bas. En Afghanistan, la mission était soi-disant évidente : les Forces canadiennes devaient aller à la province de Kandahar, lieu de naissance des talibans et centre de la xénophobie et du nationalisme légendaires pachtounes, et y assurer la sécurité afin que la nation puisse se rétablir. Mais ça aussi, c’est un euphémisme. Et en grande partie, c’est faux. En réalité, les Canadiens, les infidèles, allaient essayer de démanteler une théocratie fanatique et populaire de l’âge de pierre au moyen de promesses et d’armes lourdes, ce qui voulait dire beaucoup de combats.
Au pays, au cours des années, l’objet de la mission a dérivé au fil du développement politique. Le gouvernement a organisé une série de groupes de discussion pour décider quel message concernant la guerre était le plus acceptable aux yeux des Canadiens, et il a dit que telle en était la raison.
Au début, en 2005 et 2006, la mission au Kandahar a été présentée comme étant une question de sécurité nationale. Les efforts entrepris en vue de stabiliser l’Afghanistan étaient essentiels pour la sécurité du Canada.
« Ce sont des meurtriers, des ordures. Je vous le dis avant toute chose, déclare l’ancien chef d’état-major de la défense, le général Rick Hillier, lors d’une entrevue réalisée en juillet 2005. Peu importe qu’on soit en Afghanistan ou ailleurs. Ils veulent détruire notre société. J’en suis persuadé… ils détestent nos libertés. Ils détestent notre société. Ils détestent notre libre arbitre. »
À ce moment-là, la mission avait un objet stratégique. L’idée globale relative à la stratégie, bonne ou mauvaise, était fondée sur le vieux concept militaire d’engagement avancé, ce qui veut dire que les forces expéditionnaires vont à l’étranger, en avant, pour combattre l’ennemi afin de l’empêcher de venir ici se battre sur le sol canadien.
En juin 2006, le message de Hillier concernant la guerre en Afghanistan était stratégique et agressif, deux mots qui en disent long sur son style personnel. L’Afghanistan, disait-il, était une « boite de Pétri » où sont incubés les terroristes, une sorte de trouble contagieux international; alors ils sont « détestables » et c’est pour ça que le Canada est allé se battre au Panjwaye, pour empêcher la progression de ce trouble infectieux.
Le premier ministre Stephen Harper, à la recherche d’un abri politique contre les ramifications de cette violence, demandait l’accord du Parlement à cette guerre en mai 2006. Pour savoir pourquoi le Canada s’est retrouvé en Afghanistan en 2002 et pourquoi le gouvernement a poursuivi la mission de combat de 2006 à 2010, il faut écouter le discours qu’il a prononcé ce soir-là et qui était le plus clair qu’il y ait jamais eu sur la justification et la raison d’être de la mission :
« Les évènements du 11 septembre 2001 ont été un signal d’alarme, disait Harper au Parlement. Non pas seulement pour les Américains, mais pour tous les peuples qui vivent dans des nations libres et démocratiques. Deux douzaines de Canadiennes et de Canadiens ont été tués dans les attaques des tours jumelles – ce sont des citoyens ordinaires comme nous – avec leurs histoires, leurs familles et leurs rêves. Et après New York et Washington, ce sont d’autres villes et pays qui ont été attaqués, notamment Madrid, Bali, Londres, la Turquie et l’Égypte.
Monsieur le Président, nous devons être clairs : le Canada n’est pas à l’abri de telles attaques.
Et nous ne serons jamais à l’abri tant que nous sommes une société qui défend la liberté, la démocratie et les droits de la personne. Il n’est pas surprenant qu’Al-Qaïda ait choisi le Canada, en même temps que d’autres nations, en vue d’une attaque. La même Al-Qaïda qui, de concert avec les talibans, s’est emparée d’un Afghanistan non démocratique pour en faire un havre où sont planifiées les
attaques terroristes dans le monde entier.
Monsieur le Président, nous ne pouvons tout simplement pas laisser les talibans reprendre, avec l’appui d’Al-Qaïda ou d’autres éléments extrémistes semblables, le pouvoir en Afghanistan. On ne peut pas permettre cela. »
Quand Harper s’est adressé aux Nations Unies quatre mois plus tard, il l’a reformulé comme étant une mission humanitaire. Il disait que le Canada reconstruisait des écoles pour filles qui avaient été détruites par des talibans frénétiques et détesta-bles. Il parlait de reconstruire une société en ruines, d’Afghanes en politique, de cinq millions d’enfants inscrits à l’école.
« Mais soyons réalistes, disait Harper à l’ONU le 20 septembre 2006, à peine quelques mois après qu’il eut jeté un jour si austère sur la guerre à l’occasion d’un discours au Parlement. Les défis auxquels nous faisons face dans ce pays sont énormes. Il n’y a pas de remède miracle. De plus, la réussite ne peut venir que des seules mesures militaires […]. Voilà pourquoi le Canada prend part à des travaux tels que la reconstruction des écoles de fillettes, détruites par les talibans ivres de haine. »
Pendant ce temps, sur le terrain, les Forces canadiennes passaient leur période de combats la plus longue depuis la Corée. Bien qu’un nombre vraiment tragique de Canadiens et d’Afghans allaient mourir dans cette série de batailles, désignée opération Méduse, il est ironique qu’une grande partie des combats fussent centrés sur une école construite quelques années auparavant et dont les talibans s’étaient emparés. Pendant la période du 3 aout au 20 septembre, au moins 8 Canadiens
allaient mourir lors des combats servant à reprendre l’école blanche notoire.
À la fin du mois de septembre, l’école blanche était en ruines. Alors quand Harper laissait entendre à l’ONU que les Canadiens se concentraient sur les écoles en Afghanistan, il disait en quelque sorte la vérité.
Sauf que nous étions en train de les bombarder, pas de les construire.
![L’ÉCOLE BLANCHE NOTOIRE ATTAQUÉE PENDANT L’OPÉRATION MÉDUSE, 3 SEPTEMBRE 2006. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2014/01/Afghan3.jpg)
À partir de ce moment-là, la mission était montrée sous un jour nouveau. Il ne s’agissait plus d’une question de sécurité nationale : on représentait la mission comme étant humanitaire, un vaste effort pour les droits de la personne en Afghanistan. Fait plus troublant encore, l’affaire était vendue aux Canadiens comme une mission d’exportation des valeurs canadiennes. La guerre était alors une question de femmes et d’écoles, d’égalité des sexes et d’éducation de la petite enfance. Mais cette guerre-là n’a jamais vraiment existé.
En 2009, pendant une des dernières entrevues de Hillier, il s’est entretenu avec quelqu’un de la revue Maclean’s sur la question de négocier avec les talibans et sur la possibilité de leur laisser le contrôle politique de la province de Kandahar. C’est lors de cette entrevue que Hillier a presque fait une parodie de l’argumentaire « humanitaire ».
« Il est inévitable que certains des talibans s’engagent dans le processus politique, comme ce qui est arrivé en Irlande du Nord en quelque sorte. Mais je ne pense pas qu’il soit inévitable de céder une partie du pays aux talibans. Peut-on dire que “cette partie d’Afghanistan est libre et égalitaire, mais au Kandahar on a le droit de fouetter les femmes parce qu’elles se vernissent les ongles, ou parce que leurs souliers produisent un cliquetis sur les pavés?” Je ne vois pas comment nous, en tant que l’un des pays chefs de file, pourrions supporter une telle chose. »
Non seulement les pavés sont presque inexistants au Kandahar, mais est-ce qu’on devrait faire la guerre pour que les Afghanes puissent se vernir les ongles et porter des souliers à talon haut? Toute la question est là. Bien que la guerre pour ces raisons puisse être plus facilement comprise et appuyée par certains segments de la population, ce ne serait pas raisonnable sur le plan purement stratégique de lancer des campagnes mili-taires pour de telles raisons.
Quelle que soit la raison d’être de la guerre, ce n’est certainement pas une question d’écoles, d’égalité des sexes au Panjwaye ni même de droits de la personne. La guerre concernait le traité de défense collective des pays de l’OTAN et la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a envoyé la plus grande coalition de l’histoire de l’humanité à une guerre contre le terrorisme international et l’Afghanistan, pays sans loi où le trouble est actuellement basé. La guerre concerne la sécurité nationale. Et elle concerne un gouvernement afghan qui adhère au droit international.
Il ne devait jamais être question d’aller en guerre en Afghanistan pour défendre les droits des femmes; il n’est actuellement pas question d’aller en guerre en Afghanistan pour défendre les droits des femmes.
Une nouvelle stratégie sur un nouveau territoire
Le colonel Ian Hope se trouve au bord de la route de Jalalabad; il est 4 heures, et on gèle à Kaboul. On est en mars 2013, et la guerre continue en Afghanistan même si elle n’est plus à la une au Canada.
Personne n’est davantage l’homme du Canada en Afghanistan que le colonel Hope. Il s’est mêlé au conflit dès le tout début, de plusieurs manières, et principalement, en 2006, en tant que commandant du premier groupement tactique envoyé au Kandahar.
Il est peut-être froid à ce moment-ci, mais il ne le montre pas. Il sourit et fume un cigare alors que 17 millions de dollars en camions et en véhicules blindés américains transportent vers les ténèbres un bataillon entier de recrues afghanes rapidement entrainées.
C’est ça le travail de Hope durant cette affectation-ci : transformer un groupe de recrues afghanes en unité militaire. Les équiper. Faire le nécessaire pour qu’elles aient toutes les connaissances de base. Et puis les envoyer au combat.
Hope est commandant du Centre consolidé de mise en service qui est la dernière partie, la partie la plus importante, de la mission de formation en Afghanistan, laquelle est la dernière et la meilleure chance d’obtenir quelque chose qui ressemble à une victoire en Afghanistan.
Hope est une légende militaire du Canada. C’est mon opinion. Dire de lui qu’il est d’un tempérament d’acier, c’est le sous-estimer. C’est l’officier le plus fonceur qui se puisse être, d’une intelligence vive au plus haut point et dont l’énergie et la puissance semblent s’accroitre devant les difficultés.
Le bureau de Hope en Afghanistan se trouve dans un de ces bâtiments mobiles qu’on voit partout dans les zones de guerre : de petits cubes blancs en métal flottant sur une mer de gravier, meublés de chaises mal assorties et au plancher en linoléum.
Hope peut parler de la mission en Afghanistan grâce à une expertise et à une expérience franchement stupéfiantes. Je suis venu du Canada à Kaboul rien que pour entendre ce qu’il voudrait bien me dire de la guerre : s’il y avait quelqu’un qui puisse répondre à mes questions les plus complexes, je me disais que ce serait lui.
Mais les réponses que j’ai eues n’étaient pas celles auxquelles je m’attendais.
![LE PPCLI PRÈS DE ZANGABAD, 2009. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2014/01/Afghan4.jpg)
Un entretien avec le colonel Hope
Si l’on se fie aux arguments avancés par Hope, le Canada n’a jamais eu de direction stratégique cohérente en Afghanistan. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de stratégie. Aller en Afghanistan, prendre part à la mission et jouer notre rôle d’allié des Américains et de membre de l’OTAN, telle était la stratégie; la sécurité nationale ne reposait pas sur ce qu’il arrivait au Panjwaye; ce qui comptait, c’était simplement d’être là-bas.
« D’après moi, les Canadiens ne se sont jamais vraiment engagés dans la guerre, car nous avions le luxe de choisir nous mêmes quelle attitude prendre officiellement et officieusement. Nous pouvions décider, en tant que pays, de participer ou pas. Il n’y a rien d’essentiel pour la survie nationale en ce qui concerne notre parti-cipation. Nous n’y avons aucun enjeu, alors nous contribuons à la mission, et nous contribuons aux efforts de nos alliés occidentaux et aux efforts internationaux : ce n’est qu’une question de bienveillance. On n’exige rien de nous, sauf un indéfectible attachement à l’OTAN et un engagement inébranlable en ce qui a trait à notre relation bilatérale avec les États-Unis », dit Hope. « Étant donné que ce n’est pas obligatoire, le Canadien moyen n’est pas obligé de se sentir impliqué. »
« Ce que je sais, cependant, c’est que cette bataille, c’est une guerre. Quelle que soit la manière dont Ottawa l’explique, quand on vient ici, on est en guerre. Ça ne veut pas dire que le Canada est en guerre, ça veut dire que les Forces canadiennes livrent une guerre, l’Armée canadienne principalement.
Hope remarque que cette situation étrange, une armée en guerre dont le pays n’est pas en guerre, engendre certaines difficultés. Le manque de stratégie signifie que les tactiques sur le terrain ne proviennent pas de la sorte d’esprit de décision et de la concentration qui sont nécessaires au succès.
« Il n’y avait pas du tout de modèle d’infrastructure tactique au Kandahar qui, d’après moi, avait de l’importance. Aucun motif ne me semblait vraiment valable. Je n’avais pas l’impression que la population locale avait besoin d’être protégée plus que celle d’un autre endroit. Notre mission était de trouver les groupes de talibans, où qu’ils soient, et de leur régler leur compte à tous. Les capturer ou les tuer. Les capturer ou les tuer. C’était ça notre travail. Et la manière qu’on faisait ça, ce n’était pas d’attendre qu’il y en ait qui se montrent, c’était de bouger et d’agir pour qu’ils réagissent. Et quand ils réagissaient, d’user d’une force écrasante contre eux, dit Hope. On les capturait, on les tuait, ou ils disparaissaient de la place. Et on a mené une opération après l’autre rien que pour saisir et garder l’initiative, en capturant ou en tuant l’ennemi pour donner confiance localement, et pour gagner du temps. J’ai eu une discussion une fois avec un journa-liste qui était bouleversé après l’affectation à cause des hommes qui mouraient aux mêmes endroits où d’autres étaient morts un mois avant, deux mois avant, et je lui ai dit que ce n’est pas le terrain qui compte, que ça n’a rien à voir avec un plan quadrillé du sol, ou avec les gens qui y habitent; il s’agit seulement de gagner du temps. Si on veut battre cet ennemi, il faut gagner assez de temps pour que les Afghans aient quelque chose qui nous remplace. »
D’après Hope, notre plan fondamental qui est de développer le Kandahar au moyen de gros projets, de construire des routes, des hôpitaux, des barrages et des écoles n’a jamais été structuré correctement.
« Notre concept opérationnel c’était la gouvernance en entier, la signature de projets, les villages modèles, un cercle d’acier autour de la ville de Kandahar, et rien de tout cela ne nous sert à trouver et à détruire l’ennemi pour gagner du temps afin de construire les institutions, dit Hope. Le développement, ça ne sert pas à diriger. Il faut que les institutions de gouvernance avec lesquelles on traite soient crédibles avant qu’il puisse y avoir un développement qui vaille la peine. Et le développement doit être afghan, pas occidental, parce que le développement occidental est une cible pour les insurgés. Ainsi, sitôt qu’on creuse un puits, les insurgés le détruisent et les gens de l’endroit ne font rien parce que ce n’est pas un puits afghan. Mais si un gars de la place creuse un puits, les insurgés hésitent à le détruire. »
C’est l’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) qui avait construit la fameuse école blanche, à Pashmul, que l’ennemi avait transformée en base et à l’assaut de laquelle au moins huit Canadiens sont morts. Cette école a été détruite, tout comme un grand nombre des autres écoles que l’UNESCO a bâties au Kandahar.
« Tout ça, c’est les affaires, y a pas de gloire là-dedans. Ça n’a rien à voir avec la protection de la population du Kandahar. Ça n’avait rien à voir avec le renfort de la légitimité que le gouvernement afghan avait aux yeux des gens du Kandahar parce que ça ne les intéressait pas. Ça avait tout à voir avec gagner du temps; c’est tout. Et j’étais prêt à me sacrifier ou à sacrifier des soldats, et j’étais prêt à parler de la mission de manière positive au pu-blic canadien; pas à mentir, mais à parler en bien de la mission qui permettrait de gagner du temps. Si je pouvais gagner six mois de plus, si je pouvais gagner un an pour que quelqu’un d’autre puisse construire une institution qui prenne la relève de cette bataille, eh bien on aurait fait notre part. Et si tout se passait mal et qu’on échouait, au moins j’aurais agi selon mes valeurs. Reprendre l’école blanche n’avait rien à voir avec l’école blanche, ni avec les enfants de Pashmul, ça concernait la lutte contre un groupe de talibans; les capturer ou les tuer, pour gagner un mois de plus. »
Ce que Hope me racontait là, c’était l’histoire inédite du Canada à la guerre d’Afghanistan.
![LE COLONEL IAN HOPE OBSERVE LE DÉPLOIEMENT D’UN BATAILLON AFGHAN NOUVELLEMENT ENTRAINÉ, MARS 2013. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2014/01/Afghan5.jpg)
« On évitait une réalité dont il faut s’occuper au niveau stratégique, qui affectait la manière dont on agissait au niveau tactique […]. On a essayé la stabilisation comme effort tactique principal sans stratégie : on existait malgré l’absence de stratégie, fait remarquer Hope. Il n’y a pas eu de stratégie cohérente en ce qui concerne notre contribution en Afghanistan entre 2002 et 2009. »
L’idée actuelle qui est une stratégie, bâtir une armée afghane qui puisse s’occuper des problèmes afghans, a commencé en 2009 quand la mission OTAN de formation en Afghanistan (NTM-A) a été mise en place.
« On a changé de mission au bon moment, dit Hope, de Kandahar à ici, pour profiter de la vague des efforts de la NTM-A qui est de créer cette armée. Ça, c’est une bonne stratégie, et il était temps : il n’y avait pas de stratégie avant ça. »
Je comprends le rêve, mais je me demande s’il est possible pour les forces de sécurité afghanes d’assurer la sécurité des districts reculés où empiètent les talibans et où 100 000 soldats occidentaux n’ont pas réussi à le faire. C’est ce que je demande à Hope.
« Voilà une bonne question, dit-il. Nous n’avons pas réussi parce que nous faisons partie du problème. Quand nous nous installons dans un district, nous y sommes étrangers, alors ils nous prennent pour cible. Nous faisons donc partie du problème de la sécurité du district. Notre présence fait partie du problème. Quand il n’y avait rien d’autre, il fallait qu’on s’en occupe, parce que nous devions gagner du temps pour que les institutions pouvant le faire puissent être créées. Nous avons ga-gné ce temps-là pour que la NTM-A puisse être formée et s’occuper du problème. »
Que les forces de sécurité afghanes assument leur responsabilité qui est de maintenir l’ordre est une question à laquelle, à ce moment-ci, on ne peut répondre que de manière hypothétique.
« Je ne suis pas persuadé que la guerre civile est inévitable ici. Et je ne suis pas persuadé que les talibans reprendront le pouvoir dans ce pays, dit Hope. Non, pour qu’il y ait une dissolution du jour au lendemain de l’ANA, il faudrait que le gouvernement s’effondre tout d’un coup. Vous savez, le point le plus important de la bataille que je prédis n’a rien à voir avec les districts et les champs de bataille, ni avec le combat entre l’ANA et les talibans; il s’agit du transfert de pouvoir paisible du président afghan Hamid Karzaï à son successeur, et de la légitimité de son successeur aux yeux de la population. Si c’est possible, et que ce transfert se fait au moyen d’une élection et à la suite d’une élection à un successeur évidemment légitime, l’ANA restera, et l’ANA sera une force à ne pas sous-estimer. »
Bien que Hope trouve qu’il y a certainement des raisons d’être optimiste quant à l’avenir de l’Afghanistan, il reconnait aussi que l’engagement du Canada dans ce pays soulève des questions angoissantes.
« En ce qui concerne la stratégie, il faut qu’on fasse ce qu’on attend de nous en tant que membre d’une alliance. D’un point de vue stratégique, il faut qu’on fasse ce qu’on attend de nous en tant que partie d’un voisinage bilatéral. Comprenez bien que ce besoin d’engagement, ce besoin de participation, ce n’est pas la même chose que réussir sur le terrain grâce à telle ou telle tactique. C’est là que je dois faire
attention. Pourquoi devrait-on supposer que toutes les choses qu’on a faites au Kandahar étaient brillantes et correctes? Comment se pourrait-il qu’on soit la seule armée du monde qui en ait tant fait et sans erreurs? Tel que vous me voyez, je vous dis que j’ai fait des erreurs, que les officiers placés sous ma responsabilité ont fait des erreurs. Nos erreurs ont causé la mort de Canadiens; elles ont causé des blessures à des Canadiens; nous avons appris grâce à elles, mais nous avons fait des erreurs, et si l’histoire va être juste, comme les historiens devraient l’écrire, elle reconnaitra que des erreurs ont été commises.
Je dirais que de n’avoir jamais fait la guerre avec le sérieux qu’elle méritait est une des principales erreurs. Envoyer des Canadiens en guerre, sacrifier leur vie, c’est la chose la plus sérieuse que puisse faire un pays. Mais plutôt que d’avoir un vrai débat sur le nombre de militaires, sur la stratégie, sur l’engagement, il n’y a eu que les discours démagogiques.
« Alors j’ai découvert après l’affectation que les gens à qui je parlais ne pouvaient pas saisir ce que je saisissais sur la réalité des combats, qu’ils ne le prenaient pas assez au sérieux, dit Hope. D’après moi, ce qui compte c’est le soldat, le soldat canadien qui est sur le terrain dans un pays étranger et qui est confronté à un ennemi qui essaie de le tuer et qu’on lui a ordonné de tuer. La nation devrait l’appuyer; ce soldat mérite qu’on lui donne tout ce qu’on peut lui donner pour qu’il réussisse. Ça ne se faisait pas. Dans certains cercles, il me semblait qu’on n’arrivait pas à le prendre au sérieux. »
Malgré les difficultés passées, Hope fait remarquer que les Canadiens devraient quand même être fiers de ce que leurs for-ces armées ont accompli en Afghanistan.
« Il y a de nombreuses possibilités d’avenir, ici; il n’y a pas qu’une seule possibilité d’avenir : il y a plusieurs avenirs possibles, et je pense que la majorité d’entre eux sont bien meilleurs que ceux qu’ils avaient avant. J’en suis sûr. Et je suis prêt pour ces divers avenirs. Je suis prêt pour ça, et j’accepterai ça. Même si tout échoue et qu’on recule, je crois encore qu’on a bien fait d’intervenir en Afghanistan, d’essayer. »
En fin de compte, d’après Hope, les efforts en Afghanistan ne sont pas différents des combats menés par le Canada auparavant – il mentionne la crête de Vimy – en ce sens qu’ils ont servi à forger un type particulier d’identité canadienne.
« Ce que le Canada a acquis ici – ce n’est pas facile à dire, surtout aux gens qui ont perdu une fille ou un fils –, c’est que notre crédibilité en tant que nation est bien meilleure, le respect envers le Canada en tant qu’allié ou partenaire fiable est bien plus solide qu’il y a 10 ans. La réputation de nos forces armées n’a pas été comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. »
![DES SOLDATS NOUVELLEMENT FORMÉS PARTENT EN GUERRE, 2013. [PHOTO : ADAM DAY]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2014/01/Afghan6.jpg)
L’avenir imprévisible
Le conflit se terminera-t-il? La réponse compliquée, c’est qu’à ce moment-ci, l’Afghanistan a de nombreuses possibilités d’avenir, certaines paisibles, d’autres non. La réponse brève à savoir si la violence se terminera : c’est peu probable.
Voyez cette citation tirée d’un compte rendu de renseignement américain : « En outre, l’économie de l’Afghanistan qui croissait à un rythme constant ralentira probablement après 2014. Il y a peu d’espoir que Kaboul puisse suppléer la diminution de l’aide et des dépenses militaires de l’Ouest qui ont stimulé la croissance de la construction et des secteurs de services. Son secteur de l’agriculture licite et ses petites entreprises ont aussi bénéficié des projets de développement et d’assistance d’organisations non gouvernementales, mais le pays fait face à un taux élevé de pauvreté et de chômage, à l’insécurité alimentaire et à la culture du pavot. »
Alors il s’agit de trouver une manière d’interpréter le syntagme écrit plus haut : « Il y a peu d’espoir ».
S’il y a peu d’espoir de pouvoir suppléer la diminution du financement, cela signifie qu’il y a peu d’espoir que le gouvernement afghan puisse couvrir ses dépenses. Ses dépenses les plus élevées sont, de loin, celles de l’armée nationale afghane.
Donc : Il y a peu d’espoir que les choses ne se détraquent pas, dans une certaine mesure.
Les moments les plus importants de l’histoire militaire du Canada sont ceux où de jeunes hommes fonçaient tête baissée en plein cœur de l’action. Et c’est là que l’on trouve la vraie stratégie de la guerre du Canada en Afghanistan. Pendant les années qui ont suivi le 11 septembre, le besoin le plus urgent relatif à la sécurité nationale concernait les obligations envers les alliés, à son devoir quand son plus grand allié est attaqué.
Alors pourquoi le Canada a-t-il dépensé plus de 20 milliards de dollars et subi plus de 2 000 blessés? Pourquoi perdre 158 vies pendant cette mission? Pourquoi?
Ils sont morts pour donner un meilleur avenir à l’Afghanistan. Ou plutôt, une bonne possibilité de meilleur avenir. Peut-être.
Ils sont morts pour consolider l’OTAN et essentiellement en l’honneur de notre allié méridional. Peut-être.
Ils sont morts en essayant de tuer l’ennemi. Voilà; ça, c’est logique.
En tout cas, ce fut toujours la vérité sur le terrain.
Épilogue – La question de valeur
(question personnelle, a-t-on découvert)
Au Canada, on trouve les restes de la guerre partout, bien qu’on ne puisse pas les voir; un fléau de cœurs souffrants et de tête malsaines.
C’étaient toutes les bombes enfoncées sous terre. Simplement une cruche de plastique remplie d’engrais et de quelques morceaux de métal, un peu de fil métallique et une pile chinoise bas de gamme. Ce n’est pas exactement de cela qu’on fait les cauchemars. En fait, je blague. C’est exactement de cela qu’on fait les cauchemars.
La guerre me laisse perplexe et j’ai l’impression qu’elle tiendra bientôt du mythe. D’après moi, il n’y avait pas suffisamment de force sur le terrain pour faire ce qu’il fallait, et aucun général n’acceptait de le dire d’une manière qui fasse changer les choses. Les politiciens étaient indécis, et ils espéraient obtenir des votes. Alors plutôt que de faire ce qu’il fallait pour nettoyer, tenir et bâtir Kandahar, on s’est raconté des histoires les uns les autres en espérant que tout se passe bien. Il s’agissait de soldats contre les poseurs de bombes, pas beaucoup plus que ça.
Je me suis fait arranger les dents en janvier dernier, de la manière où l’on pose de nouvelles couronnes par-dessus, ce qui me va. Je suis content que les alliances du Canada soient plus solides, mais je suis contrarié quand, pour une raison ou une pour autre, je me rappelle comment c’était quand je me suis retrouvé la tête qui sonnait et la bouche pleine de dents cassées.
Cela en valait-il la chandelle? Je n’en sais rien du tout. J’espère que les Afghans auront un bel avenir.
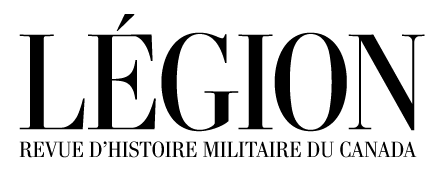
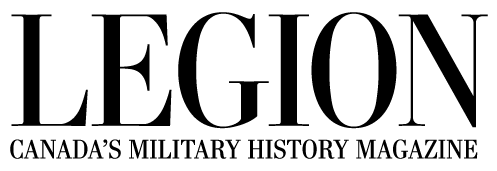







Comments are closed.