![Des soldats éclaboussés quittent la Somme en automne 1916. [Photo : BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA—PA207187]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather1.jpg)
Les répercussions de la guerre se font sentir longtemps après l’explosion du dernier obus et le dernier coup de feu. Elles se propagent, comme les ondes d’une explosion, d’une génération à l’autre.
Ce n’est pas ce qu’il voudrait que je fasse. Mon grand-père ne voudrait pas me voir étendu dans ce champ froid et humide de France.
Je m’en rends compte, mais je ne peux pas me relever pour m’acquitter du devoir qui m’a amené ici.
Alors, pendant quelques secondes, je ferme les yeux et je le vois étendu sous la pluie, accroché à un barbelé dans un monde boueux perforé par les obus et sans couleur : tout est gris, noir.
![Clarence Black avant son départ pour la France. [Photo : COURTOISIE DE ROBERT BLACK]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather2.jpg)
Six… sept… huit heures il a passées ici après avoir été touché par un éclat d’obus allemand à explosif de grande puissance. La douleur de la fracture ouverte à la jambe droite est insoutenable, au-delà de tout ce qu’il avait jamais ressenti. Il perd son sang et il sue, et il a de plus en plus froid.
Il pleut maintenant aussi.
Il était ici, en France du Nord, pendant la bataille de la Somme, une campagne acharnée, sanglante qui a déchiqueté des centaines de milliers de personnes entre le 1er juillet et la fin de novembre 1916. Rien que le premier jour, les pertes des Britanniques se sont élevées à 57 470 morts, blessés et disparus, dont 710 Terre-Neuviens qui servaient dans la 29e Division britannique à Beaumont Hamel.
Le Corps canadien a évité ce terrible premier jour, mais le 15 septembre, la 2e Division canadienne attaquait les défenses allemandes près du village en ruines de Courcelette. Les chars, invention britannique, servaient pour la première fois de l’histoire de la guerre pendant que les hommes s’avançaient, mais les six géants de 25 tonnes affectés à l’attaque canadienne sont tombés en panne ou se sont fait coincer.
Les quatre divisions du Corps canadien ont répandu leur sang à la Somme, et le bataillon de mon grand-père, le 73rd Royal Highlanders of Canada, arrivé avec la 4e Division à la mi-octobre, est la dernière unité qui en est partie.
J’ouvre les yeux et je me sens étouffé par les nuages gris qui glissent dans le paysage. J’essaie de m’imaginer ce qu’il avait à l’esprit; était-il même conscient alors qu’il avait perdu tant de sang et qu’il souffrait tellement? Avait-il abandonné ou avait-il encore de l’espoir? Essayait-il de fuir la terrible probabilité qu’il allait mourir tout seul en pensant à son foyer, à sa famille, ou s’accrochait-il à la réalité afin d’y faire face le mieux possible? J’imagine les détonations et le sifflement des balles, et le sol qui tremble. Il a eu suffisamment de discernement et de forces pour se faire un tourniquet à la cuisse à travers les barbelés, au-dessus de l’horrible blessure où l’os perçait la peau.
![Le champ d’un cultivateur à la Somme. [Photo : Dan Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather3.jpg)
Le soldat Clarence Black, âgé de 22 ans, n’avait pas été chanceux, et ce n’était pas le seul parmi tous ceux qui étaient allés en guerre. Il savait qu’il pouvait saigner à mort ou être anéanti par le prochain obus, ou bien par une rafale de mitrailleuse, mais qu’y pouvait-il?
Il y a des hommes qui meurent dans des explosions. Il y a des hommes qui se font tirer dessus. Il y a des hommes qui disparaissent et d’autres qui reviennent.
Peut-être serait-il un des chanceux. Peut-être sa jambe serait-elle sauvée. Pour l’instant, il faisait partie des victimes de la Somme, et bien qu’il ne pût prédire son sort, son histoire n’aurait rien de particulier parmi les milliers de soldats transformés par la guerre.
Deux jours avant de me rendre au vieux champ de bataille où je me suis imaginé de quoi l’endroit avait l’air en novembre 1916, je suis assis confortablement à un café français, et je me demande ce que mon grand-père voudrait que je raconte sur son histoire militaire.
Je le vois taper des phalanges sur la table, et d’un sourire mi-figue mi-raisin, il me dit que c’est très bien de venir en France du Nord, d’essayer de reconstruire les quelques années qu’il a été soldat, mais que je devrais aussi faire attention à ce qui est arrivé avant et après l’explosion de l’obus.
Il voudrait que je reconnaisse la bataille de la Somme pour le massacre que c’était vraiment, et il aimerait que je retourne au pays et que j’aille faire un tour dans le coin de Devil’s Elbow, un de ses lieux de prédilection dans les collines de Lanark, à l’ouest d’Ottawa. Il voudrait que je conduise par là avec le plus jeune de ses fils, mon père.
![Parsemé de cratères autour des tranchées Regina et Kenora, septembre 1916. [PHOTO : BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA—C043992]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather4.jpg)
Alors je vais suivre les ondes émises par cette explosion, le pénible rétablissement de mon grand-père, l’armistice, son mariage, l’éducation de ses quatre enfants, les parties de balle molle, les voyages au chalet de Lavant Station, une autre guerre mondiale, et peut-être encore plus important pour lui et sa famille, la douloureuse fin de son mariage.
Il est difficile d’évoquer le passé parce qu’il n’existe pas beaucoup de matériel à étudier : pas de mémoire, pas de pile de notes, de cartes postales ni de recueil de lettres. Les photographies ne manquent pas, dont une où Clarence porte des pantalons froissés et un maillot de corps sans manches qui évoque sa passion pour la pêche et le grand air, mais il n’y en a pas au front ni même en route pour la France. Les souvenirs qu’il avait de la guerre étaient principalement conservés dans sa tête, rarement racontés.
Des années après sa mort, j’ai demandé ses états de service à Bibliothèque et Archives Canada. Le dossier, trouvé dans une boite pleine de dossiers de soldats, avait moins d’un centimètre d’épaisseur, et le papier qui avait 97 ans ne semblait pas très résistant.
J’y ai trouvé des renseignements écrits à la va-vite sur la date de son engagement, celles où il a pris le bateau pour l’Europe, où il est arrivé « sur le terrain » ou en France, la date de sa blessure, la cause de cette dernière, l’amputation et son rétablissement dans divers hôpitaux militaires.
J’ai aussi trouvé le journal de guerre de son unité et lu attentivement les notes manuscrites à côté des dates où son bataillon était à la Somme. Cela ne m’a rien donné de précis sur mon grand-père ni sur les autres soldats. Ces hommes étaient simplement inscrits dans le journal comme étant OR, c’est-à-dire Other Ranks (autres grades, NDT). Si l’on était officier et qu’on était tué ou blessé, on prenait acte du grade et du nom dans le journal, mais si l’on était OR et qu’on était tué ou blessé, sauf dans des circonstances exceptionnelles, on était toujours inscrit comme étant OR.
![Le Devil’s Elbow près de Lavant Station, dans les collines de Lanark. [Photo : Dan Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather5.jpg)
Un après-midi, en fouillant dans mon sous-sol, j’ai mis la main sur une boite en carton pleine de choses du temps de mon adolescence. J’étais à la recherche d’une cassette marquée « Grampa, cottage (Papi, chalet, NDT), 1970 ». Cette année-là, j’avais reçu un magnétophone Phillips portable pour mon anniversaire.
Nous étions à notre chalet dans les collines de la Gatineau, au nord d’Ottawa. Papi était assis sur une chaise en osier verte près de la fenêtre de devant, le lac et les collines derrière lui. Papa était assis à table devant lui et maman, qui avait allumé quelques bougies, était près de la cuisinière à bois.
C’est mon seul souvenir de papi racontant quoi que ce soit sur la guerre, et bien qu’il n’ait parlé qu’un petit bout de temps, j’ai enregistré ce qu’il disait sur une bande magnétique brune pas plus épaisse qu’un mouchoir de papier. Il a décrit la boue, la puanteur terrible et le danger du gaz toxique. Il a dit qu’il pleuvait tous les jours et que les tranchées étaient pleines d’eau, mais qu’il n’y avait pourtant pas grand-chose à boire. Il se rappelait le masque à gaz qui le faisait suer et suffoquer et qui l’empêchait de bien voir. Puis, il s’est arrêté subitement, dans la lumière vacillante, comme si quelqu’un avait actionné un interrupteur dans son cerveau.
En fouillant dans la boite, j’ai trouvé la cassette, mais la bande s’était désintégrée. Pourquoi ne m’en suis-je pas mieux occupé? Pourquoi n’en ai-je pas fait des copies? Il y avait surement des renseignements importants qui sont perdus à jamais.
Les états de service de mon grand-père seraient le premier indice me rappelant ce qu’il nous avait raconté cet été-là. Heureusement qu’il y a quelques souvenirs hérités, dont me font part les membres les plus âgés de ma famille. Papa s’est mis à raconter cela il y a peu, lors d’un long voyage en voiture que nous avons fait à Lavant Station après mon retour de France. Nous cherchions les petites choses de tous les jours qui auraient été des effets de la survie de Clarence à la Somme.
![Des soldats canadiens, certains d’entre eux portant une pioche ou une pelle, suivent une voie ferrée à la Somme, en septembre 1916. [PHOTO : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NAITONALE/BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA—PA000682]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather7.jpg)
C’est à la commune de Contay, à 23 kilomètres au nord-est d’Amiens, en France, qu’un chirurgien ensanglanté et surchargé de travail a amputé une jambe à mon grand-père, 28 centimètres sous la hanche. C’est arrivé le lendemain du jour où il avait été blessé, mis sur une civière et transporté au poste d’évacuation des blessés no 49.
J’ai cherché des indices sur le no 49 autour de la commune, mais bien entendu, je n’ai rien trouvé, et quand j’ai demandé à quelques personnes s’il y avait un amateur d’histoire militaire dans le coin qui puisse me renseigner, elles ont haussé les épaules : « je regrette, mais… ».
Il n’y a même pas 400 personnes qui habitent à Contay, et une grande partie d’entre elles vont au travail, au jour le jour, de par les routes étroites qui sillonnent la campagne. Les Français se souviennent indubitablement de la guerre, ainsi que de celle qui l’a suivie, mais si ce n’était des monuments gris et des rangées de pierres tombales parfaitement alignées, on pourrait faire Amiens-Bapaume sans avoir la moindre idée de la sauvagerie qui s’est produite il y a un siècle.
Le long de la rue, vers le monument militaire de Contay, je me rappelais le visage de mon grand-père. Au début, il était tel que je m’en souviens : arrondi, propre et rasé, avec remarquablement peu de rides sous les cheveux blanc argenté. Je voyais les yeux bleus sur fond basané, et puis l’image s’est volatilisée pour être remplacée par le visage solide, plus jeune, d’une photographie où il avait 21 ans, recrue portant une tunique et un kilt soigneusement repassés.
Je me suis ensuite imaginé un visage pâle maculé de boue, les yeux fixant le toit à côté d’un chirurgien. Je me suis souvenu des mémoires de John A. Hayward, chirurgien militaire pendant la guerre.
L’histoire de Hayward a été publiée en 1930 dans un livre intitulé Everyman at War (L’homme à la guerre, NDT), et il y décrit un poste d’évacuation des blessés près du front où, pendant une attaque nocturne, l’horizon était « brillamment éclairé par l’explosion des dépôts de munitions, les fusées éclairantes Verey et les obus éclairants ».
Il y était écrit que les postes d’évacuation des blessés avaient servi à sauver bien des vies et « révolutionné » la chirurgie pendant la guerre, que « la septicité mortelle et la gangrène gazeuse causées par les blessures pouvaient être évitées si l’on effectuait l’opération dans les 36 heures après la blessure et que tout le tissu mort ou endommagé était extrait, malgré la mutilation considérable encourue ».
L’endroit où il travaillait comprenait des tentes pour la réception des patients, la réanimation, le travail préopératoire, la chirurgie, l’évacuation et l’observation. La tente des opérations avait six tables qui étaient utilisées presque tout le temps pendant et après les combats. Les hommes arrivaient sur des civières, étiquettes de blessure comprises, ou à pied. Les blessures qu’il voyait étaient indescriptibles, mais Hayward était ahuri du silence des blessés.
Il lui arrivait de travailler jusqu’à 36 heures d’affilée, s’occupant de 10 à 12 cas, et il se souvenait qu’un chirurgien rapide pouvait s’occuper, en 12 heures, de 15 à 20 d’entre eux. Une fois, après une période particulièrement sanglante, Hayward était sorti prendre l’air. Il est entré dans une annexe « pleine de rangées de cadavres ». Dans un autre édifice, il a trouvé un tas de bras et de jambes amputés depuis peu.
![Clarence à côté d’un des lacs où il aimait aller. [Photo : COURTOISIE DE ROBERT BLACK]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather8.jpg)
Cela m’a donné une idée plus précise.
La jambe de papi a été amputée quelques minutes après qu’il a été déposé sur une table. Le membre ensanglanté a été transporté dans un chariot et jeté sur un tas. Alors une partie de lui est restée en France et le reste a continué d’exister pendant 56 ans, jusqu’à ce que ses restes soient ensevelis, deux jours après le jour du Souvenir, lors d’une petite cérémonie non loin de l’endroit où il avait grandi.
Ce soir-là, après avoir quitté Contay et m’être mis à l’aise dans ma chambre d’hôtel tranquille et confor-table à Albert, j’ai regardé ma jambe droite et mesuré 28 centimètres à partir de ma hanche.
Parmi les souvenirs les plus précis que j’ai de mon enfance, il y en a un non pas de mon grand-père, mais de sa jambe artificielle.
Elle est encore dans son pantalon, mais elle ne lui est pas ajustée. Elle est appuyée contre un lit soutenu par un banc de bois à chaque bout.
C’était en plein été, pendant une nuit chaude et humide. J’avais 10 ans et je me rendais à la toilette extérieure à tâtons, traversant l’obscurité entre mon lit et l’arrière du camp à une seule pièce bâti dangereusement près de la route de terre, tellement près que nous n’avions pas le droit de dormir dans le lit double situé au coin nord-est de peur qu’une voiture rate la courbe et heurte l’endroit.
Je vois le galbe de la jambe de papi apparaitre lorsque je me glisse entre le métal froid de la cuisinière à kérosène et le pied du lit.
Ce n’était pas la première fois que je voulais voir, par simple curiosité, de quoi elle avait l’air, comment on se sent quand on a une jambe comme ça; quand on monte ou qu’on descend les escaliers ou qu’on la soulève par-dessus le plat-bord d’un bateau de pêche.
Monter sur une échelle, ce n’était pas facile pour papi, alors je m’étais proposé pour goudronner le toit. C’était en fin d’après-midi et, vu que j’étais à califourchon sur le faîte du toit, le papier goudronné me brulait les jambes. Torse nu, mouches à chevreuil en orbite autour de ma tête, je barbouillais les joints et la base de la cheminée en métal, respirant les vapeurs qui sentaient le charbon et l’essence.
Je me souviens d’avoir vu papi en bas, sur la pente voisine du camp, son poids portant surtout sur sa bonne jambe plutôt que sur son « autre bonne jambe ». Il avait du bois d’allumage sous le bras, qu’il était allé chercher au bucher calé entre le mur arrière du camp et le cabinet à deux trous.
![Le vieux camp de chasse pendant les années 1950. [Photo : Courtoisie de Robert Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather11.jpg)
Il avait presque toujours un sac à poubelles à la main ou à la ceinture. « Quand je mourrai, m’a-t-il dit un jour, mets-moi dans un de ces sacs et fais-moi rouler en bas de la pente. »
C’est pour ça que je l’aimais tant.
Papi n’était pas prétentieux : pas d’avènements ni d’extinctions grandioses pour lui.
S’il avait des motifs fallacieux devant nous, enfants, ils étaient pratiques et purs, comme le sirop d’érable de Lanark qu’il versait dans une bouteille de rye vide avant qu’on passe à table manger des crêpes ou un morceau de tarte à la citrouille. « Passe-moi le rye, disait quelqu’un. On va se saouler aux crêpes. »
![Le vieux camp de chasse aujourd’hui. [Photo : Dan Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather10.jpg)
En passant au pied du lit de papi en allant à la toilette, je m’approche de la jambe pour bien la voir, mais la partie supérieure des pantalons m’en empêche.
Je me demande maintenant s’il me regardait. Je me demande aussi ce qu’il est advenu de cette « autre bonne jambe ». A-t-elle fini dans un entrepôt, ou a-t-elle été passée à quelqu’un d’autre? Il avait plusieurs prothèses adaptées au moignon couvert de feutre. La « peau » de la dernière rappelait à mon père le matériel pliable rose dont on se servait pour fabriquer des poupées pour les enfants.
Des fois, sans beaucoup de préavis, mon grand-père allait au chalet tout seul parce qu’il lui fallait un endroit où il pouvait se détendre sans la jambe. Il avait simplement besoin de l’enlever afin de soulager la pression sur le moignon qui était parfois très irrité, et il se servait alors des béquilles pendant quelques jours.
Ça devait être très douloureux à certains moments, mais il ne s’en plaignait jamais, ni ne se fâchait-il. Son humour noir, probablement acquis pendant la guerre, a beaucoup attiré mon attention.
Une fois, quand j’étais juché sur son « autre bonne jambe », il m’a fixé des yeux et m’a dit d’une voix basse et égale : « Tu ferais bien d’être sage, sinon, je te coupe la tête et je te la jette au visage. »
La plupart des parents, et encore plus les enfants, seraient tout retournés en entendant de telles paroles, mais pour nous, c’était absurde à en être drôle, quelque chose qui nous faisait rire et qu’on répétait.
On récolte ce que l’on sème. Quand on fait la guerre, on perd des vies, des bras, des jambes, des esprits.
Plus de 66 600 membres des Forces canadiennes sont morts à la guerre qu’a faite mon grand-père, et près de 173 000 y ont été blessés. Parmi ces derniers, plus de 3 460 ont eu un membre amputé. Il y a un soldat, Ethelbert Christian, surnommé Curly, qui en a perdu quatre et qui a eu une vie active jusqu’à son décès, en 1954.
Après cinq jours à Contay, mon grand-père a été transféré à l’hôpital général no 6, à Rouen, en France, et puis à un hôpital spécialisé à Ramsgate, en Angleterre. Le 13 mai 1917, il est monté à bord du vapeur Letitia, un navire-hôpital bondé, à destination du Canada. Il a passé plusieurs mois à Toronto, à la salle d’orthopédie militaire où, le 17 octobre, les médecins disaient de lui que c’était un soldat qui avait « une bonne conduite » et de « bonnes habitudes ». Ils ont écrit que le « moignon a bien guéri. Lambeau antérieur long, cicatrice ni sensible ni douloureuse. Mouvements de la hanche puissants et libres. Muni d’une jambe artificielle entièrement satisfaisante et il marche bien ».
![Les médailles militaires de Clarence. [Photo : Courtoisie de Robert Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather12.jpg)
Clarence a déménagé à Ottawa et il s’est installé dans un appartement du centre. Il a obtenu un emploi de commis à la Banque du Canada et, le 2 juillet 1919, il a épousé une jolie fille du nom de Venita Bennett.
Il avait 25 ans; elle, 20. Ils étaient amoureux et chanceux d’avoir évité la grippe pandémique mortelle qui a couté la vie au cadet de Venita, Foster, et à des millions de personnes dans le monde.
Le couple a déménagé par la suite dans un duplex où il a élevé quatre enfants. Keith, l’ainé, est né peu après la guerre. Gloria est arrivée en 1923, puis il y a eu Gilbert en 1929 et mon père en 1933, quelque 13 ans après Keith qui a servi dans l’Aviation royale du Canada.
C’était un foyer heureux avec ses pique-niques et ses sorties de pêche. Il y avait des visites à la ferme Bennett, à Uplands, où mon père regardait les Harvard jaunes du Programme d’entraînement aérien du Commonwealth vrombir dans l’espace aérien.
Il avait sept ans, et il se souvient du rationnement et de la règle qu’il y avait dans la famille selon laquelle il fallait manger tout ce qu’on avait dans son assiette. « Si l’on nettoyait l’assiette comme il faut, on avait le droit de la retourner et on pouvait manger le dessert de l’autre côté. »
Ces souvenirs sont entrecoupés de ceux relatifs aux moments plus sombres quand les familles du voisinage apprenaient que le fils, la fille ou le mari étaient morts outre-mer. Les hurlements de la femme à cinq portes de chez lui sont restés à l’esprit de papa, ainsi que la douleur silencieuse qu’il a remarquée sur le visage du bon ami de son père, Alfie Morrison, quand il a perdu un fils lui aussi.
Au début des années 1940, un tout autre silence s’est installé dans le duplex où habitaient mon père, son frère Gilbert et leurs parents. La longue relation amoureuse de Clarence et de Venita avait changé. Papa n’avait que neuf ou dix ans, et il se demandait quelle en était la cause. « Il y avait une tension évidente et, au début, c’est parce qu’on ne m’en disait rien que je ne savais pas comment me comporter à leur endroit. »
Les parents de papa restèrent dans la maison, dorénavant un mariage de convenance, pendant qu’il se concentrait sur l’école, les sports et les amis. « Je les aimais tous les deux, et je continuais de faire des choses avec eux séparément, mais il y avait d’autres choses qui m’absorbaient. […] Quand j’ai terminé l’école secondaire, je suis allé vivre avec ma sœur mariée et sa famille, au Québec. À ce moment-là, maman et papa sont allés chacun de son côté, et ils ont divorcé par la suite. »
Les années de silence, en plus de la vie bien remplie d’un adolescent et la Seconde Guerre mondiale que les gens avaient toujours à l’esprit, ne laissaient que de rares occasions à un garçon de demander à son père de lui raconter ses histoires militaires. Quand ils se voyaient, leurs conversations étaient anodines.
![L’ancien combattant bien après la guerre. [Photo : Courtoisie de Robert Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather14.jpg)
Papa n’a donc entendu que des commentaires ici et là, et il n’a jamais pris le temps, même après la mort de son père, quand il construisait un arbre généalogique étendu, de se pencher sur ce moment-là à la Somme.
En parlant de cette histoire avec mon père, je me souviens d’un moment plus facile à considérer, mais quand même relié à l’explosion de 1916 qui a mis à mal Clarence et à celles qui ont affecté d’autres hommes. C’est la fête de Noël des Amputés de guerre, organisée dans le sous-sol d’une église et où des dizaines d’enfants en habit du dimanche attendent timidement, mais impatiemment leur tour pour aller s’asseoir sur les genoux du Père Noël. Je me souviens d’hommes qui avaient des mains, des bras, des jambes ou des pieds artificiels bavardant non pas de la guerre, mais de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
Clarence, bénévole sérieux pendant des années, était bien aimé. Dans une coupure de journal jaunie des années 1960, on annonçait qu’on lui avait décerné un certificat pour service méritoire en tant que trésorier de la filiale ottavienne des Amputés de guerre.
Je me souviens aussi d’enfants serrés pendant un quart d’heure devant le minuscule théâtre de marionnettes qu’il y avait entre eux et nous; « nous », c’était ma sœur cadette Lori-Jayne et moi. À l’aide de la même machine à écrire qu’elle utilisait pour taper le procès-verbal des réunions des Amputés de guerre, maman avait écrit un script intitulé « Zing And Zang Zong Meet The Purple-Necked, Black-Bearded Blatch (Zing et Zang Zong rencontrent le Blatch à cou pourpre et à barbe noire, NDT) ».
Il s’agissait de deux gamins un peu agaçants et d’un monstre adorable sans bras qui servait à attendrir un vieil homme au mauvais caractère, M. Figg.
Papi n’était pas un M. Figg, mais il connaissait des hommes que la guerre avait vivement contrariés.
L’été est revenu. Tel que promis, papa et moi sommes en route vers le lac Robertson dans les collines de Lanark, à Lavant Station. Il occupe le siège passager de ma voiture et parle dans un enregistreur numérique.
Nous avons peu de temps, mais tellement de choses à aborder.
Au début, je ne sais sur quel pied danser : suis-je journaliste ou fils? Je m’entends fort bien avec mon père, et je ne veux pas lui poser des questions auxquelles il risque de ne pas vouloir répondre, mais je veux vraiment savoir comment c’était d’avoir un père comme celui qu’il avait, un homme qui semblait agir comme s’il n’avait pas été touché par l’explosion. Je veux aussi savoir comment c’était d’avoir une mère fière et affectueuse qui avait de l’assurance et qui a tenu le coup quand son mariage était en difficulté, jusqu’au moment de la séparation.
![Venita Bennett qui a épousé Clarence en 1919. [Photo : Courtoisie de Robert Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather13.jpg)
Venita était une dame douce et gentille qui portait des vêtements élégants et, des fois, pour le plaisir, colorait ses cheveux en rose. Elle enseignait le piano et le violon, et elle consacrait tout le temps qu’il fallait à ses enfants et à ses petits-enfants jusqu’à ce que le cancer l’emporte, à l’âge de 79 ans, en 1977.
Mon père me dit que s’il pouvait parler à ses parents aujourd’hui, il leur dirait combien il les aimait. Il leur demanderait ce qui est arrivé à leur mariage et si la guerre y était pour quelque chose. « On ne peut pas changer ce qui s’est passé, mais je voudrais le savoir. »
La route vers le camp de chasse aujourd’hui est pavée et plus large qu’autrefois. La lumière qui illumine les collines entre les conifères et les blocs de granit est plus vive que celle dont je me souviens. Autrefois, sur le banc arrière de la Chevelle bleue de mon grand-père, je savourais à l’avance le virage à gauche dangereux qu’on appelait le coude du diable. C’était le vendredi soir. Papi conduisait et sa deuxième femme était à côté de lui, stoïque, attendant le virage tout en regardant les papillons de nuit s’écraser sur le pare-brise. La voiture était à transmission automatique, mais papi aurait tout aussi bien pu conduire une manuelle.
Papa me dit que l’Oldsmobile verte de 1936 qu’avait son père avait une barre soudée entre la pédale d’embrayage et celle des freins, ce qui lui permettait de conduire une manuelle avec son pied gauche.
Nous avons passé la matinée à nous rappeler notre héritage écossais tout en nous promenant dans la campagne au nord-ouest de Carleton Place. Il faut que je sache d’où venait mon grand-père, même avant sa naissance.
Nous partons à la recherche de la vieille ferme Galbraith où il a grandi, où six garçons et leurs parents, Robert et Phoebe, ont déménagé avec les parents de cette dernière quand il y eut trop de monde à la ferme de la famille Black.
Papa dit que le déménagement était une bonne chose pour les garçons qui allaient à l’école. « Elle était tout juste à côté de l’entrée de la ferme et l’instituteur habitait chez les Galbraith. C’était une école à une seule salle. »
Les Black exploitaient une ferme constituée par des parents qui, selon l’arbre généalogique, sont arrivés au Québec en 1821 dans le cadre du programme d’émigration écossais. Un groupe dirigé par Walter Black, arrière-grand-père de Clarence, a remonté le Saint-Laurent jusqu’à Brockville et puis, à pied et en charette, jusqu’à Perth, et en bateau, sur le Mississippi, jusqu’à la municipalité de Ramsay. Leur existence était alors misérable, dure, et quand les récoltes avaient été faites, les hommes quittaient les femmes et les enfants pour aller couper des pins en haut de la vallée de l’Outaouais, lesquels servaient à la construction de navires en Angleterre.
![Le père de l’auteur à l’ancienne ferme des Black à Almonte, en Ontario. [Photo : Dan Black]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather16.jpg)
Le temps de mon grand-père est venu bien après ça. Il a vite grandi, à cause des durs travaux de la ferme et des sorties de pêche intermittentes à la rivière Indian où ses frères et lui se couchaient sur le ventre pour attraper des suceurs, à la main, lors de la fraie. « Ils les attrapaient, les jetaient derrière eux et les mettaient dans des sacs, m’explique mon père. Il avait 10 ou 12 ans et il s’amusait à mettre des pierres dans les sacs de ses frères et les regardait avancer avec peine à travers champs. »
En passant par la municipalité de Ramsay, je m’imagine Clarence traversant les champs : un garçon basané qui avait deux jambes puissantes, qui tapait un de ses frères avec son sac de poissons. Je le vois ensuite à Montréal le 7 septembre 1915, se tenant fièrement, en vêtements civils, devant un sergent recruteur qui s’occupait de dizaines de jeunes hommes.
Je le vois ensuite le lendemain, toujours sur deux jambes puissantes, dans une pièce froide et ne portant que des caleçons et un ruban à mesurer autour de la poitrine. « Quatre-vingt-quatorze centimètres à l’inspiration, a écrit le médecin militaire dont l’examen hâtif s’est terminé par la déclaration « bon pour le service outre-mer » et par une petite note, sous les mots « Distinguishing Marks » (marques distinctives, NDT), que le jeune soldat avait un peu de pigmentation à gauche de la poitrine et de l’aine.
Clarence avait 21 ans et quatre mois, 1,75 mètre, les yeux bleus, et les cheveux châtains. Il pesait 69,85 kilogrammes; il n’en pèserait pas autant en rentrant chez lui. « Il voulait probablement y aller, dit papa. C’était la chose à faire, et ils étaient nombreux à penser que ce serait vite terminé. »
Rien n’arrive rapidement dans l’armée, sauf de se faire tirer dessus quand on est outre-mer. Mon grand-père, matricule 132314, a attendu six mois avant de monter à bord du navire de la marine marchande Adriatic, un paquebot de 24 500 tonnes lancé en 1906 par la White Star Line. L’Adriatic, devenu transporteur de troupes, a survécu à la guerre, mais un grand nombre des hommes qu’il a transportés, non.
Il lui fallait 10 jours pour fendre les eaux froides de l’Atlantique jusqu’à Liverpool. Clarence est parti pour la France le 12 aout 1916, avant l’arrivée du Corps canadien à la Somme.
La grosse offensive à la Somme a été lancée par le général Douglas Haig dans le but de réduire la pression sur les Français qui étaient « saignés à blanc » à Verdun. La Somme est vite devenue une bataille d’usure qui a duré cinq mois et causé la mort ou la blessure de plus de 1,2 million d’hommes sans ne guère gagner de terrain. Les avancées territoriales les plus grandes des Britanniques et des Français n’ont pas été de plus de 10 kilomètres; néanmoins, le nombre de leurs hommes tués ou blessés s’est élevé à environ 636 000.
Au début, Haig croyait fermement en ce qu’il faisait, mais d’autres mettaient en doute la valeur d’un assaut prolongé comme celui-là contre un ennemi retranché dans de bonnes positions fortifiées. Beaucoup d’historiens ont argumenté depuis que l’offensive de la Somme illustre parfaitement l’échec de la logique militaire au plus haut degré. Desmond Morton et J.L. Granatstein remarquent que, pour les Canadiens comme pour d’autres, « la Somme est un souvenir de tueries ordonnées par des généraux tout-puissants qu’on ne voyait jamais ».
![Robert et Phoebe Black et quatre de leurs enfants. Clarence est le deuxième à p. de la gauche. [PHOTO : COURTOISIE DE ROBERT BLACK]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather17.jpg)
La veille de ma visite au vieux champ de bataille où mon grand-père a été blessé, je me suis arrêté au gros bloc de granit qui sert de monument commémoratif des Canadiens qui ont servi à la Somme entre le début de septembre et la fin de novembre 1916. Plus de 24 000 d’entre eux ont été tués, blessés ou capturés durant ces trois mois.
Il fait frais et venteux, et les grandes ombres glissent sur la terrasse dallée qui entoure le monument. À ma droite, par-dessus mon épaule, les camions qui se précipitent sur la grand-route dégagent des émanations de diesel au-dessus des champs en transportant des produits aux marchés. Au nord, au-delà d’un champ, les toits de Courcelette sont remarquables grâce au paysage jaune et vert qui s’élève derrière le village et les routes enfoncées.
Le souvenir d’une photo aérienne noir et blanc célèbre du champ de bataille parsemé de cratères d’obus prise à l’automne de 1916 me revient en mémoire. En novembre, les cratères se comptaient par milliers. Je m’imagine cette image et celles de la bataille de 1917 à Passchendaele où des milliers d’hommes ont trouvé la mort et ont disparu dans la boue.
Dans les airs au-dessus de la Somme, les tranchées et les barbelés qui se croisaient avaient l’air de points de suture sur un cadavre monstrueux. Il y avait des madriers brisés, des chars démolis et des hommes mis en pièces. L’odeur de la décomposition se répandait dans les poumons et pénétrait dans les vêtements.
Il est vraiment remarquable que la terre ait guéri, qu’elle soit arrivée à meilleure fin grâce au travail des cultivateurs travailleurs et de l’expertise des gens employés par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth.
Je me suis agenouillé devant le monument et, en souvenir de mon grand-père, j’ai fixé un coquelicot à un drapeau canadien qui flottait au vent à côté d’une toute petite croix blanche.
Après, en marchant près d’une église marquée par les intempéries, au village de Courcelette, j’ai remarqué un petit monument et, au-delà, une maison à la fenêtre de laquelle se trouvait un chat gris et noir. Il y avait une jeune femme qui déposait un enfant. Je l’ai regardée monter dans une voiture et partir sur la route encaissée qui mène à l’autoroute principale.
Le chat m’a simplement regardé en bâillant.
Le bataillon de Clarence est arrivé à la Somme à la mi-octobre 1916. À ce moment-là, l’avancée des Canadiens avait été stoppée à la tranchée Regina. Pendant deux semaines, le 73e Bataillon est demeuré dans un campement ouvert d’où de grands groupes de travailleurs partaient tous les jours réparer les tranchées détrempées. Plus près du front, d’autres bataillons de la 4e Division canadienne menaient des attaques infructueuses contre la tranchée Regina puissamment fortifiée.
Dans la nuit du 29 au 30 octobre, le 73e s’est déplacé jusqu’au front où il a passé cinq jours sous le pilonnage incessant des obus. Les hommes fatigués et tachés de boue ont ensuite gagné Bouzincourt à pied, où ils ont dormi dans les maisons démolies.
![Le cimetière militaire Adanac, au nord de Courcelette. [PHOTO : DAN BLACK]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather18.jpg)
Pendant que les 10e et 11e brigades de la 4e Division prenaient la tranchée Regina, le 11 novembre, le 73e, qui faisait partie de la 12e Brigade, s’en approchait en prévision d’une contre-attaque. Les hommes, Clarence y compris, s’avançaient le long des tranchées de communication, dans la vase jusqu’à la taille.
Le bataillon a été bombardé à plusieurs reprises avant d’être renvoyé aux arrières pour se reposer de nouveau.
Le 18 novembre, sous la neige fondue fouettée par le vent, les hommes ont reçu des bottes cuissardes avant d’être renvoyés au front pour une dernière fois, une affectation qui s’est terminée le lendemain de la blessure de Clarence.
Dans l’ensemble, mon père et moi sommes frappés par la brièveté du temps que Clarence a passé à la Somme : 40 jours seulement entre l’arrivée de son bataillon et sa blessure. Le temps qu’il a passé au front au nord de la tranchée Regina était encore plus court : à peine plus de 12 jours en trois fois. Cela semble être un temps si court dans une vie qui a duré 78 ans, mais je comprends à quelle vitesse un homme pouvait se faire tuer ou blesser au front ou en s’y rendant.
Les quatre derniers jours du bataillon à la tranchée Desire se sont soldés par six officiers blessés, huit autres grades tués et 34 blessés. L’obus à explosif de grande puissance qui a atteint Clarence n’avait rien d’inhabituel. Il a éclaté en des milliers de fragments chauffés à rouge qui allaient plus vite que le son.
Le bataillon de Clarence a amorcé son périple d’un mois vers le nord, à la crête de Vimy, le 29 novembre, sans lui ni les 169 autres qui avaient été tués ou blessés, et malgré le fait que le 73e n’eût pas directement pris part à un assaut à la Somme.
Je dis à mon père que rien n’indique que la tranchée ait existé, bien qu’un guide dise qu’une partie arrivait, à angle droit, jusqu’au mur sud du Cimetière de fosse commune de Régina.
C’est là où je me suis rendu le dernier jour de ma visite à la Somme. J’ai erré à travers les rangées de pierres tombales en pensant au carnage et aux hommes qui ne sont pas rentrés chez eux. J’ai fait la même chose au cimetière Adanac [Canada écrit à l’envers] et à d’autres « jardins de pierre ». Et puis je me suis dirigé sous la pluie vers le nord-est et, avant d’explorer Pys et Miraumont, je me suis trouvé dans ce champ, à imaginer mon grand-père étendu à côté de moi. Je me sens comme si je m’étais introduit sans permission, non pas dans le champ d’un cultivateur, mais à l’endroit où il est tombé.
Je me suis demandé comment il a été trouvé. Est-ce que quelqu’un est tombé dessus ou a-t-il appelé à l’aide? Ce que je voulais voir, c’est les deux brancardiers épuisés esquivant les balles et les cratères. C’est ce que je voulais voir, tout comme je voulais voir une main sur son épaule ou sur son front maculé de trainées de boue.
Ça me dérangeait que personne de ma famille ne lui ait demandé de ces détails; que, collectivement, nous avons raté une belle occasion. Quelqu’un aurait dû lui demander cela au chalet, mais peut-être qu’on était fascinés par les détails qu’il racontait.
Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à nouveau au Cimetière de fosse commune de Régina et j’ai fouillé dans un tas de débris découverts en labourant les champs. En cherchant un bâton pour m’enlever la boue des bottes, j’ai remarqué des morceaux de barbelés rouillés et des fragments de trois obus d’artillerie. Le plus gros était pelé comme une banane.
J’ai lu quelque part que pour chaque mètre carré du front de l’ouest, entre la Manche et la frontière suisse, il est tombé une tonne d’explosifs, et qu’une bombe sur quatre n’a pas explosé.
Les fragments que je trouve font partie de la « récolte de fer » que font remonter tous les ans le gel et les lames des tracteurs. Le ministère de l’Intérieur de France récupère environ 900 tonnes de munitions non explosées chaque année, et quelque 630 démineurs sont morts depuis 1945 en faisant ce travail.
En route vers Lavant Station, papa et moi acceptons la suggestion que Clarence nous avait faite de nous arrêter au lac Robertson. Le temps est ensoleillé et une brise chaude souffle sur l’eau bleu argenté. Il y a quelques pêcheurs sur le lac et deux femmes sur la plage surveillent leurs enfants. « Le brochet, c’est ça qu’on pêchait, là, se rappelle papa. Son bon ami Alfie Morrison aidait ton grand-père à monter dans le bateau, mais il pouvait le faire sans son aide. »
![La décoration du service méritoire remise à Clarence par les Amputés de guerre. [PHOTO : COURTOISIE DE ROBERT BLACK]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/10/Grandfather15.jpg)
Papa se rappelle qu’il est arrivé à son père de tomber pendant la chasse au chevreuil. C’est arrivé plus d’une fois, mais il se relevait toujours, en se servant d’un bâton de ski, et il repartait. Son frère Charlie était un tireur d’élite, mais celui qui connaissait la forêt, c’était Clarence, et ce qui importait le plus pour lui, c’était d’être dans les bois, avec ses fils et avec Charlie, et de profiter de l’air frais automnal.
Clarence n’avait pas son fils le plus jeune à l’automne de 1972. Mais papa, comme ses frères ainés Gil et Keith, savait à quel point le camp était important pour son père. Il s’agissait d’être chef cuisinier et de se détendre dans les volutes de fumée de pipe et de cigare en jouant aux cartes pour quelques sous. Et après une longue journée bien remplie, il n’avait rien de mieux à faire que d’aller dormir, sa jambe contre le lit.
En règle générale, je ne passe pas beaucoup de temps à contempler le destin, mais si ce jeune soldat que je m’imagine lors de mon voyage à Contay n’avait pas survécu à la chirurgie, et s’il n’était pas rentré chez lui, tant de choses seraient différentes.
Je n’existerais pas, et il y a beaucoup d’autres choses qui n’existeraient pas non plus. Il serait probablement enterré au cimetière militaire britannique non loin du village français où, sur une pente douce dans l’ombre de grands peupliers, j’ai trouvé plusieurs noms provenant de son bataillon parmi les 414 Canadiens et plus de 700 Britanniques.
Mais le jeune Clarence a été déversé de la bataille de la Somme; recraché, un membre en moins, mais vivant. Il n’a plus jamais travaillé la terre, mais il a fini par guérir, trouver du travail, tomber amoureux plus d’une fois et devenir mari, père, grand-père et bénévole des Amputés de guerre du Canada. Et il est mort en bonne compagnie, à son endroit préféré, éprouvant peut-être quelques regrets, le 10 novembre 1972.
J’étais ado à ce moment-là, enfoui profondément dans mon petit monde de musique, de voitures, de football et de filles. Je ne m’y attendais pas; pas plus que quiconque je pense, parce qu’il semblait en santé, solide. Nous avons appris par la suite, après l’autopsie, qu’il avait eu des crises cardiaques auparavant, et j’attribue son silence sur ce sujet au stoïcisme de sa génération.
Il était tard le soir quand le téléphone sonna et papa, qui n’avait pas pu accompagner ses frères à la chasse cet automne-là, a répondu et écouté en silence son frère Gil lui dire que leur père était mort. Il était allé se coucher en pensant qu’il avait un peu d’indigestion, mais il s’est assis et s’est abattu peu après.
Quand Gil et les autres ont compris qu’ils ne pouvaient rien faire pour lui au camp, ils l’ont vite emmené à la voiture. Ils l’ont mis sur le banc arrière et sont partis dans la nuit froide de novembre sur la route tortueuse et poussiéreuse des collines jusqu’au Great War Memorial Hospital de Perth, à quelque 50 kilomètres.
Il était mort quand ils sont arrivés, certainement bien avant que mon père ou n’importe qui d’autre n’ait eu l’occasion de lui dire adieu.
Quand papa et moi arrivons au vieux camp qui appartient maintenant à quelqu’un d’autre, nous le fixons simplement des yeux et pensons à Clarence. Il fait chaud et les grillons chantent, un son que n’interrompent que les acclamations des enfants du coin.
En faisant un zoom arrière pour regarder la vie de mon grand-père à travers des ondes de l’explosion de 1916, je vois un homme en complet derrière un bureau à la Banque du Canada; un garçon espiègle portant un sac plein de poissons; un amateur de plein air qui verse du sirop d’érable dans une bouteille de rye. Je vois un soldat étendu dans le noir, l’ombre d’un homme à la table d’un café, en France, qui m’exhorte à regarder au-delà du moment qui a bouleversé sa vie. Et je vois papa qui, comme moi et comme d’autres membres de notre famille, a été touché par ces ondes et a été pénétré d’un sentiment de gratitude.

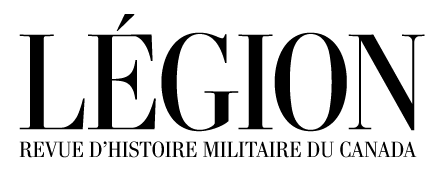
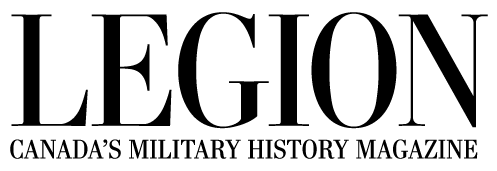







Comments are closed.