![Chef d’état-major de la défense Tom Lawson [PHOTO : DAN WARD]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/07/CDS1.jpg)
Le nouveau chef d’état-major de la défense, le général Tom Lawson, est quelque peu énigmatique.
C’est un pilote de chasse qui a appris à cacher la fanfaronnade habituelle du pilote de chasse. C’est un officier qui a accédé au plus haut grade militaire sans être allé en Afghanistan. C’est un homme venu d’on ne sait où, dirait-on : il était lieutenant-colonel quand la guerre d’Afghanistan a commencé et il est maintenant aux commandes des Forces armées canadiennes.
Lawson, dans son bureau au quartier général de la Défense nationale, au centre-ville d’Ottawa, est un homme calme, dans la cinquantaine, qui nous semble sympathique. Avec son attitude réservée qui rappelle celle d’un avocat, il rompt avec la tradition récente des chefs canadiens, n’affichant ni l’air du guerrier fonceur de son prédécesseur, Walter Natynczyk, ni la ténacité particulière du plus célèbre des généraux canadiens, Rick Hillier.
Alors qu’en penser? Comment expliquer sa montée au sommet de l’armée canadienne?
La redoutable épreuve de Lawson, ces derniers temps, est celle où il a été choisi comme porte-parole pour la mission concernant les bombardements en Libye ayant pour objet d’enlever le pouvoir à Moammar Gadhafi. Auparavant, il pilotait des CF-18 en Allemagne, enseignait le génie électrique au Collège militaire royal à Kingston et avait été commandant adjoint de Norad, au Colorado.
Quand on parle avec lui, on se rend vite compte des domaines d’expertise de Lawson. Par exemple, quand on lui pose une question sur les effets qu’a eus la mission en Afghanistan sur l’armée canadienne, il répond : « Quand on est en danger, voyez-vous, on se concentre vraiment sur ce qu’on fait. Dans l’aviation, on dirait que l’aviation est toujours en danger parce qu’elle se bat avec les éléments, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu plus d’aviateurs à cause des intempéries […] qu’à cause du feu de l’ennemi. Alors, dans l’aviation, on dirait qu’on prend toutes les missions au sérieux parce que les risques y sont toujours aussi graves. Ce n’est pas le cas dans l’armée de terre qui a été dégrossie de manière à devenir performante au combat. L’armée et l’aviation ont si bien combattu ensemble, en Afghanistan, qu’on va tirer parti de cette expérience […] pendant des dizaines d’années, et à côté de l’Afghanistan, en Libye, la marine et l’aviation aussi ont collaboré très étroitement. Alors je pense que les dix dernières années de combat ont servi à développer notre doctrine, à l’échelle du pays et à l’échelle du monde avec nos alliés.
Cette réponse en révèle beaucoup sur Lawson et la façon dont il a eu son poste. Les dirigeants politiques canadiens s’opposent de plus en plus à tout ce qui concerne l’Afghanistan, et le choix de Lawson en tant que chef arrive à un moment où il semble qu’une grande partie des hauts gradés sont choisis pour leur distanciation à l’égard de ce conflit. Bien que Lawson nie explicitement qu’il y ait eu quelque épuration parmi les dirigeants militaires ternis par l’Afghanistan, à propos de la pression à cet égard, il assume.
« Je pense qu’on peut me montrer du doigt et dire que bien que je sois allé en Afghanistan plusieurs fois, dit-il, je suis celui qui n’y est pas allé, mais je suis entouré de ceux qui y ont été, jusqu’à tout en bas de la liste. De nombreux sous-officiers et guides de troupe se sont bien imprégnés de la doctrine que nous avons acquise en Afghanistan.»
Là-dessus, Lawson est un peu cachotier sur le sujet du legs canadien en Afghanistan, argumentant qu’il va falloir des « décennies » pour savoir si la mission a réussi ou pas.
« Quoi qu’on pense de la mission en tant que soldat canadien, en tant que civil canadien, il y a de l’espoir dans ce pays où il n’y en avait que très peu quand tout ça a commencé, il y a plus de 10 ans. On voit que les chiffres à la force de sécurité nationale afghane s’élèvent à ce qu’on visait au milieu des années 2000, on voit qu’il y a des Afghans à la tête de 80 p. 100 des missions, on voit que des Afghans s’occupent de 80 p. 100 de leur formation à ce moment-ci, on voit un gouvernement qui a été conseillé sur des processus fondés sur l’expérience occidentale, et on voit des femmes et des enfants dans les écoles qui n’avaient jamais vu une école auparavant. C’est encore un peu fragile, tout ça, et je pense qu’en soi, ce sont les résultats d’efforts énormes, d’efforts des Alliés. »
Bien entendu, malgré qu’elle soit en train de s’effacer de l’esprit du public, la guerre en Afghanistan est encore très importante dans les cercles militaires. Aux États-Unis, ces temps-ci, ce n’est pas très facile d’être général. Au cours des derniers dix ans, les divers conflits du monde musulman ont couvé, éclaté, persisté; le commandement a été sous une surveillance étroite et on sent une imputabilité nouvellement accrue.
Dans un article publié dans Armed Forces Journal qui a été souvent cité, le lieutenant-colonel américain Paul Yingling disait des généraux à la guerre : « Pour l’emporter, les généraux doivent fournir aux décideurs et au public une évaluation exacte de probabilités stratégiques […]. Si le décideur désire des fins pour lesquelles les moyens qu’il fournit ne suffisent pas, le général est chargé d’aviser l’homme d’État de cette incohérence. L’homme d’État doit alors revoir les objectifs politiques à la baisse ou mobiliser le peuple pour fournir davantage de moyens. Si le général garde le silence alors que l’homme d’État déclenche une guerre avec insuffisamment de moyens, il est en partie coupable des résultats. »
Le problème principal, comme Lawson le sait parfaitement bien, c’est que les généraux sont sous les ordres de civils, mais qu’ils ne peuvent pas exaucer leurs désirs de façon inconditionnelle. Que ce soit à la guerre ou à la paix, le dirigeant militaire doit avoir la volonté de conseiller le dirigeant civil si (ou quand) ses ordres sont inexécutables.
« Je pense qu’un bon commandement, c’est un bon équilibre, des décisions pertinentes malgré un stress considérable, dit Lawson. « C’est surtout composé de [divers] ensembles de loyautés et de défis. Et la plus importante […] c’est la loyauté dirigée vers le haut. Tout le monde a un patron : le mien, c’est le gouvernement du Canada, par l’entremise du ministre et du premier ministre. […] Les pays occidentaux veulent tous que leur armée soit bien dirigée et qu’elle réalise les désirs du gouvernement. C’est une partie : on comprend tous notre patron. En direction inverse, la partie vraiment facile pour les dirigeants militaires, c’est la loyauté envers les gens dont on s’occupe. Il faut veiller à ce qu’ils comprennent la mission qu’ils s’apprêtent à accomplir, qu’ils aient été entrainés convenablement pour pouvoir la mener à bien, qu’ils soient bien appuyés pendant la mission, et qu’on s’occupe bien d’eux à leur retour.
Quant au Canada, qui est relativement en paix, un bon commandement, c’est s’employer à deux problèmes extrêmement difficiles, tous deux relatifs à la guerre du Canada en Afghanistan : les blessures de stress opérationnel, et les importantes compressions budgétaires.
Pour ce qui est des blessures de stress, Lawson est franc : « Je ne pense pas que je puisse dire catégoriquement que nous faisons assez, mais nous avons été saisis du problème depuis assez longtemps que nous avons beaucoup fait pour en reconnaitre le commencement, la probabilité d’un commencement de blessure, pour réduire le stigmate. Et nous reconnaissons aussi que les militaires ne sont pas tout seuls par rapport à ça : les familles souffrent à leurs côtés. Est-ce qu’on en fait suffisamment? Je ne sais pas. »
Lawson poursuit en faisant remarquer que le nombre de cas de blessure de stress ne peut qu’augmenter au cours des années à venir, à mesure que s’accroit le nombre d’anciens combattants qui commencent à en ressentir les effets. Cependant, « on ne renvoie personne pour cause de blessure de stress opérationnel », dit-il.
Bien que la lettre de cette déclaration soit vraie, l’esprit n’en est pas exactement correct. Beaucoup de militaires sont libérés suite à des problèmes de comportement ou d’abus d’alcool, lesquels sont souvent reliés aux blessures de stress.
Par ailleurs, l’importante réduction du financement à l’armée est aussi un problème urgent. D’après Lawson, lors de la cérémonie de passation de commandement, le premier ministre Stephen Harper lui a dit qu’il lui faudrait augmenter l’efficience tout en conservant le nombre de militaires et sans qu’ils perdent de leur préparation au combat, où que ce dernier ait lieu.
« Les réductions dont on fait l’objet vont nous obliger à faire les choses autrement, dit Lawson. Il y a un équilibre par rapport à tout ce qu’on fait, quatre piliers qui servent à tout soutenir; ce sont le personnel, on nous a dit de ne pas en réduire le nombre; l’équipement, on doit maintenir toutes nos capacités; l’infrastructure, on en a beaucoup, alors il va falloir qu’on taille là-dedans; et puis la préparation. »
« La préparation, c’est très intéressant : il faut se tenir prêt à protéger les intérêts des Canadiens, surtout ici au Canada, au continent, et puis outre-mer. Comment maintient-on ça? Le premier ministre mentionne le rapport intendance/combattant. Comment privilégier ça tout en maintenant l’équilibre des piliers? »
On ne trouvera pas de solutions simples. En fin de compte, Lawson lui-même est, disons, prudent. C’est au sujet de l’acquisition problématique des nouveaux réacteurs pour l’aviation qu’arrive le moment le plus drôle de l’entrevue. Étant donné que le F-35 proposé a non seulement crevé son budget, mais qu’il éprouve des difficultés techniques et de rendement, même les partisans les plus fervents de l’achat des réacteurs prennent garde à leur position.
Question : « Pouvez-vous estimer votre confiance concernant le programme des F-35 sur une échelle de 0 à 100? »
Réponse : « Non. »
Quel que soit le chasseur à réaction qu’on finisse par acheter, on dirait que l’armée canadienne est entre les mains d’un intendant prudent. Il est certainement peu probable que Lawson prenne des positions fermes en public comme le faisait son prédécesseur, Hillier. Nous saurons, avec le temps, si c’est une bonne ou une mauvaise chose.

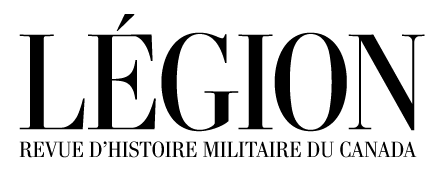
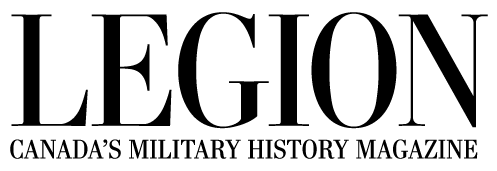







Comments are closed.