![[ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN] [ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/05/PTSDLead.jpg)
La crise qui frappe nos anciens combattants blessés
Andrew se cache dans son blouson. Renfrogné, il se tient le ventre : il est évidemment angoissé. Il a la tête baissée et son visage est caché par une casquette de baseball à grande visière. Un des premiers arrivés, il a pris une chaise dans le coin, de l’autre côté de la porte : l’endroit le plus sûr de la pièce. C’est une petite salle, et à ce moment-là, on y couve la colère.
Neuf hommes – soldats, marins, aviateurs, anciens combattants –, sont venus à cette rencontre à Halifax pour parler de la vie quand on a le TSPT : le trouble de stress post-traumatique. Ils l’ont tous, et ils ont l’intention d’en discuter, mais ils n’arrivent pas encore à puiser dans les émotions nécessaires pour ce faire. Certains des plus fâchés ont monopolisé la conversation et on ne peut les empêcher de se répandre en récriminations contre le système. C’est ainsi que, dans une pièce remplie d’étrangers, ils préviennent la réouverture de leurs blessures.
Seuls quelques-uns se connaissent, s’étant déjà croisés pendant leur carrière militaire ou en thérapie. Ils connaissent tous M. John Whelan, le psychologue et chercheur en TSPT qui a réservé la pièce où ils sont réunis. Électronicien naval dans les années 1970 et 1980, il a acquis par la suite une formation en psychologie. Œuvrant anciennement pour les Forces canadiennes (FC) à titre de directeur pour l’Atlantique des services cliniques des dépendances, il a, en 2004, ouvert un cabinet privé spécialisé en traitement des gens ayant le TSPT. Les membres présents lui accordent une certaine crédibilité; c’est pour cela qu’ils ont accepté de raconter leurs histoires devant une journaliste et de l’aider à compléter une gamme d’entrevues que lui ont accordées des anciens combattants de tous les coins du pays.
![[ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN] [ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/05/PTSD1-french3.jpg)
Trois de ces hommes seulement ne demandent pas l’anonymat. Le premier est l’ancien adjudant-chef d’escadre Jean-Guy Trudel, dont la voix douce et l’attitude calme démentissent son apparence de dur. Le deuxième, assis à côté de lui, est l’adjudant-maitre à la retraite Steve Dornan, ancien opérateur de capteurs électroniques aéroportés et analyste du renseignement. Dornan est un contrepoint calmant du troisième : l’ancien parachutiste Bill Maguire qui pique une colère au moindre prétexte. Les anciens combattants qui se trouvent dans cette salle sont de tous les âges, entre la trentaine et le milieu de la soixantaine, et ils représentent les trois services. Certains d’entre eux ont même servi dans les trois. Maguire, dont la carrière s’est étendue sur 37 ans et deux services, est le plus vieux. Il a été affecté à Chypre, au Moyen-Orient et en Somalie, et il a dû exécuter des fonctions merdeuses au pays aussi. Il n’a guère de patience pour la rectitude politique, et il dit ce qu’il pense sans se préoccuper de la sensibilité de ses interlocuteurs. Parmi les causeurs anonymes, il y a un sous-marinier qui a servi à bord du NCSM Chicoutimi en 2004, lorsqu’il y eut un incendie; un ancien officier du renseignement; un vétéran de l’armée qui se bat actuellement pour l’obtention d’avantages; et quelques anciens combattants qui ne veulent pas dévoiler leur profession ni leur service de peur qu’on ne les identifie. Certains d’entre eux n’ont même pas raconté leurs expériences à leur famille.
![[ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN] [ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/05/PTSD2-french.jpg)
Le groupe plonge dans la colère, les voix s’élèvent et les blasphèmes se multiplient, mais Andrew n’a toujours pas dit un mot. À un moment donné, quelqu’un dit qu’il doit absolument aller fumer, et on fait une pause. La tension émotive se retire de la pièce comme l’air s’échappe d’un ballon crevé. Andrew est le premier dehors, et tout le monde pense qu’on ne le reverra plus. Il est pourtant le premier à rentrer, la peur remplacée par quelque chose qui ressemble à de la détermination. À moins que ce ne soit le désespoir.
« Je pensais que c’était normal d’être en colère tout le temps, de passer toute la vie à l’intérioriser au point où j’exploserais, dit Andrew. J’aurais donné ma vie pour mon pays, ajoute-t-il, et j’aurais préféré ça à ce qui m’arrive. »
Il a le TSPT depuis la moitié de sa vie, depuis sa première affectation en Bosnie, en 1993, alors qu’il n’avait que 19 ans. Un de ses copains et lui furent blessés par ce qu’on appelait alors un piège et qu’on appelle aujourd’hui un engin explosif improvisé (EEI). L’autre soldat fut grièvement blessé par des éclats, aéroporté à l’hôpital, puis ramené au Canada. Andrew avait été protégé par un édifice; protégé des éclats, mais pas de l’onde de choc, et il perdit connaissance. À son réveil, il avait un gros mal de tête, un tintement aux oreilles, une vue embrouillée. On voulait le ramener au pays, lui aussi. « Mais j’avais 19 ans : j’ai tout fait pour rester là-bas », dit-il. Après quelques jours, sa vue s’est éclaircie et le mal de tête a disparu. Et puis les cauchemars ont commencé. On ne savait pas très bien à cette époque quels dommages les ondes de choc pouvaient causer. Les cauchemars s’accumulaient, et ils s’aggravaient au fil du temps. Andrew a servi dans la poche de Medak pendant la période la plus sanglante de la guerre civile en Bosnie. Bien qu’ils fussent armés, les Canadiens envoyés à cette mission des Nations Unies ne pouvaient pas intervenir au massacre qu’ils savaient avoir lieu. Les forces serbes et croates acceptèrent de cesser le feu, et les soldats français et canadiens reçurent la consigne de surveiller le retrait des forces opposées. Bien qu’on entendait des coups de feu et des explosions dans les villages avoisinants, les forces croates refusaient l’accès à la région aux Canadiens et ils tiraient sur les véhicules de l’ONU.
C’est pendant cette mission qu’a commencée la lente descente d’Andrew, et la brillante carrière dont il avait rêvé se dissipait. Les autres hommes du groupe grommèlent pour signifier leur appui pendant qu’il décrit la manière dont sa vie s’est effondrée, comment ses symptômes se sont aggravés et son rendement a diminué pendant le reste de ses six affectations à l’étranger. Il s’efforce de retenir ses larmes en parlant des jours où on croyait que c’était simplement un cabot qui avait un problème d’alcool. Il se sentait seul et trahi. « Le pire, dans tout ça, c’est que tous les gens avec qui je travaillais me connaissaient et qu’ils savaient que j’étais travaillant. Tout s’effondre tout à coup, et il n’y en a pas un seul d’entre eux qui se soit levé pour dire : “Eh! Qu’est-ce qui se passe?” J’aurais couru à la rescousse de n’importe lequel d’entre eux dans un tel moment. » Ça lui a fait mal que personne ne soit venu à la sienne.
![[ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN] [ILLUSTRATION : DAVID JUNKIN]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2013/05/PTSD3-french.jpg)
Il raconte le combat qu’il a mené pour qu’on le diagnostique et son expérience avec le psychiatre civil qui pensait qu’il mentait quand il décrivait ses expériences. « Comment aurait-il pu savoir? Il était allé à l’école des psys. Son fils de 19 ans allait à l’université et courait les filles ». Les batailles auxquelles Andrew a pris part étaient dures, le TSPT était difficile, mais c’est la bataille pour obtenir de l’aide qui a failli être mortelle pour lui. Il raconte la nuit où il a résisté avec acharnement contre la tentation de se suicider. Après un court silence, quelqu’un demande à la ronde qui connait quelqu’un qui se soit suicidé. Ils lèvent tous la main. Qui parmi eux a pensé à se suicider? La plupart lèvent la main.
Andrew a tracé la voie et, un par un, les autres parlent de l’isolement, de la peine, de se sentir trahi. Ils décrivent les symptômes qui ont réduit leur vie en cendres. Ils parlent des symptômes de leur enfer : la perte de sommeil, les cauchemars qui semblent réels à en faire peur, le tempérament qui devient coléreux. Et les traitements qui, bien qu’étant un supplice, ont fini par les mener un peu au calme. À la fin de la rencontre, tout le monde est physiquement et émotivement épuisé. Ils étaient peut-être des étrangers les uns pour les autres au début, mais en racontant leurs histoires, ils ont appris qu’ils sont sur la même voie. Ils sont tous entrés dans un monde des plus étranges, et ils ont eu de la difficulté à rebrousser chemin.
De nombreuses personnes des milieux militaires dans ce pays se sont trouvées dans ce monde, et leur vie a été formée par le paysage intérieur autant que par l’endroit où elles vivent. Un ancien combattant, à Calgary, affirme que peu importe où il se trouve ou ce qu’il fait, il passe une partie de chaque journée en Afghanistan. Ce n’est pas seulement que leur expérience les ait changés : certains disent qu’ils ont l’impression d’avoir perdu une partie d’eux-mêmes. Le public est habitué à voir des amputés militaires qui ont des jambes ou des bras artificiels, mais peut-on fabriquer une prothèse pour remplacer une partie du moi?
Les valeurs qui poussent les soldats à aider les blessés pendant les combats sont les mêmes que celles qui poussent les anciens combattants victimes du TSPT à raconter leurs histoires. Ils veulent encourager les autres à aller chercher de l’aide, à comprendre qu’ils ne sont pas tout seuls et que les choses peuvent s’arranger. Ils veulent d’autres services et des meilleurs, pour les militaires, les anciens combattants et leur famille. Ils veulent que les conditions changent afin de prévenir le TSPT dans un plus grand nombre de cas, et ils veulent une amélioration des traitements et un soutien accru. « Je suis quelqu’un de très réservé, dit Andrew. Mais je ne veux pas que d’autres subissent ce que j’ai subi. Rien que d’y penser, je trouve ça insupportable. [Mon histoire] pourrait servir à aider quelqu’un d’autre. »
Au cours des cinq prochaines années, environ 30 000 militaires prendront leur retraite. On s’attend à ce qu’un tiers d’entre eux aient des problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété, des dépendances et des troubles de sommeil. Presque 3 000 auront un TSPT grave. Personne ne sait combien de vétérans des anciens conflits ont un TSPT. Quand la prochaine Bosnie, les prochains Afghanistan, Chypre ou Rwanda arriveront, il y aura une nouvelle génération de victimes du TSPT, et les anciens combattants qui ont raconté leurs histoires veulent que l’aide leur soit encore disponible.
Les premiers comptes rendus de guerre recelaient des descriptions du TSPT, bien qu’il ait changé de nom bien des fois au cours des siècles : le regard hanté, l’épuisement au combat, la névrose traumatique, le stress de combat. Des dizaines de milliers de vétérans des deux guerres mondiales étaient atteints de TSPT, mais peu après ces deux conflits, les politiciens, l’armée et le public se sont tournés vers d’autres priorités. Les recherches sur les causes et les traitements du TSPT s’arrêtèrent peu après. Les anciens combattants d’aujourd’hui ont peur qu’on s’intéresse moins au TSPT quand on commencera à oublier leurs batailles. Ils s’inquiètent de la réduction du financement : que les recherches s’estompent.
Il y a de quoi s’inquiéter. Le système est en train de montrer ses limites. Le rapport de 2011 des Services de santé des FC intitulé Étude sur l’incidence cumulative du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’autres troubles mentaux nous prévient que les pénuries constantes de personnel et le financement vulnérable compromettent les services de santé mentale. Des nouvelles ont couru qu’il risquait d’y avoir des fermetures, même de l’unité des spécialistes de la prévention des suicides, et une réduction du personnel dans la section concernée par les recherches sur les problèmes de TSPT, de dépression et de suicide.
« Le fardeau associé aux TSO [traumatismes liés au stress opérationnel] est encore très lourd et il le demeurera pendant plusieurs années », dit l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes, Pierre Daigle, dans Ténacité dans l’adversité, son évaluation du système de soins en santé mentale des FC. Bien que les politiques et programmes créés entre 2002 et 2008 aient réduit le stigmate et amélioré le dépistage et le traitement, les FC ont de la difficulté à satisfaire aux besoins. Il y a un manque chronique de professionnels de la santé mentale, dit Daigle. En 2005, 98 millions de dollars ont été affectés au cours de cinq ans pour augmenter de 229 à 447 le nombre de dispensateurs de soins en santé mentale. Malheureusement, il y a un manque à l’échelle du pays de travailleurs dans le domaine. On en comptait 378, militaires et civils, dans les FC en septembre.
Et en septembre aussi, le ministre de la Défense nationale, Peter MacKay, a augmenté de 11,4 millions de dollars le budget affecté aux soins en santé mentale des FC, ce qui fait à peu près 50 millions de dollars par année. Les nouveaux fonds doivent servir à recruter des professionnels de la santé mentale. Dans un discours prononcé en novembre au Forum de recherche sur la santé des militaires et des vétérans canadiens à Kingston, en Ontario, il a parlé de l’importance des partenariats entre les ministères, les chercheurs universitaires et les alliés dont les soldats ont des problèmes semblables. Mais la situation économique a touché tous ces partenaires aussi : les budgets se font réduire partout. « Il ne s’agit pas seulement de coupures concernant les chars d’assaut et les cuirassés : il y a la recherche médicale, les soins de santé et les soins d’invalidité », dit le psychologue Bret Moore, coauteur de Treating PTSD in Military Personnel (Le traitement du TSPT chez les militaires). Vétéran et ancien psychologue de la U.S. Army, il a bien vu comment la réduction du financement affecte la recherche.
« Nous ne comprenons la maladie […] que de manière imparfaite », disait-on dans un rapport de 2011 de la Bibliothèque du Parlement sur le TSPT, « et rien n’est certain, sauf que ceux qui en sont affectés sont en détresse ». Les malades du TSPT ont dû composer avec cette détresse tout seuls pendant une grande partie de l’histoire militaire canadienne.
Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale Stewart MacDonald s’est battu tout seul avec le TSPT pendant plus de soixante ans. Cet homme du Cape Breton avait à peine 18 ans quand il est parti en guerre. C’est ce que faisaient les ados en 1944, ou ce qu’ils voulaient faire. Patriotisme et devoir exceptés, c’était une occasion qu’ils avaient de prouver quelque chose, de prendre part à quelque chose de plus grand que soi, et une occasion d’aventure, ce qui était rare dans la vie d’un jeune d’une petite ville des Maritimes. Il a passé deux années en Europe où l’armée canadienne a libéré la Hollande et pénétré jusqu’en Allemagne.
La mort était toujours proche, comme elle l’était de la plupart des soldats au combat. Le feu d’une mitrailleuse avait traversé de part en part le sac à dos qu’il portait contre l’épine dorsale. Un soldat avait marché sur une mine près de lui et un obus avait pulvérisé des hommes dans la pièce voisine de celle où il s’était mis à l’abri. On lui donna la tâche de fouiller les sous-sols pour débusquer l’ennemi. Il n’en a pas trouvé, mais il y avait des cadavres de femmes et ceux des enfants qu’elles avaient essayé de protéger de leurs bras. Il a vu d’autres mères et d’autres enfants morts le long des routes, dans les champs. Il a vu des Allemands de son âge frappés par balle alors qu’ils essayaient de se rendre. Tout ça avant son 20e anniversaire.
Il est revenu au Canada et à la paix, mais la guerre ne l’a jamais vraiment abandonné. « J’ai eu des cauchemars pendant de nombreuses années, dit-il. Ils étaient horribles. Des bombardements. Des coups de feu. Mes draps étaient tout mouillés quand je me réveillais. […] Ça a continué après que je me suis marié. Ma femme, elle a dû beaucoup supporter. » Il n’avait jamais bu une goutte d’alcool avant la fin de la guerre, mais il s’est mis à prendre un coup quand il est retourné chez lui. « Je ne veux pas parler de ce temps-là. C’étaient les pires, vraiment les pires jours de ma vie. » Il ne savait pas où trouver de l’aide, alors comme des milliers d’autres, il allait aux tavernes et aux salles de la Légion royale canadienne où il racontait ses histoires et demandait aux copains ce qu’ils faisaient à propos de leurs cauchemars. On lui conseilla de mettre une bible sous son oreiller.
Un ancien combattant terre-neuvien dit qu’il accepte de raconter son histoire parce qu’il veut que quelqu’un dise ce qu’il en est vraiment du TSPT. Mais il semble qu’il n’y a pas qu’une seule vérité, et parler ne sera pas facile. Le TSPT peut être causé par diverses sortes de traumatismes, mais ce n’est pas tout le monde chez qui il se développe après en avoir subi un. Il se peut que des années passent avant que n’apparaissent les premiers symptômes. Deux personnes à qui le même évènement a causé un TSPT peuvent avoir des symptômes différents. Il n’y a pas de traitement unique, pas de médicament unique, pas de combinaison de médicaments et de traitement qui fonctionne pour tout le monde, alors il peut se passer beaucoup de temps avant qu’on trouve une thérapie qui soit relativement efficace. Même après les traitements, il y a une minorité de personnes chez qui les symptômes persistent et les empêchent de reprendre une vie normale. Il n’y a pas de guérison et peut-être qu’il ne peut pas y en avoir. « Le TSPT n’est pas une maladie », dit John Whelan. Existe-t-il une inoculation qui protège le soldat des blessures? un baume qui efface les cicatrices de balle? une médecine qui restitue les membres? Comme les blessures corporelles, le TSPT laisse des cicatrices, mais elles ne sont pas visibles.
Jusqu’à récemment, le TSPT était souvent rejeté comme étant une faiblesse du caractère, même de la couardise. L’idée a finalement été démentie en 1980, quand le TSPT a été ajouté au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, sa cause inscrite comme étant un évènement traumatique suivi par des manifestations émotives graves comme la panique, la terreur, le chagrin ou la répugnance. Il a fallu beaucoup de temps pour que l’armée accepte le TSPT comme étant une blessure et instaure des services pour le soigner. Maintenant, les Forces canadiennes reconnaissent quatre causes de traumatismes liés au stress opérationnel, dont le TPST est le plus grave. Il n’est pas rare que quelqu’un en ait de plusieurs sortes, même des quatre.
Les évènements qui provoquent la terreur, l’horreur ou le désespoir. L’adjudant-maitre à la retraite Steve Dornan ne fait que donner des indices sur les horreurs de son affectation en Bosnie, où il devait chercher des fosses communes pleines de victimes des massacres. « C’était facile à voir, dit-il, parce qu’il y avait des restes humains qui ressortaient du sol. » L’adjudant-chef à la retraite Jean-Guy Trudel croit que l’accumulation lente du stress pendant sa carrière de 37 ans, les déménagements incessants, les responsabilités augmentant sans cesse, la vue de trop de choses troublantes pendant ses périodes de service, ont entrainé chez lui le TSPT. Pendant une affectation à la fin des années 1990, il a appris qu’un de ses amis avait tué son épouse à la hache et s’était pendu. « Je l’ai compartimen-té : je l’ai mis de côté, dit-il. Rétrospectivement, je comprends que je n’avais pas guéri comme il faut. » La première nuit après son retour d’une période de service, il a eu un cauchemar terrifiant où il tuait sa propre épouse. « J’ai mis toutes mes haches dans le coffre de ma voiture, je suis allé à la base et je les ai mises dans une benne à ordure. J’avais peur à ce point-là, mon cauchemar était pénétrant à ce point-là. » En Bosnie, il a vu les murs d’une école qui avaient été criblés de balles à une hauteur de 50 cm. « C’est là qu’ils tuaient les gamins, juste les petits gars. » À Haïti, il a vu des enfants fouiner dans des piles d’ordures de la hauteur d’un étage à la recherche de choses à vendre pour se nourrir. « Ça a été le comble. » Il s’est vraiment mis à chercher des soins, et il a pris sa retraite plus vite que prévu.
Le stress accumulé au fil du temps. Le sergent Ted Peacock n’avait pas retrouvé son souffle en revenant d’Afghanistan en 2005, où son unité avait régulièrement été victime d’attaques, qu’on lui a demandé d’y retourner. « J’ai dit : “ça fait six ans maintenant, et j’arrête pas de carburer, alors à mon retour, j’aimerais faire une pause. Et on m’a dit : “ouais, tout le monde a besoin d’une pause”. » Cet Albertain dut accomplir des fonctions encore plus accaparantes après que son adjudant eut été blessé par un EEI. Quand il est rentré chez lui, à la place du répit qu’il demandait, on l’a soumis à une nouvelle affectation. « Le vendredi, on m’a dit que j’allais être adjudant des opérations d’un escadron de campagne. Le lundi, j’ai dit que j’avais besoin d’aide et on m’a répondu : “OK, voici quelques pilules pour dormir.” Alors je suis rentré chez moi, je me suis saoulé et je me suis effondré. J’ai détruit mon garage. Un jour j’étais tellement émotif que j’en pleurais, je criais, et puis… plus rien. »
Le chagrin. « Tout le monde commence avec une certaine quantité [de résilience] en banque, et il y en a qui en ont plus que les autres », dit Philip, un major des Prairies qui a servi pendant un certain temps en Afghanistan il y a une demi-douzaine d’années. Son unité devait, entre autres, récupérer l’équipement et faire le nettoyage après l’explosion d’un EEI, de coups de feu, d’un accident de la circulation. Il se rappelle qu’une fois, il est entré dans un véhicule d’assaut léger qui avait été touché par un EEI. « Il y avait un gros trou où le siège du chauffeur aurait dû être. J’ai regardé en haut et dit : “Ah. Bien sûr. La cervelle.” » Un jour, la communication informatique a été interrompue brusquement. Quelques années auparavant, il y avait eu une fuite vers le Canada, par courriel, concernant la nouvelle d’un décès et le public avait été mis au courant avant la famille. Depuis, le silence des ordinateurs était un présage de mort. Son unité s’est rassemblée, en attendant l’annonce du nom, et lorsqu’elle est arrivée, c’était non seulement quelqu’un qu’ils connaissaient tous, mais un jeune caporal que Philip trouvait sympathique et qu’il respectait. Quelqu’un devait aller récupérer son équipement. Lisant la stupéfaction sur le visage de ses hommes, Philip leur dit : « Je vais y aller. » L’équipement avait été mis dans un sac en plastique jaune fermé, par une chaleur de 41 degrés. Quand il l’a ouvert, il a été enveloppé par la puanteur de la mort, laquelle s’est gravée dans son esprit et a marqué son âme au fer rouge. Le chagrin vida son compte de résilience. Il est encore en thérapie.
La blessure morale. Elle peut être évidente, comme chez les Casques bleus en Bosnie qu’on empêchait d’intervenir dans un massacre. L’ancien combattant bourru Bill Maguire a été grandement ébranlé par la crise d’octobre, quand le premier ministre Pierre Trudeau fit appel à l’armée en invoquant la Loi sur les mesures de guerre. On demandait alors aux soldats de prendre les armes contre leurs concitoyens. Ou ce peut être plus subtil. « Je me suis toujours vu comme un soldat dur de dur […] mission, mission, mission », dit le lieutenant-colonel Chris Linford, ancien commandant de la clinique du Pacifique des Services de santé des FC et second de l’hôpital militaire à Kandahar, qui habite maintenant à Victoria. Mais une fois, en regardant le cadavre d’un soldat canadien, il s’est aperçu qu’il avait changé. « Je me suis mis à vraiment douter de la mission. Je me suis mis à me demander […] quel est ce prix que nous semblons accepter de payer? »
Le TSPT n’est pas un prix que paient tous les soldats qui sont de service ou qui vont au combat. Le risque augmente en même temps que le contact avec les traumatismes, le nombre d’affectations et l’expérience des combats, mais la plupart des militaires ne développent pas de TSPT malgré leur expérience des traumatismes ou du stress, leurs affectations ou leurs combats. Dans l’armée, grâce aux recherches qui s’accumulent, on commence à comprendre combien de membres du personnel envoyé en Afghanistan ont été affectés. L’étude d’un échantillon de dossiers médicaux du personnel déployé entre 2001 et 2008, prélevé au hasard, a démontré que 8 p. 100 étaient ceux de militaires chez qui on avait diagnostiqué un TSPT relatif à une mission et 5,2 p. 100 d’un autre trouble mental comme la dépression. En observant de près les soldats déployés à partir de Gagetown en 2007, on a remarqué que le risque de TSPT augmente selon les envois au combat : presque 20 p. 100 d’entre eux ont développé un TSPT, et la carrière de ceux à qui on l’avait dia-gnostiqué avait été interrompue prématurément.
Le coût peut donc être élevé pour ceux qui ont un TSPT. Leur vie va à la dérive lorsque s’aggravent leurs symptômes. L’insomnie, les cauchemars et les flashbacks sont communs, et beaucoup se mettent à boire. « Il était évident que si je buvais assez, je ne rêverais pas », dit un vétéran d’Afghanistan qui habite la côte ouest. « Je comprends très bien que beaucoup de gars prennent cette tangente. » Pour certains, les beuveries se transforment en dépendances : une obstruction de plus sur la voie de la guérison.
L’isolement est commun aussi. Il y en a qui évitent simplement les gens, les endroits et les activités qui leur rappellent le traumatisme, d’autres qui sont isolés par des émotions comme la dépression, la culpabilité ou le souci. Certains sont constamment en alerte, se sentent toujours déprimés, au bord de la colère ou des larmes. Ce tourbillon de symptômes peut leur couter leur emploi, leurs amitiés, leur mariage, ou faire du tort à leurs relations avec leurs enfants. Il y en a qui, leurs symptômes persistant, ne travaillent plus jamais.
Steve Dornan avait des sautes d’humeur après son affectation en Bosnie, en 1995. « Il n’y avait pas moyen de décomprimer, même pas de pape-rasse à faire, dit-il. Je suis littéralement descendu de l’avion, je suis rentré (chez moi) et j’ai enlevé mon uniforme. On est heureux d’être chez soi : c’est fini. C’est terminé. » Mais tout n’était pas comme avant. « Une fois, quand ma fille est venue me dire qu’elle était affamée, je me suis mis à crier après elle. J’avais vu des gamins qui n’avaient pas de nourriture, qui avaient perdu des jambes ou des bras, qui avaient pilé sur des mines, qui étaient morts dans mes bras; et elle, qui était en santé et en sécurité, se plaignait. »
Il y eut d’autres excès de colère extrêmes. « Mon épouse m’a dit qu’il fallait que je fasse quelque chose, qu’elle ne pouvait pas me permettre d’être comme ça avec notre famille. » Il est donc allé voir son patron. « Je lui ai dit que ça allait mal à la maison. Et il m’a dit qu’il n’y avait pas grand-chose qu’on pouvait faire à ce sujet. Quelques semaines après, j’étais à mon affectation suivante, dit Dornan. Dans les années 1990, c’est comme ça qu’on faisait. » Il avait des flashbacks et s’irritait facilement, mais il n’en parlait pas. « J’enfermais presque tout ça dans une petite boite dans ma tête. On n’en parle pas, c’est pas quelque chose à échanger, c’est pas quelque chose que les gens peuvent comprendre. » On lui a finalement diagnostiqué un TSPT en 2010, quand Anciens Combattants Canada (ACC) a entrepris de lui prodiguer des soins. Il avait été libéré des FC pour raison médicale, mais une autre raison médicale.
Un TSPT a été diagnostiqué à Bill Maguire après son départ de l’armée au bout d’une carrière de 37 ans, pendant laquelle il avait réussi à s’isoler à cause d’une personnalité acariâtre et en travaillant autant qu’il le pouvait. « J’étais un bourreau de travail, dit-il. Je rageais. J’étais en colère après tout le monde, j’étais toujours prêt à me battre, j’avais pas de respect de l’autorité. Je faisais pas confiance à mes supé-rieurs; je pense que c’est une des choses importantes, la confiance, et je me plaisais à piquer des colères. »
Les choses n’allaient pas mieux chez lui. « J’avais des cauchemars horribles. » Il s’agitait tellement pendant le sommeil que son épouse et lui durent faire chambre à part. Le son ou la vue d’un camion-benne le reportait à Chypre, où les blessés et les cadavres étaient transportés dans de gros camions. « Une fois, j’ai vu les blessés et les morts empilés les uns sur les autres. Sapristi, quel gâchis, et le sang coulait de la benne comme du liquide hydraulique. C’est un de mes cauchemars. »
Les Forces canadiennes ont inventé le terme traumatisme lié au stress opérationnel (TSO) pour nommer les problèmes de santé mentale (la dépression, l’anxiété, le TSPT) engendrés par le travail exigeant des guerriers et des Casques bleus. Le diagnostic et le traitement sont devenus bien plus accessibles au cours des dix dernières années. Le ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants Canada ont créé un réseau national de cliniques en santé mentale et de centres de soutien pour trauma et stress opérationnels. Du soutien est offert aux militaires, aux anciens combattants et à leur famille aux Unités interarmées de soutien au personnel dans les bases et les escadres au moyen du programme de soutien social aux blessés de stress opérationnel (SSBSO) et dans les Centres de ressources pour les familles des militaires. Le programme des FC En route vers la préparation mentale sert à réduire le stigmate en conscientisant le public sur les symptômes, en expliquant quelle aide est offerte, et en encourageant les gens à demander des soins. Il sert aussi à fournir une instruction sur la résilience. « Quand de mauvaises choses arrivent, les gens doivent réagir, dit Whelan. C’est normal pour l’être humain que d’être horrifié ou affligé. L’instruction sur la résilience leur donne des stratégies relativement à cette réaction; elle leur permet de savoir qu’il n’y a pas de mal à en parler. »
Ces étapes ont réduit le stigmate qu’il y avait en ce qui concerne la demande d’aide, mais elles n’ont pas effacé l’hésitation que ressentent les gens. Les militaires sont présumés durs, résilients, capables de se prendre en main tout seuls. « On ne veut pas être celui qui lève la main pour dire qu’il a un problème, dit Chris Dupee, un caporal qui a servi en Afghanistan. « Je suis de l’infanterie. Quand on a des problèmes, on boit, on va fêter avec les gars. On s’occupe de ses propres problèmes. »
Et quand on demande de l’aide alors qu’on est encore en service, on se ronge les sangs en attendant le diagnostic. « Entre la demande d’aide et le diagnostic, il y a six mois, dit Dupee. Ce qui arrive entre ces deux moments-là, c’est très, très dur. Et il n’y a pas de latitude, pas de sympathie par rapport à ce qu’on fait, parce que tant qu’il n’y a pas de diagnostic, il n’y a pas de protection. Je connais un gars qui est allé en prison pendant ce temps-là. C’est de la foutaise. »
L’attente du diagnostic est esseulante, et le traitement aussi. Et après, la vie avec le TSPT l’est également. C’est une des raisons pour lesquelles Dupee a créé le site MilitaryMinds.ca dans la Toile, où les gens peuvent échanger leurs expériences relatives au TSPT. Le site a beaucoup d’images de gens qui affichent ce message : « We Are Not Alone » [Nous ne sommes pas tout seuls]. Ensemble, ils représentent un puissant message. « Il y a beaucoup de gens qui disent qu’ils consultent [le site Web] depuis le début, et qu’ils sont finalement prêts à parler. »
Des années peuvent passer après le début des symptômes et avant que d’aucuns soient prêts à parler. Certains d’entre eux, comme le major que nous appellerons Philip, voulaient s’occuper d’abord de leurs responsabilités. D’autres, comme Bill Maguire, n’ont pas su pendant des dizaines d’années ce qui n’allait pas chez eux. Et il y en a encore d’autres qui pensent qu’ils peuvent s’en tirer tout seuls. Un jeune caporal, qui veut qu’on l’appelle John, était revenu récemment d’Afghanistan quand il a appris qu’un de ses amis avait été tué. « Je me suis mis à me rappeler tout ce qui m’est arrivé durant mon affectation », dit-il. Les patrouilles dangereuses, les morts, la tension qui use quand on doit être vigilant sans cesse. Les symptômes du TSPT ont commencé à se manifester deux ou trois jours après : les cauchemars, les flashbacks, la dépression. « J’étais réticent à demander de l’aide parce que je pensais qu’il me suffisait d’un peu de temps. » Ensuite, il s’est mis à penser au suicide, et il a tendu la main. « On m’a tout de suite assigné un travailleur social et un psychologue. » On lui procura des somnifères, des antidépresseurs et une psychothérapie. La combinaison a commencé à fonctionner au bout de six semaines.
« Il y a une obligation morale comme quoi, lorsqu’on envoie des soldats se battre, qu’on les expose au danger, et qu’ils sont blessés, on doit les soigner du mieux qu’on peut, avec les meilleurs traitements dont on dispose », dit le major Paul Sedge, psychiatre de la Direction des services de santé mentale des FC à Ottawa, lors d’un forum au mois de novembre. « Il y a maintenant un argument économique qui sous-tend l’obligation morale. » Les FC ont dépensé, en trois ans, 1,2 million de dollars pour soigner 67 soldats envoyés en mission en 2007 (presque 18 000 $ pour chacun) et chez qui on avait diagnostiqué un TSPT pendant la première année après leur retour. Chaque libération pour raison médicale n’est pas seulement une perte de talent pour les FC, mais bien une perte d’investissement en compétences et en formation : un quart de million de dollars par militaire en service. Les particuliers perdent leur carrière, certains perdent leur capacité de gagner leur vie. ACC assume la responsabilité des traitements si l’ancien combattant souffre d’un TSPT relié au service après qu’il a quitté les Forces. « Il y a eu une augmentation constante du nombre de clients qui ont un TSPT au cours des six dernières années », dit le psychologue Norman Shields, chercheur du Centre national pour traumatismes liés au stress opérationnel de l’Hôpital Sainte-Anne, près de Montréal. En septembre 2012, ACC avait à peu près 11 000 clients touchés par le TSPT qui recevaient des pensions liées à une invalidité ou des avantages sociaux, en vertu de la nouvelle Charte des anciens combattants, pour des blessures liées à leur service.
Il en va de l’intérêt de tout le monde que les traitements fonctionnent, et qu’ils fonctionnent bien. Et les recherches l’ont démontré, recherches qui, dans le cas du TSPT, sont encore à leurs balbutiements. On ne sait pas encore précisément comment [le TSPT se développe] », dit le colonel Rakesh Jetly, conseiller du médecin-chef des FC sur la santé mentale et la psychiatrie. Mais notre compréhension devient de plus en plus approfondie. » L’idée couramment admise est qu’il y a quelque chose qui cloche relativement à la communication entre les parties du cerveau qui régissent la réaction à la peur, le classement et la récupération des souvenirs, et l’apaisement.
Quand on se sent en danger, le cerveau se met en état d’alerte, évalue le danger et prépare le corps à s’en occuper. De puissantes hormones de stress sont produites pour préparer les muscles à fonctionner, et rapidement. Le cœur bat plus vite, les vaisseaux sanguins se dilatent, la tension artérielle monte, les poumons enflent. Le foie, les cellules graisseuses et les os libèrent des nutriments pour alimenter les muscles et le cerveau. De peur qu’il y ait des blessures, les vaisseaux sanguins de la peau se contractent pour limiter la perte de sang et des plaquettes sont produites pour hâter la coagulation. On est prêt à se battre en un clin d’œil, ou à fuir. Si la situation n’est pas dangereuse après tout, un signal de fin d’alerte est émis et des hormones de détente inondent le cerveau. Mais après avoir eu une expérience dangereuse, la mémoire et les émotions fortes qui les accompagnent sont rangées, afin de pouvoir juger du danger et réagir encore plus vite la fois suivante.
Dans le TSPT, ce système ne fonctionne pas bien. On pense que certaines structures cérébrales peuvent être endommagées par une surdose d’hormones, le résultat d’un danger omniprésent, comme c’était le cas pour le caporal Dupee en patrouille tous les jours en Afghanistan. Ou pour le vétéran de l’aviation Dornan qui a vu des horreurs au jour le jour en Bosnie à la recherche de fosses communes. Ou l’augmentation constante du niveau de stress chez Peacock à cause des longues journées passées à faire un travail où une erreur coute des vies. Dans les images de cerveau affecté par le TSPT, l’hippocampe, partie du cerveau qui s’occupe du classement et de la récupération des souvenirs, est rétréci, et l’amygdale, celle qui sert à apprendre à avoir peur ou pas de certaines choses, est plus grosse. Le cortex préfrontal, la partie chargée d’amortir la réponse au stress, de calmer le corps après le danger ou quand il faut agir malgré le danger, comme courir sous les coups de feu ou aller à la rescousse d’un camarade blessé, est réduit. En outre, les souvenirs ne sont pas rangés comme il faut. Les expériences mal rangées et les émotions connexes sont interprétées comme étant des évènements actuels par le système d’alerte avancée du cerveau. Chez une personne qui a un TSPT, le raté d’allumage d’une voiture peut faire en sorte qu’elle se baissera vivement, courra à l’abri ou tirera les autres vers un refuge parce que ce bruit est associé à une émotion qu’elle a ressentie auparavant sous les coups de feu, une émotion qui est associée au danger dans son cerveau. Chaque fois que ce souvenir et cette émotion sont rappelés, le lien entre eux se renforce. C’est pour cela qu’il est important de le soigner au plus vite.
Bien qu’il y ait divers traitements pour le TSPT, il n’y en a que quatre pour l’instant qui fonctionnent la plupart du temps. On les appelle thérapies fondées sur des données probantes, et ce sont celles que préfère l’armée dans les cas de TSPT. La thérapie d’exposition prolongée désensibilise les gens aux émotions accablantes du TSPT et s’occupe du comportement d’évitement. La thérapie du traitement cognitif se charge des effets des traumatismes sur les croyances et les pensées. La thérapie de l’intégration neuroémotionnelle par les mouvements oculaires aide le traitement des souvenirs. La pharmacothérapie utilise des médicaments pour contrôler ou atténuer les symptômes.
Selon des recherches présentées au Forum de recherche sur la santé des militaires et des vétérans canadiens en novembre dernier, les deux psychothérapies, celle de l’exposition prolongée et celle du traitement cognitif, réduisent la gravité des symptômes d’entre 60 et 80 p. 100 au cours des traitements dont le nombre peut aller jusqu’à une douzaine. Toutefois, elles ne fonctionnent pas chez tous les patients, et un quart ou plus d’entre eux abandonnent la thérapie parce qu’il faut y raconter et revivre l’évènement traumatisant encore et encore. Les effets secondaires de la pharmacothérapie poussent certains à l’abandonner aussi.
Quand le traitement est efficace, la vie de ceux qui souffrent de TSPT est moins douloureuse. « Il y a une cicatrice, bien sûr », dit le psychologue de Vancouver Marv Westwood. Toucher à cette cicatrice entraîne une réaction qu’on nomme « déclenchement » : la renaissance des symptômes. Les gens supportent mieux après le traitement. « Les gens savent quels sont les déclencheurs. Ils se disent : “Oh! Je sais d’où ça vient; c’est pour ça que j’ai eu cette réaction.” Ils regardent autour d’eux, s’aperçoivent qu’ils sont en sécurité et reprennent leurs activités. »
John, le réserviste, a trouvé que les traitements étaient douloureux, mais ses symptômes ont été atténués relativement vite. Les premiers médicaments qu’on lui a prescrits ont diminué son insomnie, son anxiété et sa dépression. Mais il y avait les effets secondaires. « Les quatre premiers jours, c’était l’enfer, dit-il. J’avais la nausée, la diarrhée, la fièvre, des migraines abominables au point où j’en perdais la vue, il y avait des lumières blanches, des vertiges, tout. Vraiment difficile. » Mais il s’est entêté et, au bout de six semaines, les médicaments ont porté fruit. La psychothérapie aussi l’a aidé. « C’est plutôt surréel, dit-il. C’est comme si quelqu’un vous lit une histoire, votre histoire, et c’est comme bizarre. On s’effondre plus souvent parce que le corps doit l’évacuer du cerveau. Mais après on se sent mieux plus souvent. » La thérapie d’exposition a fonctionné pour son intolérance envers les foules, et il a pu s’habituer peu à peu au transport public pour aller travailler à Toronto. Ça fait deux ans maintenant, et il espère en avoir bientôt fini de toute la thérapie.
Revivifier les évènements traumatisants pendant les séances de thérapie en décrivant les sons, les images, les couleurs et les odeurs, c’était douloureux et fatigant pour Chris Linford. « Il fallait que je raconte la même histoire trois ou quatre fois. Quand l’anxiété montait, [le thérapeute] me faisait employer les techniques de détente et de respiration. Avec le temps […] je réussissais à les expérimenter et à les supporter jusqu’au bout, et elles ne m’affectaient plus du tout au même degré. » Ses devoirs l’ont aidé à se désensibiliser lentement par rapport aux déclencheurs dans son environnement. L’odeur du sang ou de la viande crue était une de ces choses, au point où il ne pouvait plus entrer dans une épicerie. Son épouse, Kathryn, dit que ce fut un processus lent, comprenant de nombreux déplacements au magasin et une approche graduelle du rayon de la boucherie. « Des fois, maintenant, je vais au magasin et j’en repars sans m’apercevoir que je suis allé au rayon des viandes, » dit-il.
Les médicaments et la psychothérapie qu’il a reçus aux FC ont atténué ses symptômes, mais c’est en intégrant la communauté qu’il a ressenti une toute autre guérison. « J’avais une vie très isolée », dit-il. La vie militaire, c’est surtout celle d’un membre d’une équipe; on aborde les problè-mes et on les résout ensemble; on s’appuie entre coéquipiers et on veille les uns sur les autres. « Quand on développe un TSPT, pour de vraiment bonnes raisons, on vous retire de ça. » Il a été affecté loin de son unité durant le traitement, à une unité interarmées de soutien au personnel. Les militaires sont affectés à ces unités pour les soins et la réadaptation, et pour l’attribution des tâches que leurs unités d’appartenance ne peuvent pas leur confier. « Mais ce qui arrive aussi, c’est qu’on vous retire d’une grande partie de l’élément de soutien que vous aviez et sur lequel vous avez compté pendant toute votre carrière », dit Linford. Il a essayé un certain nombre de programmes, notamment Outward Bound, Sans limites, et le programme de transition des anciens combattants, qui rassemble les anciens combattants pour des activités de groupe en vue de leur fournir un appui émotif pendant qu’ils s’attaquent à leurs problèmes de TSPT. Ils échangent leurs histoires, leurs défis, leurs réussites, leurs idées pendant qu’ils descendent une rivière en canoë ou qu’ils escaladent un mont de l’Himalaya ou des Rocheuses, ou qu’ils acquièrent des compétences interpersonnelles. « J’ai vite appris que je n’étais pas tout seul, dit-il. Ça m’a vraiment donné le genre de sentiment agréable qu’on a quand on fait partie d’une équipe. »
Linford a triomphé de son isolement en se tournant vers l’extérieur, et il a trouvé un appui pour pouvoir se tourner vers l’intérieur. La culture militaire produit gens stoïques, qui savent qu’ils risquent d’être blessés ou tués en service commandé. Ils mettent autrui avant soi, et la mission et le service pour leur pays au-dessus de tout. Ils s’efforcent de surmonter tout obstacle, de ne pas avoir de faiblesse. Le TSPT est une blessure terrible pour des gens qui s’attendent à avoir une telle force. Par conséquent, ils ne demandent pas de l’aide facilement. « Ils n’aiment pas ce sentiment de […] peut-être une faiblesse, ou une faille dans la cuirasse. Je dois m’inclure dans cette liste, dit Linford. Je sais que je ne suis pas guéri; j’aurai toujours un TSPT. Mais je comprends qu’identifier et accepter, et être honnête envers moi-même par rapport à ma vulnérabilité m’a apporté une force incroyable. C’est drôle que quelque chose qu’on supposerait nous affaiblir nous rend au contraire beaucoup plus forts. Quand j’ai compris ça, les portes se sont ouvertes devant moi et ma santé s’est rapidement améliorée. »
Une chose importante dont on se rend compte, c’est que le procédé de rétablissement après un TSPT n’a pas un seul stade, et qu’on ne peut pas y avoir recours tout seul. « Il n’existe pas de magie surpuissante, dit Linford. Il s’agit plutôt d’acquérir une épaisseur à la fois. »
La thérapie, la médication, et l’appui des pairs, de la famille et de la collectivité jouent tous un rôle dans la guérison. Le TSPT est l’affaire de tout le monde. Les soldats ont besoin de l’appui des collectivités civiles auxquelles ils reviennent à la fin de leur carrière militaire. Mais ce n’est pas un sens unique. La collectivité peut aussi s’enrichir grâce à ce que l’armée a appris sur les manières de prévenir, de soigner et de se remettre d’un TSPT. « Le TSPT n’existe pas seulement dans l’armée, dit Jetly. Dire que le pays a une obligation morale d’aider les jeunes gens qui ont tant sacrifié, ça ne peut durer que pendant quelques élections. » Le TSPT se produit dans la communauté des civils aussi, ajoute-t-il. Des recherches ont conclu que 10 p. 100 des civils ont un TSPT à un certain moment dans leur vie, à cause d’accidents de la circulation, d’incendies, de désastres naturels, de viols, de violence faite aux enfants, de passages à tabac, de coups de feu. Plus de trois millions de civils canadiens doivent composer avec l’insomnie, des cauchemars, des flashbacks, un engourdissement émotif, un tempérament colérique et de l’anxiété incessante.
Les civils aussi entrent dans ce monde étrange, et ils éprouvent les mêmes difficultés à rebrousser chemin. Mais les médecins de famille ne sont pas bien renseignés sur le TSPT et sur les manières de le soigner. Contrairement à ce qui se passe dans la communauté militaire, rares sont les amis d’un civil, ses voisins et sa famille qui assistent à une séance d’instruction sur la santé mentale. Le stigmate relatif à la santé mentale est encore présent partout dans le monde civil. Jetly croit que l’armée peut l’aider à éliminer ces obstacles. Le programme militaire utilisé pour réduire le stigmate peut servir de modèle aux programmes des communautés, et les recherches sur les meilleurs traitements pour les militaires garantiront aussi aux civils des programmes qui auront fait leurs preuves. Et pour finir, dit Jetly, les militaires qui ont un TSPT peuvent raconter leurs expériences.
Et on en revient donc aux neuf hommes dans cette salle d’Halifax. Le sentiment du devoir les a peut-être obligés à raconter leurs histoires, afin qu’il y ait des services, et peut-être d’autres qui soient meilleurs, pour cette génération de militaires victimes du TSPT et pour les prochaines. Chaque fois qu’un ancien combattant redouble de courage pour raconter ses histoires, il améliore les chances que, cette fois-ci, le TSPT ne soit pas relégué aux oubliettes.
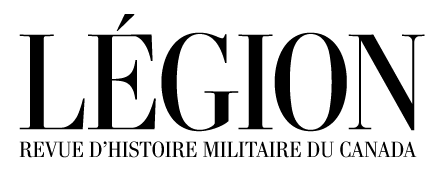
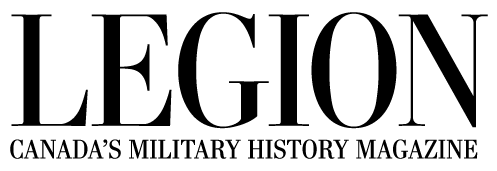







Comments are closed.