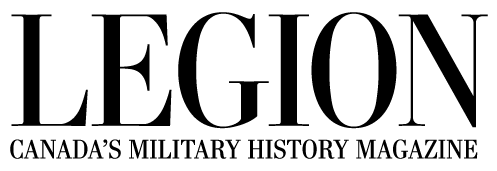![. [PHOTO : METROPOLIS STUDIO]](https://legionmagazine.com/fr/wp-content/uploads/2008/05/hillierleadfrench.jpg)
Note de l’éditeur : le 15 avril, alors que nous nous préparions à aller sous presse, le général Rick Hillier annonçait qu’il va quitter son poste de chef d’état-major de la défense en juillet.
Le général Rick Hillier sourit encore, mais à peine. Après plus de trois ans à la tête des Forces armées du Canada, observé par les reporters et au milieu de la polémique politique par rapport à la guerre en Afghanistan, le chef d’état-major de la défense Rick Hillier, premier soldat du Canada, assiégé à l’occasion, est toujours résolu, d’un optimisme indéfectible.
Il est optimiste non seulement à propos de la mission en Afghanistan, où le progrès est quotidien dit-il, même s’il est lent et inachevé, mais aussi à propos de l’avenir des Forces canadiennes qui, d’après lui, sont finalement en train de devenir une organisation dont les membres veulent faire partie.
Choisi chef d’état-major de la défense par l’ancien premier ministre Paul Martin et le ministre de la défense d’alors Bill Graham, Hillier s’élançait sous les projecteurs au début 2005 grâce à ses opinions et à son franc-parler, à son charisme vibrant, et il annonçait avec fermeté comment il voyait le renouveau des Forces canadiennes.
Maintenant, après plus de trois ans à un travail où il a beaucoup encaissé, le stress commence à transparaitre. Bien que fameux pour sa bonne humeur accueillante et son charisme affable, lors de ses derniers discours et entretiens, il semblait quelque peu abattu, pas vraiment froid, mais peut-être un peu las. « (Je) savais que (mon mandat en tant que chef d’état-major de la défense) allait être raide », dit-il. « J’avais l’intention qu’il serait raide et court, mais pour l’instant je n’ai pas réussi à le rendre court, alors, ouais, c’est raide. »
Né en 1955 à Campbellton (T.-N.), il s’est engagé dans le militaire après avoir obtenu un diplôme à l’Université Memorial en 1975. Il a servi dans les 8th Canadian Hussars et les Royal Canadian Dragoons en tant qu’officier de blindés, et puis il a monté en grade jusqu’aux postes d’état-major, dont celui de chef d’état-major de l’armée de terre.
Toutefois, rien n’aurait pu le préparer complètement au stress et à l’observation des trois dernières années. Il a déjà servi sous trois ministres de la Défense nationale et deux premiers ministres, et il a enduré d’innombrables petits déchaînements de passions bureaucratiques ou médiatiques qui auraient pu interrompre sa carrière. Et il a fait tout cela avec le sourire qui est devenu sa marque de fabrique. « Je n’ai pas de leçon pour la survie, car je m’y suis vautré moi-même », dit-il en souriant lors d’un entretien qu’il nous accordait. « J’ai travaillé des journées trop longues, fumé trop de cigares et fait tout ce qu’on ne devrait pas faire pour survivre personnellement. »
Il a quand même survécu, bien qu’avec quelques marques. En plus des innombrables petites controverses, il y a une source de stress plus importante : pas moins de 84 soldats, marins et aviateurs canadiens sont morts depuis que Hillier a accepté son poste, le 4 février 2005.
« Je n’ai pas de leçon pour la survie, car je m’y suis vautré moi-même », dit-il en souriant lors d’un entretien qu’il nous accordait. « J’ai travaillé des journées trop longues, fumé trop de cigares et fait tout ce qu’on ne devrait pas faire pour survivre personnellement. »
Ce chiffre comprend les soldats qui sont morts au Canada et ailleurs autour de la terre, mais la grande majorité des morts se sont passées au Kandahar (Afghanistan), à une mission dont il s’est fait le champion et qu’il a supervisée depuis le début, en 2006.
Il croit que, bien que constant, le progrès en Afghanistan est lent et il dit qu’il n’y a « pas assez de développement visible », et que malgré le fait que les talibans ont été affaiblis, ils constituent encore une force de combat mortelle.
Malgré cela, il est confiant que la plus grande partie des combats est terminée et que bientôt, après février 2009, le Canada va pouvoir dédier une plus grande partie de ses forces à l’entrainement des soldats et des policiers afghans, grâce surtout aux équipes de liaison et de mentorat professionnel (ELMP), lesquelles sont composées de soldats canadiens intégrés dans des unités de l’armée et de la police afghanes.
En même temps, le général Hillier reconnait que la stabilisation du Kandahar et la mise en déroute des talibans aura été une mission difficile, surtout à l’endroit qu’il appelle « le triangle de fer », région à l’ouest-sud-ouest de Kandahar, formée par Zhari, Panjwai et Pashmul, où sont nés les talibans et où ont eu lieu la majorité des combats.
Durant les deux dernières années, les Forces canadiennes ont essayé de s’attaquer à ce terrain toutes seules — et conséquemment elles ont joué un rôle où elles se battaient pour repousser les insurgés d’un terrain qu’ils reprenaient aussitôt qu’elles se retiraient — au cours des quelques prochains mois, d’après Hillier, il va y avoir du changement sur le terrain. « En fait, nous n’avions pas suffisamment de soldats pour nous placer à certains endroits tout le temps. Ainsi, nous pouvions nous précipiter, mais ensuite il fallait aller mener une opération ailleurs, alors les talibans pouvaient revenir et ils se permettaient de le faire; en fait, ils le font encore : on ne fait que donner des coups d’épée dans l’eau. »
Toutefois, à l’approche du printemps, un certain nombre de choses ont changé en faveur de la mission de l’OTAN. La plus évidente est l’apport de quelque 3 000 marines américains venus au Kandahar pour travailler avec les Forces canadiennes dans des « opérations synchronisées » comme dit le général Hillier.
Mais en plus, comme il le fait remarquer, il y a quelques innovations qui pour être plus subtiles n’en sont pas moins décisives. Non seulement les fameux Gurkhas népalais opèrent-ils actuellement aux côtés du bataillon canadien dans le Sud en tant que bataillon de réserve, on y prévoit aussi un bataillon de réserve américain pour les opérations. « La possibilité que quatre bataillons ou plus travaillent ensemble au Kandahar pendant une bonne partie de la prochaine saison de campagnes, entre mars et novembre, change la dynamique du tout au tout », dit Hillier. « C’est que les talibans ne pourront pas simplement se retirer ni au district de Maywand, ni à Spin Boldak, ni en Arghandab du Nord parce qu’il va y avoir un bataillon là-bas aussi. Alors tout à coup il ne leur reste plus d’endroit où aller et nous allons avoir une présence beaucoup plus viable au cours des prochains six ou huit mois; et puis ça va permettre aux policiers de faire quelque chose; ça va les rendre plus confiants et ça va nous permettre de progresser davantage parce que nos équipes de formation seront plus nombreuses là-bas. »
Le débat au Canada s’est porté sur ce qui va se passer au-delà des prochains six à huit mois — la prochaine « saison de campagnes » comme beaucoup de gens se plaisent à dire — soit sur 2009 et sur ce qui va arriver à la mission canadienne après l’obligation actuelle de trois ans. Bien que le Parlement a voté au mois de mars de prolonger la mission, en principe, jusqu’en 2011, une bonne partie des détails opérationnels n’ont pas encore été fixés.
« … alors n’essayons pas de diriger en détail une mission sur le terrain en Afghanistan à partir d’ici à Ottawa quand on ne sait pas dans quelle situation elles vont se trouver d’un jour à l’autre. Si on le fait, on prend des risques énormes et on met des hommes et des femmes en très grand danger. Alors donnez-nous la mission et assurez-vous que c’est une mission viable militairement du point de vue des commandants, et puis laissez-nous faire. »
Ce printemps, alors qu’à Ottawa on se demandait surtout si la mission de combat devrait continuer ou s’il fallait la remplacer par le rôle moins agressif et moins dangereux qu’est la formation des forces afghanes, Hillier essayait de recanaliser le débat en demandant au Parlement de confier une mission aux Forces canadiennes qui serait « viable militairement ».
« Actuellement, dans la catégorie formation, nous avons engagé quelque 250 de nos soldats », dit-il, à propos des Canadiens qui font partie du programme d’ELMP. Aussitôt qu’on obtiendra un autre bataillon, ou d’autres soldats, ou encore d’autres policiers, on va prélever davantage d’entraineurs sur notre contingent, et cela voudra dire que moins (de Canadiens) iront se battre. Mais il faut qu’on maintienne cette capacité de réagir, et il faut qu’on continue de poursuivre les chefs. »
Il y aura moins de Canadiens qui se battront parce que, en théorie, les Afghans vont s’occuper d’une bien plus grande partie des combats eux-mêmes, quoique avec l’aide des Canadiens qui font partie des ELMP. Toutefois, la capacité de réagir dont parle Hillier veut dire qu’il faudra une force de combat en réserve formée de soldats canadiens, et il faudra continuer d’envoyer des forces d’opérations spéciales canadiennes à la poursuite des chefs des talibans. De plus, même la distinction entre la formation et le combat n’est pas du tout évidente, comme le remarque le général.
« Quand on déploie les ELMP, c’est avec les bataillons afghans et ça veut dire qu’elles vont au combat elles-mêmes. Alors n’essayons pas de diriger en détail une mission sur le terrain en Afghanistan à partir d’ici à Ottawa quand on ne sait pas dans quelle situation elles vont se trouver d’un jour à l’autre. Si on le fait, on prend des risques énormes et on met des hommes et des femmes en très grand danger. Alors donnez-nous la mission et assurez-vous que c’est une mission viable militairement du point de vue des commandants, et puis laissez-nous faire. »
Hillier affirme que la poursuite des opérations militaires au Kandahar va presque certainement donner lieu à des combats d’une sorte ou d’une autre et que l’ordre politique d’éviter le combat tout en se tenant opérationnel au Kandahar mettrait la mission en danger, et la vie de soldats canadiens également. Il n’a certainement pas tort.
D’un autre côté, au Canada, les Forces canadiennes se trouvent dans un tout autre combat. Ayant été réduites et leurs acquisitions restreintes pendant la période suivant la guerre froide, leur problème actuel, c’est qu’elles grandissent un tout petit peu trop vite. « Notre effectif a été tellement réduit, je crois bien qu’il a atteint un point en dessous de la masse critique », dit Hillier. « Dans un pays aussi grand que le nôtre, où il y a tant de bases et de stations, où il y a tant d’ouvrages à accomplir, tant d’ouvrages en Amérique du Nord dans le cadre du NORAD et tant de missions ailleurs… on était bien en dessous de la masse critique. »
Et vu que les effectifs augmentent rapidement, la pierre d’achoppement contre laquelle Hillier a butté est de former les recrues assez vite. De plus, il dit qu’il y a tant de programmes d’approvisionnement qu’ils vont trop vite pour qu’on puisse s’en occuper comme il faut. « On ne peut pas s’occuper de tous les programmes pour l’équipement qu’on a », dit-il, « et en conséquence, on les ordonne selon leurs priorités et on en met quelques-uns de côté. Par exemple, on aurait aimé s’occuper des voilures fixes de Recherche et sauvetage il y a deux ans, mais ce n’était tout simplement pas possible à cause de tout ce qu’on devait faire, mais on va pouvoir s’en occuper très bientôt […]. »
En fin de compte, le général semble satisfait que son projet concernant la transformation des Forces canadiennes est une réussite, en gros, et il ne semble pas s’inquiéter outre mesure des autres obstacles. En effet, la vision dont il a parlé quand il a obtenu le poste, des Forces canadiennes restructurées, un nouvel équipement, une nouvelle concentration sur les opérations et l’unité des Forces, s’est concrétisée en grande partie et, bien qu’il reste encore du travail à faire, il donne l’impression que les Forces ont finalement tourné la page. « Les gens travaillent dur », dit-il. « Ils ont toujours travaillé dur. Mais le contexte, aujourd’hui, est si différent de celui d’il y a cinq ou 10 ans. Le contexte est si différent qu’on est vraiment en train de construire des Forces comme celles dont veulent faire partie la plupart des gens en uniforme depuis qu’ils se sont engagés. »
Même si Hillier se fait critiquer, presque tous les gens qui s’intéressent au militaire canadien reconnaissent qu’il a eu un effet énorme. « Je pense que c’est le premier chef d’état-major de la défense (depuis longtemps) qui est aussi une personnalité, qui a mis le militaire au premier plan, qui traite avec le gouvernement comme il faut pour obtenir ce dont le militaire a besoin, qui a aussi bien fait comprendre sa vision aux forces » dit Jack Granatstein, un historien et auteur canadien qui, entre autres, a écrit The Generals, une étude du généralat canadien à la Seconde Guerre mondiale.
« Je ne veux pas dire lesquels », dit Granatstein, « mais il y a probablement eu trop de généraux qui ne faisaient que saluer et dire “oui m’sieur”, et qui ne protégeaient pas toujours les intérêts des forces, ce qui n’était probablement pas la meilleure chose à faire pour le militaire. D’un autre côté, il est possible de faire l’inverse. On peut pousser les politiques à faire des choses que le public ne soutient pas et, au bout du compte, les dirigeants, ce sont le premier ministre et les ministres, alors le chef d’état-major peut se faire limoger à n’importe quel moment. Je pense que Hillier a reculé les limites un petit peu, et je pense aussi qu’il a réussi à le faire avec beaucoup de doigté. »
Bien entendu, Hillier va finir par quitter son poste, c’est inévitable, et bien qu’il n’y a pas de terme obligatoire pour un chef d’état-major de la défense, la moyenne est à peu près de trois ans et demi, ces derniers temps. Son prédécesseur, Ray Hénault, a servi trois ans et sept mois, et Maurice Baril, juste avant, pendant presque aussi longtemps. Quant à Hillier, il garde le secret en ce qui concerne ses plans. Et même si à l’occasion des rumeurs courent que sa titularisation touche à sa fin, il disait en riant, lors d’un discours en février, qu’il en était à sa dernière année en tant que chef d’état-major; il disait qu’il allait se joindre aux Maple Leafs de Toronto, pour insérer le « généralat » militaire dans le directeur général.
Le plan de la campagne afghane du général
La mission afghane est on ne peut plus complexe. Il n’y a pas de réponse simple même aux questions élémentaires comme « Que se passe-t-il? » et « Somme-nous en train de gagner? ». Pour répondre à une question sur la guerre en Afghanistan que nous lui avons posée, le chef d’état-major de la défense a essayé de rendre la mission un peu plus compréhensible en nous expliquant comme il faut les trois stades — combat, entrainement et développement — du plan canadien au Kandahar et il a ajouté une évaluation du progrès obtenu. Il expliquait la mission ainsi.
« Voici comment on comprend ça avec des termes simples triangulaires, ce qu’on essaie de faire depuis qu’on est allés là-bas. Voici comment on y est allés, disons. Au début, on s’est concentrés sur la partie qui comprend les combats et ce n’était pas par hasard, vu que les talibans étaient au pouvoir et ils menaçaient tout ce qui se passait et ce qu’on prévoyait faire, et puis les Afghans n’étaient pas capables de s’en occuper, alors on a dû se battre nous-mêmes.
« Le développement était accessoire, surtout parce que le danger était si grand qu’il a fallu qu’on s’y emploie peu à peu. L’entrainement, ce qu’on voulait faire depuis le début, c’était encore moins important parce qu’il n’y avait pas de forces afghanes à entrainer. Et le gouvernement, les aider à gouverner, eh bien, nous, les militaires, nous n’avons pas de capacités importantes pour les aider, mais nous avons quand même employé notre équipe consultative stratégique à Kaboul pour essayer de le faire un peu. Mais si on regarde ce mélange de choses en marche : les Forces canadiennes, les Afghans, et la communauté internationale; c’est là qu’on en était.
« La transition qui nous intéresse c’est vers là où on pourra se concentrer sur l’entrainement, pour que les combats deviennent un composé des combats des ELMP et de nos unités afghanes, de nos forces d’opérations spéciales qui pourchassent les chefs, et cetera; et puis aussi une capacité de réaction ou de réserve, au cas où les choses ne se passent pas bien. Et puis ensuite, on pourra se concentrer davantage sur le développement et on pourra le rendre plus sûr et continuer à s’occuper de la partie qui concerne le gouvernement.
« Ensuite, la troisième partie, c’est celle où le développement prend le plus d’importance. C’est la construction et la partie gouvernementale. La partie qui concerne l’entrainement devient celle où on épaule l’entrainement de l’armée nationale afghane, et la partie concernant les combats devient simplement celle des combats les plus importants des forces spéciales anti-terroristes. Et les Afghans s’occupent de tout le reste.
« Alors il faut aller de l’un à l’autre, et puis au suivant, et on pense que c’est justement là qu’on se trouve. Alors, le problème c’est de savoir combien de temps il faut pour aller complètement de l’un à l’autre, et on travaille là-dessus tous les jours. »
Le pire dans le meilleur emploi du monde
Quand le général Hillier dit qu’il a « le meilleur emploi du monde », il le dit avec tant de conviction qu’on ne peut faire autrement que croire qu’il le croit vraiment; toutefois, quand il parle du pire qu’il y a dans son emploi, sa voix change, il baisse les yeux et il donne l’impression, reconnaissable entre toutes, que ce dont il parle, c’est quelque chose de véridique.
« Il y a toutes sortes de choses qui ne se passent pas comme on voudrait, et tout, mais croyez-moi, quand on a la vie d’hommes et de femmes entre les mains, tout ce qui touche à la bureaucratie habituelle et qui fait que les choses ne se passent pas tout à fait comme on le souhaiterait, quand on fait deux pas en avant et un en arrière, ou même à l’occasion un pas en avant et deux en arrière, toutes ces choses-là ne veulent vraiment plus dire grand-chose.
« Ce qui est vraiment pénible, c’est quand on reçoit un appel au milieu de la matinée, ou au milieu de la nuit — et, autrefois, je disais pour rire avec mes gars que personne ne m’appelle à trois heures du matin pour me dire que j’ai gagné à la loterie, mais ce n’était pas vraiment très drôle — quand le téléphone sonne à trois heures du matin, maintenant, j’en suis au point où je m’assois, je ne me presse pas, je me prépare, parce que je sais ce qu’il y a à l’autre bout. C’est la seule raison pour laquelle les gens m’appellent, parce que nous avons perdu quelqu’un. C’est ça la partie du travail que je ne souhaite à aucun chef d’état-major de la défense.
« (Je) prends (mes) responsabilités avec beaucoup de sérieux; ça veut dire que je vais sans faute voir la famille, et je m’assure qu’elle a notre soutien, qu’elle l’a le plus vite possible. Et comprenez-moi, c’est durant le pire des jours de leur vie que je vais voir ces gens. Toutefois, je ne peux pas vraiment comprendre ce qu’ils endurent parce ce que ça ne m’est jamais arrivé. Je pleure avec eux, mais c’est difficile de sympathiser parce que nous n’avons pas eu la même expérience. On va voir chacune des familles pour leur parler, et je ne les ai pas toutes rencontrées parce que des fois j’étais à l’étranger et je ne pouvais pas revenir assez vite, et on leur dit à quel point on est fier de leur fils ou, dans le cas de Nichola Goddard, de leur fille, et à quel point on est fier qu’ils étaient des militaires, et qu’ils faisaient partie de nous, et qu’ils nous ont si bien servi, et que maintenant notre travail c’est de faire en sorte que la trace de leurs pas dans le sable ne soit jamais effacée. On va les voir pour les inspirer et les aider durant les jours les plus difficiles, les pires de leur vie, et chaque fois ce sont eux qui nous inspirent : grâce à leur force, à leur dignité, à leur courage et à la fierté qu’ils ressentent eux-mêmes pour leur enfant, leur fille, leur mari, leur père. »
Opérations spéciales : Les Hommes en Noir canadiens
Au fur et à mesure que la bataille du Kandahar s’éloigne de la confrontation armée directe, le combat ressemble de plus en plus à celui pour lequel les forces d’opérations spéciales ont été conçues. La Force opérationnelle interarmées 2 — la force anti-terroriste au paroxysme des facultés militaires — se trouve en Afghanistan depuis 2002, et le général confirme que le Régiment d’opérations spéciales du Canada (ROSC) mène actuellement des opérations en Afghanistan aussi. Bien que les détails des opérations sont secrets, le général dit franchement que les forces d’opérations spéciales canadiennes pourchassent les chefs des talibans à travers le Kandahar.
« (Les forces d’opérations spéciales canadiennes) sont un facteur des plus importants. Quand il s’agit de poursuivre et ébranler la cohérence des talibans, c’est-à-dire de maintenir la pression sur leurs commandants, nous sommes des plus efficaces. Nos opérations ne servent pas à attaquer chacun des combattants talibans, car beaucoup d’entre eux sont eux-mêmes des gens qui ont été acculés au combat, qui n’avaient d’autre choix que de prendre les armes parce qu’ils n’avaient pas d’argent pour nourrir leur famille, ou qui ont été forcés de le faire parce que c’était moins dangereux de nous faire face que le contraire. Alors nous ne sommes pas aux trousses de chaque combattant taliban.
« Ce qu’on veut faire, c’est supprimer les commandants qui s’occupent d’orchestrer, de faciliter, de payer, de commander, de planifier et de pousser les gens à nous attaquer ou à attaquer les Afghans ou les innocents. Et c’est sur ça que nos forces spéciales se concentrent. C’est comme ça qu’on détermine les conditions favorables au succès mais, ce qui est tout aussi important pour nous, ça sert à réduire énormément les risques que courent nos hommes et nos femmes.
« J’ai dit (durant un discours récent) qu’on avait débarrassé le champ de bataille de six commandants qui étaient responsables de la mort de 21 soldats canadiens; eh bien, ce chiffre à changé. On a supprimé sept commandants qui étaient responsables de la mort de 27 soldats et, en soit, ça veut dire que ces commandants, qui sont des gens capables, ne sont plus en train de tirer des plans et d’organiser et lancer des attaques contre nous, et encore moins contre les Afghans ou les organismes d’aide.
Le chef d’état major et la Légion royale canadienne
« Je vais toujours porter dans mon cœur le fait que j’étais chef d’état-major de la défense et vice-président honoraire de la Légion durant l’année de l’ancien combattant (2005). Je sais fort bien les efforts que la Légion royale canadienne a faits pour s’assurer que la “trace des pas dans le sable” qu’ont laissé nos anciens combattants ne soit jamais effacée, et ce qu’elle est en train de faire pour s’occuper de nos générations d’anciens combattants plus jeunes. Le soutien de la Légion nous inspire tous. »
Les quatre leçons du général Hillier sur la guerre anti-insurrectionnelle
La guerre anti-insurrectionnelle est notoirement délicate, pleine de stratégies qui peuvent sembler aberrantes et de paradoxes. Pour gagner, le commandant doit bien comprendre les vieilles leçons — on peut gagner toutes les batailles sans toutefois gagner la guerre, mais les insurgés peuvent gagner rien qu’en refusant de perdre, et bien qu’il n’y ait pas de solution militaire au problème de l’insurrection, on ne commande que des forces militaires — tout en essayant de saisir une situation singulière dans toute sa complexité. Alors après plus de deux ans durant lesquels il a dirigé les opérations anti-insurrectionnelles en Afghanistan, voici ce que le chef d’état-major de la défense a appris.
1. « Il faut fixer les gens de la région, qui ne désirent qu’avoir une vie normale, sur notre soutien réel en leur faveur. Et savez-vous, je ne suis même pas sûr que la démocratie telle que nous la connaissons et des normes de vie comme les nôtres soient possibles en Afghanistan. Mais, ma foi, tout ce que les gens de là-bas désirent c’est de vivre sans souffrir de la faim, sans être en danger et que leurs enfants et eux-mêmes ne risquent de se faire tuer quand ils vont quelque part, d’avoir la possibilité d’un avenir qui soit un tout petit peu meilleur, peut-être de pouvoir obtenir des soins, et certainement que leurs enfants aient de l’éducation. Alors il faut être un soutien évident pour les gens et pour ce qu’ils essaient de faire, que ce soit évident dans tout ce qu’on fait, c’est la première partie.
2. « On ne gagne pas une campagne anti-insurrectionnelle par la force militaire. Ce qu’il faut faire, c’est contrer les insurgés, dans ce cas-ci, les talibans; on les empêche d’arrêter ou même de freiner le progrès, bien que des fois ils réussissent à le freiner, mais on les empêche de l’arrêter, jusqu’à ce qu’on ait réussi à construire le pays autour d’eux. Le point où la réussite est assurée est difficile à voir, mais d’après moi c’est subjectif. Alors, maintenant, s’il y a une grosse explosion à Kaboul, les gens se demandent si le gouvernement afghan se maintient encore, s’il est encore là. Car, voyez-vous, la confiance est encore fragile. À un moment donné, l’Afghanistan va devenir comme les autres pays, elle aura encore des problèmes de violence, mais quand ils auront lieu, personne ne s’inquiétera que ça donne lieu à toute une série d’événements et que ça fasse tomber le gouvernement, parce qu’ils auront confiance que leur gouvernement sera capable de s’en occuper. Et c’est là où il faut en venir.
3. « Lorsqu’on construit les institutions en Afghanistan, malgré l’insurrection, il faut le faire à l’image des Afghans. Ce n’est pas ce que nous voulons comme solution. C’est celle qu’ils veulent. Ainsi, de quoi leurs unités auront l’air, et comment leur police va fonctionner, et où ils veulent un pont ou un puits, ce n’est pas toujours évident pour nous, alors on doit se rappeler constamment que c’est leur pays et qu’ils seront encore là dans 50 ans, pas nous, alors il faut s’assurer que ce soit non seulement l’image afghane, mais que la philosophie soit afghane, que la construction soit afghane, et que des Afghans participent au mécanisme décisionnel et puis ensuite qu’ils prennent ces décisions eux-mêmes en tenant compte de la compréhension précise de leur pays, de leur population et de leur système qu’ils ont.
4. « D’après nous, pour contrer l’insurrection, il faut des soldats, des marins et des aviateurs et aviatrices professionnels comme on n’en a jamais eu besoin auparavant. Cela nécessite une direction au niveau le plus bas. Des jeunes gens sur lesquels nous comptons pour faire des choses phénoménales, dans un chemin poussiéreux et dangereux, loin de toute autre unité, avec des Afghans de la place… Les militaires qu’il faut pour ça sont des professionnels absolument incroyables et, d’après moi, (l’Afghanistan) a confirmé que nos gens en uniforme sont vraiment des professionnels.