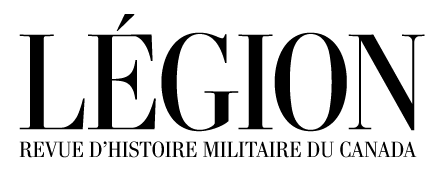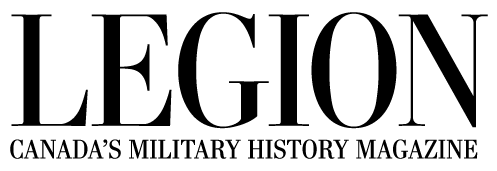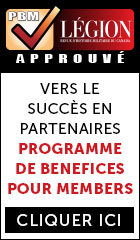Dans un article paru précédemment (La Croix-Rouge et la captivité de guerre, 1939-1945 juillet/août 2006), il était question de l’aide fournie par la Croix-Rouge canadienne aux prisonniers de guerre provenant du Commonwealth. Cependant, cet article ne présentait que l’aboutissement, ou la partie visible d’un processus, soit l’aide en elle-même. Il y était question, notamment, des “colis de vivres” et des autres mécanismes mis en place par l’institution humanitaire afin d’assurer la survie et le bien-être des prisonniers.
Le présent article tentera, pour sa part, de démythifier quelques aspects de la littérature qui demeurent occultés, soit les relations entre la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement fédéral canadien. Effectivement, bien que le Mouvement de la Croix-Rouge–qui englobe toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge–soit réputé pour son indépendance, sa neutralité et son impartialité, des historiens révisionnistes ont démontré que les gouvernements avaient un contrôle important sur leur Croix-Rouge en temps de guerre. Cet article s’attardera donc à démontrer que la Croix-Rouge canadienne a elle aussi été contrôlée par une autorité étatique, soit le gouvernement fédéral d’Ottawa et même, parfois, utilisée par lui à des fins autres qu’humanitaires. En contrepartie, elle a également profité de sa collaboration.
De toutes les relations politiques de la Croix-Rouge canadienne–soit les relations officielles entre l’institution caritative et d’autres entités, comme des organisations non gouvernementales (ONG) et gouvernementales–celles qu’elle a eues avec le gouvernement canadien ont probablement été les plus déterminantes. Ces liens ont pris une forme hiérarchique souvent très sévère et restrictive aux yeux des membres de l’institution humanitaire, au point de mettre en péril certaines activités, ou d’en transformer essentiellement la nature. Ce serait toutefois une erreur de croire que l’action gouvernementale à l’égard de la Croix-Rouge canadienne fut exclusivement limitative.
Durant la guerre, bien que la Croix-Rouge canadienne ait notamment eu des liens avec les ministères des Postes, des Finances et de la Défense nationale, c’est toutefois le ministère des Services nationaux de guerre, créé en juillet 1940, qui fut son plus fréquent interlocuteur. Ce ministère était effectivement responsable, d’une manière générale, de superviser et de coordonner l’activité des ONG canadiennes engagées dans l’effort de guerre.
Dans le cas de la Croix-Rouge canadienne, l’action gouvernementale a pris trois formes principales. D’abord, le gouvernement a suggéré ou autorisé la poursuite d’activités propres à la Croix-Rouge dont il a par la suite assuré la bonne marche par une supervision pointilleuse. Cette supervision s’est particulièrement attardée aux dépenses et au financement des activités de l’institution et, dans une moindre mesure, aux procédés et à l’efficacité des activités de l’institution. Ensuite, le gouvernement a collaboré à l’œuvre de l’institution en lui allouant des fonds et du matériel, en permettant des tarifs privilégiés de même qu’en s’associant à la collecte et au partage d’informations. Il s’est finalement attardé à assurer le respect, par toutes les ONG canadiennes concernées, des limites des juridictions qui leur avaient été respectivement confiées. En contrepartie, il tirerait des avantages évidents de sa “participation” aux activités de la Croix-Rouge canadienne.
Malgré l’indépendance et l’impartialité dont elle jouissait, du moins officiellement, la Croix-Rouge canadienne a dû composer sans relâche avec les agents gouvernementaux, que ce soit pour développer des idées ou pour leur donner suite. Plusieurs des activités et services réalisés par l’institution humanitaire l’ont été en réponse aux demandes ou aux propositions gouvernementales. Elle a donc rarement pu mener des activités sans passer par des pourparlers avec le gouvernement, qui s’assurait ainsi de pouvoir éviter tout gaspillage et toute dépense injustifiée.
Il s’assurait un droit de regard constant sur les activités menées par l’institution. La mobilisation adéquate de ses ressources humaines, matérielles et financières semblait justifier, dans un contexte de guerre totale, cette manière de procéder. Cependant, si le gouvernement eut plusieurs initiatives et fut ouvert au compromis relativement aux activités concernant les prisonniers, il fut cependant plus pointilleux dans le domaine des finances (budgets et campagnes de financement).
Peu après le début de la guerre, des discussions amenèrent le gouvernement fédéral à confier à la Croix-Rouge canadienne l’organisation de tous les envois destinés aux captifs canadiens, une activité effectuée jusque-là par le gouvernement et la Croix-Rouge britanniques. Auparavant, la Croix-Rouge était plutôt restreinte à un rôle médical auprès de la population canadienne et des soldats outre-mer. En conséquence, l’institution caritative se vit allouer le droit de mettre sur pied les organes requis, et le devoir de veiller à leur conformité. Cette importante responsabilité de la Croix-Rouge canadienne–une activité qui coûterait à l’institution la plus volumineuse part de ses budgets et les plus grands efforts de logistique et de mobilisation–est donc due à l’instigation gouvernementale. La poursuite de cette œuvre envers les prisonniers de guerre sera également soumise à la volonté gouvernementale à plusieurs reprises. Vu l’importance des enveloppes budgétaires et des quantités de matériel requises, chaque hausse de la production de colis de vivres, par exemple, était impossible sans le concours des autorités.
L’origine et la poursuite des activités du Bureau d’investigation de la Croix-Rouge–responsable d’informer les parents sur le sort d’un soldat prisonnier ou disparu–à Ottawa, constituent aussi des exemples intéressants de relations avec le gouvernement. Le bureau n’entra en fonctions qu’après de nombreuses négociations, et son acte fondateur fut un arrêté ministériel. Le contrôle du bureau par le gouvernement était tel que, même après sa création officielle, il a dû retarder d’environ un mois le début de ses activités, faute d’avoir encore obtenu l’approbation du ministère des Services nationaux de guerre quant au choix de ses travailleurs. Par la suite, le gouvernement y a maintenu un droit de regard en occupant deux des trois sièges du Comité consultatif, lequel était composé des représentants des Services nationaux de guerre, des Affaires extérieures et de la Croix-Rouge canadienne.
Les actions envers les prisonniers tiraient donc fréquemment leurs origines d’initiatives gouvernementales ou, à tout le moins, d’initiatives conjointes. Le gouvernement a dû autoriser pratiquement chaque activité entreprise par l’institution avant qu’elle puisse devenir effective, et il en a ensuite supervisé le déroulement.
Cela dit, la supervision étatique fut encore plus décisive quant aux finances de l’organisme. À ce sujet, les décisions gouvernementales furent sévères, selon l’institution humanitaire, et difficiles à renverser. La Loi sur les charités de guerre de 1939 donnait un droit d’ingérence dans le contrôle des budgets des ONG réservés à l’effort de guerre qu’il n’hésita pas à utiliser. Les budgets étaient soigneusement inspectés par le ministère des Services nationaux de guerre et les principales dépenses n’avaient lieu que quand l’autorité étatique donnait son accord.
La question qui revint le plus souvent concernait le nombre de colis de vivres que la Croix-Rouge canadienne pouvait défrayer. Alors qu’elle visait constamment à en fournir le plus grand nombre que lui permettaient ses budgets tout au long de la guerre, le gouvernement espérait voir les autres sociétés de la Croix-Rouge du Commonwealth en payer la plus grande part. Il souhaitait voir l’institution canadienne espacer ses campagnes de financement au maximum et se réserver ainsi le plus de fonds possibles pour la conduite de la guerre. On acceptait que la Croix-Rouge canadienne finance tous les colis destinés à des prisonniers canadiens, mais seule une toute petite quantité des colis défrayés pouvait être donnée à des prisonniers étrangers.
Le contrôle des campagnes de financement était encore plus catégorique, n’influençant plus exclusivement l’action en faveur des captifs mais bien toute l’?uvre de guerre de l’institution. D’abord, les dates de début et de fin de ces campagnes, de même que leurs objectifs, étaient soumis à l’approbation gouvernementale. Ensuite, en 1941, le gouvernement tenta de forcer la Croix-Rouge à participer à une campagne de financement commune, à laquelle toutes les ONG impliquées dans le conflit participeraient. La Croix-Rouge canadienne refusa, de peur de perdre son individualité et de voir les autres ONG amasser des fonds en profitant de sa crédibilité. En conséquence, la Croix-Rouge, qui avait mené des campagnes de financement presque tous les deux ans durant la guerre, n’en mena pas en 1941. Afin de lui fournir les fonds nécessaires à ses activités, le gouvernement lui autorisera cependant un prêt bancaire, lequel fut rapidement remboursé.
Si le contrôle gouvernemental fut bien sévère à l’endroit de la Croix-Rouge canadienne, on peut croire qu’il l’était autant pour toutes les autres ONG du pays, ce qui semble justifiable dans un contexte où la victoire requiert la mobilisation de toutes les ressources. On constate aussi que des décisions qui semblaient inappropriées, aux yeux de l’institution, purent être renversées à force d’argumentation. Cela dit, de nombreux ministères ont néanmoins contribué à l’?uvre de l’institution.
D’abord, il en a été question précédemment, le ministre des Finances a consenti certains prêts à l’institution. Ensuite, après bien des tergiversations sur la légalité, pour la Croix-Rouge, de recevoir de l’argent de la part du gouvernement, il semble que ce dernier ait contribué financièrement à la production de colis de vivres. Le gouvernement a également consenti des tarifs spéciaux pour la conduite de certaines activités, comme le transport des denrées au Canada et outremer, et pour la livraison des publications de l’institution. La contribution matérielle du gouvernement fut aussi grandement sollicitée. Lorsque certaines denrées manquèrent, les rations du personnel militaire au Canada furent même révisées afin de libérer certaines quantités de nourriture en faveur des prisonniers. Et lorsque les infrastructures d’Europe, en mauvais état, ne permirent plus d’acheminer les denrées aux prisonniers, le gouvernement donna à la Croix-Rouge 50 camions pour qu’elle les utilise à cette fin. Finalement, le partage d’information était essentiel à l’existence du Bureau d’investigation de la Croix-Rouge. Dès l’ouverture du bureau, des relations ont été établies avec les ministères des Affaires extérieures, des Services nationaux de guerre, de la Défense nationale, des Transports et des Postes, qui fournirent bien souvent des informations privilégiées.
Ces quelques exemples ne pourraient résumer à eux seuls tous les types de coopération entre l’institution et l’État durant les six longues années de guerre. Cependant, le gouvernement, dans un contexte de guerre totale lui donnant la légitimité et le pouvoir d’intervenir dans toutes les sphères de la société fut, pour la Croix-Rouge canadienne, un allié inestimable. Malgré un contrôle parfois sévère, l’implication gouvernementale fut donc déterminante dans la conduite des activités de l’institution, et des avantages notables en ont été retirés. Cette relation s’est développée sur une base hiérarchique indiscutable, quoique l’argumentation, voire le harcèlement, par les membres de l’institution humanitaire et d’autres intervenants, permirent le renversement de décisions gouvernementales douteuses à leurs yeux.
Le gouvernement semble avoir lui aussi profité de ses relations avec la Croix-Rouge, bien que les meilleurs exemples dépassent toutefois l’action menée auprès des prisonniers de guerre provenant du Commonwealth. Effectivement, le gouvernement canadien a attaché beaucoup d’importance à l’indication de la provenance des colis de vivres (donnés ou vendus, ces colis étaient généralement transmis par l’intermédiaire de la Croix-Rouge britannique et du Comité international de la Croix-Rouge) de façon à ce que les pays concernés en soient parfaitement informés; c’est particulièrement vrai dans le cas de la France Libre. Des instructions précises étaient données afin que les caisses soient identifiées aux couleurs de la Croix-Rouge canadienne. Il était perçu par le gouvernement que ce crédit serait favorable à la conduite de la guerre. On pensait aussi que les populations alliées sous le joug de l’ennemi, et dont les soldats prisonniers avaient été aidés par le Canada, coopéreraient beaucoup plus avec la force d’invasion, lorsque la reconquête aurait lieu. On croyait également que les pays aidés pourraient ultimement “lui revaudraient” dans l’après-guerre. Au niveau du front intérieur, le travail accompli par la Croix-Rouge auprès des prisonniers de guerre a certainement contribué à rassurer leurs parents, et a ainsi pu jouer un rôle quasi propagandiste, en démontrant à la population que l’État et la Croix-Rouge maîtrisaient bien la situation.
En somme, les buts du gouvernement, en ce qui concerne la Croix-Rouge canadienne, étaient loin d’être exclusivement humanitaires. Ce dernier était également à la recherche de capital politique sur le plan international, et même d’objectifs stratégiques et tactiques. Le gouvernement a donc grandement profité des activités de la Croix-Rouge canadienne, qu’il a su modeler ou presque, selon certains de ses besoins.
À un autre niveau, en confiant à un organisme bénévole des tâches nécessaires pour lesquelles il aurait dû, en d’autres circonstances, payer un fort prix, le gouvernement s’est assuré des économies importantes, puisque l’argent dépensé par la Croix-Rouge provenait, dans sa plus grande partie, de la population, et non pas des coffres de l’État. Comme l’institution caritative faisait aussi appel à des bénévoles pour les activités de transformation et d’empaquetage, le gouvernement économisait en n’ayant pas à payer lui-même une main-d’œuvre salariée. Le coût de la collaboration du gouvernement fédéral canadien aux activités de la Croix-Rouge lui a ainsi été remis, d’une autre manière, au quintuple, et il en a tiré des avantages politiques, militaires et économiques.
Des effets sociaux découleraient également des activités de la Croix-Rouge canadienne. Effectivement, en aidant les prisonniers de guerre à satisfaire leurs besoins primaires et certains besoins secondaires, l’institution humanitaire les a aidés à survivre et peut-être même à ressentir un relatif bien-être dans des conditions autrement plus pénibles encore. À plus long terme, ces prisonniers ont pu garder moins de séquelles de leur captivité, et réintégrer plus facilement la vie civile. En bonne santé physique, ils auront bénéficié d’une meilleure espérance de vie, et en bonne santé mentale, d’une vie plus heureuse. En conséquence, les prisonniers “réchappés” par la Croix-Rouge ont été un fardeau bien moindre pour l’État, après la guerre. On put donc compter sur des rapatriés en meilleur état, qui coûteraient moins cher à la société et participeraient davantage au bien commun.
En conclusion, la Croix-Rouge canadienne n’était pas aussi indépendante qu’on veut bien le faire croire. En effet, le gouvernement a eu sur elle une influence importante, et il faut avouer que ces initiatives ont grandement contribué à faire de l’aide en faveur des prisonniers de guerre ce qu’elle a été. La collaboration en matière de financement, de matériel, de logistique et d’information a été déterminante dans la poursuite et la bonne marche de l’œuvre. Et bien que le gouvernement ait contrôlé de très près les activités de l’institution, l’argumentation et la négociation ont souvent permis à l’organisme de faire valoir son point de vue, et de renverser favorablement certaines situations.
En contrepartie à tous ses efforts, le gouvernement canadien a récolté des profits importants et nombreux. D’abord, il a fait des économies matérielles et financières importantes, en faisant effectuer par la Croix-Rouge et ses bénévoles des ouvrages qui lui auraient autrement coûté très cher. Puis il a gagné des avantages tactiques et stratégiques, en faisant bonne impression aux yeux des populations alliées des pays occupés par l’ennemi. Cette reconnaissance, à plus long terme et au niveau des relations entre États, a pris ensuite la forme de capital politique sur la scène internationale. Au Canada, cette bonne impression a contribué à rehausser le moral de la population et l’a incitée à s’impliquer davantage dans la prochaine victoire. Finalement, le gouvernement s’est affranchi d’un important fardeau en pouvant compter sur des prisonniers rapatriés en meilleure santé physique et mentale, qui pourraient eux-mêmes participer, à la pleine mesure de leurs capacités, à la société.
À la lumière de ces quelques faits et interprétations, il devient clair que la Croix-Rouge canadienne n’a pas été–et de loin–affranchie de tout contrôle étatique durant les années de guerre, puisque le gouvernement a maintenu un contrôle strict sur les activités de l’institution et qu’il a même tiré profit d’activités dont le but avoué était d’abord et avant tout humanitaire. Une question demeure donc : pourquoi les liens unissant gouvernement et Croix-Rouge continuent-ils d’être négligés de l’historiographie, et pourquoi l’entretien du mythe d’une Croix-Rouge indépendante de tout contrôle étatique revêt-il autant d’importance, aux yeux de ses membres?