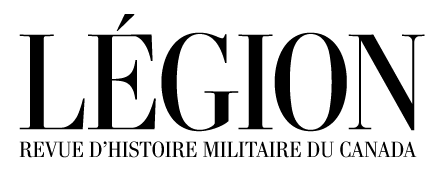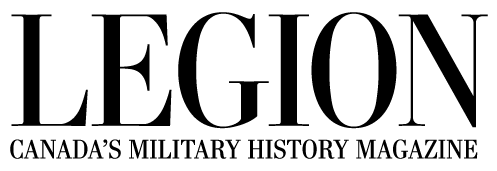Les premiers qui se sont aperçus de la victoire à Vimy sont ceux qui l’ont vue à travers les pansements imprégnés de sang.
C’était le milieu de la matinée du 9 avril quand l’infirmier Will Antliff a pu faire une pause pour respirer durant le premier jour de la bataille de la crête de Vimy. Le simple soldat Antliff, qui servait dans la 9e Ambulance de campagne du Service de santé de l’armée canadienne, s’est concentré sur son travail durant les premières heures de la bataille, prenant note de la nature des blessures, ainsi que de l’unité, du nom et du numéro de chaque soldat blessé dont le personnel médical s’occupait.
Stationné à quelques kilomètres derrière le front au poste de secours de Villers-au-Bois, Antliff remarquait dans une lettre : “Le grand nombre de Frisés qui passaient par ici était une caractéristique des plus encourageante.” Vu que ses camarades du corps de santé et lui s’occupaient de plus de troupiers allemands que canadiens, Antliff s’est aperçu rapidement que ses compagnons de l’infanterie canadienne devaient être en train de gagner la bataille.
Des heures auparavant, la veille de la grande attaque printanière contre les Allemands dans la région d’Arras du Nord-Centre de la France, les membres du service de santé, dont Antliff, avaient été avertis par les généraux alliés de s’attendre à 25 000 victimes durant la bataille. Ce que même les généraux n’osaient prédire, toutefois, c’est l’efficacité des quatre divisions d’infanterie canadienne, qui se battaient pour la première fois en tant que force unie, et la vitesse à laquelle elles allaient atteindre leurs objectifs. Au bout de huit heures à partir de l’heure zéro, soit à 5 h 30, le 9 avril 1917, le Corps canadien de 100 000 hommes avait arraché une grande partie de la crête de Vimy à une armée allemande retranchée (les Canadiens allaient prendre le reste au cours des trois jours qui suivirent). Il s’agissait de quelque chose que les troupes alliées n’avaient pas réussi à faire en 31 mois de guerre au front occidental. La presse française a appelé cela “le cadeau de Pâques” que le Canada a fait à la France.
L’assaut canadien avait coûté 10 602 victimes au corps, dont 3 598 morts. Mais Antliff, âgé de 19 ans, avait déduit correctement en ce lundi matin de Pâques que les Canadiens étaient en train de remporter la bataille. Une force combattante formée principalement de jeunes volontaires ordinaires, y compris des fermiers, des pêcheurs, des exploitants de ranch, des mineurs, des bûcherons, des commis de banque et des étudiants d’université, était en train d’évincer une armée allemande régulière à une bataille cruciale en Europe. Et en tant qu’ancien étudiant en commerce à l’Université McGill, Antliff rapportait dans sa lettre du 13 avril à sa mère, “les Canadiens se sont distingués (à Vimy) comme ils l’ont fait auparavant à Ypres et à la Somme”. Si vite après la bataille historique, Antliff exprimait ce qu’un autre vétéran de Vimy décrivait comme étant “le premier sentiment complet de statut de nation”. D’aucuns allaient dire que cette victoire par les citoyens soldats a donné naissance au Canada en tant que nation.
La fierté concernant son pays n’était pas exactement une provocation pour le fermier saskatchewannais Gavin McDonald qui a servi à Vimy. Effectivement, pendant la première année de la Grande Guerre, ce homesteader de la prairie âgé de 25 ans l’avait pratiquement dédaignée. Construire une maison et une grange, s’occuper du cheptel et défoncer le gazon pour cultiver le quart de section familial à Craik, près de Regina, c’était cela le plus important à ses yeux. En fait, McDonald parle de son engagement, dans son mémoire, comme s’il s’agissait d’un article comme les autres dans sa liste de choses à faire. “Nous avons eu une bonne récolte cette année-là… De bons prix (plus d’un dollar le boisseau), le bon moment de creuser un puits plus près des édifices… Après avoir creusé la plus grande partie, je me suis engagé dans l’armée, le 3 décembre 1915.”
Six mois après, bien entraîné en ce qui concerne les fusils, les baïonnettes et les grenades, McDonald atterrissait en France dans le cadre des renforts prévus pour la Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, mais il fut envoyé au saillant d’Ypres où on crut que c’était un bûcheron, alors on l’affecta à la construction de tranchées et de chemins de rondins.
Au mois de mars, les ingénieurs de l’Armée canadienne avaient planifié la construction de 11 000 verges de passages souterrains, de tunnels qui reliaient les zones derrière les lignes canadiennes aux tranchées du front, sous le nez de l’ennemi. Durant les dernières semaines avant l’attaque du 9 avril, le caporal suppléant McDonald se joignait à la ruse compliquée qui cachait ce creusage furieux. “Notre travail était au front du tunnel” écrivait McDonald. “Au fur et à mesure que les mineurs ramassaient le calcaire, nous le mettions dans des sacs. Pendant la journée nous empilions les sacs dans le tunnel et la nuit nous les jetions dans les cratères d’obus. Ensuite, juste avant l’aube, nous le recouvrions (le sol du tunnel) avec du camouflage.”
Huit heures pour le travail et huit heures pour les repas et le sommeil, McDonald et son équipe de camouflage ont déguisé des tonnes de craie à Vimy. “À 10 h du soir, le 8, nous avions fini de creuser. Il n’y avait pas suffisamment de place” pour que les équipes continuent de creuser le tunnel et de le camoufler lorsque la force d’attaque s’y rassemblait La dernière tâche de McDonald était d’emporter les dossiers de l’adjudant de la position, par précaution. Dans sa dernière note à Vimy, il écrivait “nos gros canons tiraient tous au lever du soleil et l’attaque commençait […]”.
Jusqu’à la bataille de Vimy, les tactiques de combat (des deux côtés) avaient suivi un script douloureusement prévisible. Un bombardement intense soudain de l’artillerie pour “ramollir” les positions ennemies. Ensuite une pause, et puis une offensive concertée par l’infanterie. Une telle prévisibilité indiquait souvent un désastre pour les fantassins. Le premier jour de l’offensive alliée à la Somme, en 1916, par exemple, 780 hommes du 1st Newfoundland Regiment sont passés à l’attaque (confiants que leur artillerie avait fait taire les armes des Allemands) et ils furent fauchés par les mitrailleuses allemandes qui n’étaient pas si silencieuses que ça. Le régiment souffrit des pertes de 85 pour cent.
Ce ne fut pas le cas à Vimy. Là-bas, les équipes d’artilleurs canadiens donnèrent une précision chirurgicale à la force brutale du bombardement d’artillerie. Le caporal Elmore Philpott a été témoin direct de l’émergence des opérations canadiennes de contrebatteries. Laissant ses études à l’Université de Toronto de côté de manière temporaire en 1914, parce qu’il avait peur que “la guerre se termine avant la Noël” Philpott obtint une formation de transmetteur et se joint à la 25e Batterie de campagne du Canada. Il arriva à Vimy à temps pour apprendre la science du repérage par éclats (observation de l’éclat dans les canons de l’artillerie) et le pointage sonore (utiliser des microphones pour découvrir la position des canons) pour localiser exactement les batteries allemandes. En conséquence, son travail, dans le cadre duquel il regardait la position des canons ennemis dans des jumelles, devint crucial. En tant qu’observateur avancé, il était littéralement les yeux et les oreilles de son unité de batteries d’obusiers. “Jusqu’à ce temps-là, on tirait au petit bonheur”, Philpott dit une fois. “Par la suite on dirigeait le feu grâce à des calculs mathématiques soigneux”.
Philpott appelait ça la planification, pas l’entraînement. Ensuite, en se servant de données de correspondance, les canonniers canadiens identifiaient la position des batteries allemandes avec une précision de moins de quelques mètres et ils les anéantirent systématiquement durant les sept jours précédant le 9 avril. Les défenseurs allemands qui ont enduré l’offensive de contrebatterie canadienne l’appelaient “la semaine de la souffrance”. De dire Philpott, “c’était une magnifique partie de l’opération, une des plus grandes opérations de toute la guerre”.
La précision des opérations de contrebatterie canadienne n’intéressait guère le carabinier Ellis Sifton. Ce fermier de 25 ans de Wallacetown (Ont.) avait d’autres responsabilités à Vimy. Le 18e Bataillon (de l’Ontario de l’ouest) dont il faisait partie se trouvait dans le secteur de la 2e Division, près du milieu au front de Vimy à la fin de 1916. Et durant l’hiver, le caporal suppléant Sifton, d’après ce qu’il décrivait dans les lettres qu’il envoyait à ses soeurs, avait “des postes à l’abri des bombes”. Il charroyait des munitions, participait à des corvées de nettoyage de chariots et de chevaux, et il transportait des rations.
Ensuite, alors qu’un temps hivernal terrible prenait prise du secteur, toutes les permissions furent annulées et Sifton apprit que son régiment allait passer à l’attaque dans le cadre de l’offensive de Pâques. Bien qu’il ne puisse pas donner cette information sensible à ses soeurs dans les lettres qu’il leur écrivait, il leur fit part de ses sentiments à propos de l’assaut à venir. “J’espère que j’aurai le courage au bon moment, si le sort veut que je regarde la mort en face”, écrivait-il. “Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de nouvelles, car ce n’est pas toujours commode d’écrire […].”
Et il ajoutait “P.s. J’ai été promu au grade de sergent.”
À l’heure zéro, soit 5 h 30, Sifton regardait ses camarades de la 4e Brigade s’élancer de leurs tranchées et s’avancer en suivant un barrage traînard, un rideau d’obus qui explosaient, et qui s’avançait juste devant l’infanterie canadienne, permettant aux attaquants d’atteindre les défenseurs avant qu’ils n’aient l’occasion de réagir. En allant vers leur objectif, le village des Tilleuls, les régiments qui flanquaient celui de Sifton ont affronté une résistance qui se corsait. Les mitrailleurs allemands avaient fait ralentir le progrès des Canadiens au bout de 90 minutes après le début de l’offensive. Son bataillon, le 18e, se joignit à l’attaque et perdit plusieurs de ses officiers et de ses hommes à cause des armes allemandes bien situées. Sifton se sentit obligé d’agir et entre les rafales des mitrailleuses, il courut en avant jusqu’à un nid ennemi.
Il est écrit dans des journaux de guerre que Sifton “localisa l’arme, l’attaqua tout seul et en tua l’équipe au complet. Un petit groupe d’ennemis s’avançait le long de la tranchée, mais il réussit à les repousser jusqu’à ce que (des troupes canadiennes) le rejoignent.”
Durant les derniers moments où ils prenaient le nid de la mitrailleuse, les attaquants canadiens négligèrent un Allemand mourant qui ramassa un fusil qui avait été jeté, mit Sifton en joue et le tua d’un seul coup de feu. Le fermier de Wallacetown, qui avait eu peur de vaciller au moment crucial dans son baptême du feu, avait trouvé le courage de regarder la mort en face. La citation et la Croix de Victoria posthume applaudissent “sa bravoure exceptionnelle (qui a) indubitablement sauvé bien des vies et contribué en grande partie au succès de l’opération”. Au bout d’une heure, les troupes canadiennes avaient atteint et libéré les Tilleuls, à mi-chemin en direction de l’objectif de la 2e Division le premier jour.
L’héroïsme à la bataille de la crête de Vimy prit différentes formes. Et pas toujours au milieu des combats qui avaient lieu au front. Durant la fin de l’après-midi du 9 avril, la nouvelle de l’avance extraordinaire des Canadiens au front de 14 kilomètres à Vimy atteignait la côte française. Une fois de plus, se préparant au pire, le quartier général allié avait avertit les autorités médicales à l’Hôpital général no 1, à Étaples, de préparer 65 ambulances motorisées pour recevoir les blessés canadiens aux voies d’évitement locales cette nuit-là. Quand elle fut avertie, la chauffeuse d’ambulance Grace MacPherson sut que son quart normal de 12 heures au travail et 12 heures de repos était improbable. Elle se prépara pour ce qui serait peut-être 60 heures sans sommeil, à aller chercher des blessés à la gare d’Étaples pour les transporter aux hôpitaux militaires d’Étaples où 50 000 lits les attendaient.
La femme impulsive de Vancouver, âgée de 19 ans, savait depuis le tout début de la guerre qu’elle allait servir son pays. MacPherson était si décidée que lorsque ni la Croix-Rouge d’Ottawa ni la britannique ne semblaient vouloir l’assister dans son désir de servir le Corps expéditionnaire canadien, elle paya son passage transatlantique elle-même. Ensuite, elle défia les généraux, y compris le commandant Sam Hughes du Corps expéditionnaire canadien qui interdisait aux femmes de servir près du front, et obtint un travail en tant que chauffeuse d’ambulance près de la côte française. Bien entendu, le travail exigeait plus que la simple conduite d’ambulance; MacPherson maintenait son moteur, changeait les pneus crevés et prenait soin du compartiment à quatre brancards afin qu’il soit toujours plein et propre.
À partir de l’après-midi du 9 avril, MacPherson travailla nuit et jour. Le voyage de la voie ferrée d’Étaples jusqu’à l’hôpital était de moins d’un mille, mais les conditions hivernales de la côte française, en ce lundi de Pâques, rendaient la route glissante et sournoise. Elle se souvient d’avoir fait une douzaine de voyages durant ce quart-là, allant à des vitesses de quatre et même cinq milles à l’heure. “C’était la première fois que des troupiers, les blessés, avaient été envoyés directement des tranchées. Il y en avait tant que les postes d’évacuation sanitaire n’avaient pas le nécessaire pour s’en occuper. Alors ils étaient envoyés directement à Étaples. Et c’était un groupe à l’air déplorable.”
Toutefois, elle ne permit ni à la vue des blessures horribles ni aux cris de douleur de la décourager. Si un souffrant en arrière de l’ambulance lançait des plaintes, MacPherson répondait : “Ça suffit comme ça! Les gens qui geignent comme ça ne sont pas admis dans mon ambulance.” Ou s’il se plaignait de sa malchance, elle essayait de le distraire en disant : “Regardez, je me suis écrasé le pouce.” Elle refusait de prendre le risque d’investir ses émotions dans ses passagers. Et pourtant elle leur promettait : “vous allez avoir la meilleure ballade de votre vie.”
Au moment où elle terminait son premier voyage jusqu’à l’Hôpital général no 1 ce jour-là, les troupes canadiennes avaient un bon pied sur la crête de Vimy. Au milieu de l’après-midi du 9 avril, des unités des 1re et 2e divisions d’infanterie avaient atteint le sommet qui surplombait la plaine de Douai, le territoire que les Allemands avaient occupé pendant presque deux ans. Pour les vétérans de l’infanterie canadienne, regarder l’ennemi qui battait en retraite était grandement satisfaisant “lui rendant sans compter ce qu’il nous avait donné à Ypres, à Wytschaete et à la Somme”.
Philpott, prenant la place d’un observateur de batterie avancé blessé, prenait note de ses pensées peu après 14 h cet après-midi-là. “J’ai atteint le sommet de la crête de Vimy”, écrivait-il. “Je ne sais pas ce qui m’y a fait pensé mais ‘les enfants d’Israël regardant la terre promise (me vint à l’esprit). Ici, à perte de vue, mille après mille […] ici se trouvait l’armée allemande qu’on a clairement battue. On pouvait les voir qui allaient de-ci de-là. C’était une scène pleine de confusion.”
Un autre observateur avancé jurait qu’il avait attendu ce moment-là pendant des années, mais son équipe ne pouvait pas monter les canons jusqu’en haut de la crête assez vite pour pouvoir se venger des Allemands qui battaient en retraite.
Bien entendu, la presse prit note de l’accomplissement de l’armée des citoyens du Canada. Le correspondant de guerre britannique Philip Gibbs appelait l’escalade canadienne de Vimy “la plus importante victoire que nous ayons obtenu durant cette guerre”, alors que le reporter canadien Stewart Lyon écrivait “c’était une occasion noble et les Canadiens se sont noblement montrés à la hauteur”. Les Américains, qui n’étaient entrés en guerre que trois jours auparavant, disaient que “le 9 avril 1917 sera inscrit dans l’histoire du Canada comme un des grands jours, un jour de gloire qui inspirera ses fils pendant des générations à venir”.
L’allégresse de la victoire était modérée parmi les troupes de la Compagnie C du 18e Bataillon. Les camarades d’Ellis Sifton transportèrent son corps à l’endroit d’où ils s’étaient lancés à l’attaque ce jour-là et ils l’enterrèrent dans un cimetière de fortune, dans le cratère de bombe de Litchfield.
Le commis médical Will Antliff ne prit pas de repos tant que le dernier des blessés dans le secteur de la 9e Ambulance de campagne n’eut obtenu de soins médicaux. Curieusement, une impression fut gravée dans sa mémoire alors que ses compagnons brancardiers et lui traversaient le territoire nouvellement libéré par les Canadiens. “En montant, nous empruntions la route plutôt que la tranchée”, écrivait Antliff, “ce qui aurait été complètement fou une semaine auparavant. Des hommes marchaient partout en surface. Ça avait vraiment l’air étrange […]. Nous sommes finalement arrivés à destination, quelque part le long de l’ancien front des Frisés. Lorsque nous sommes arrivés, on lançait des fusées étoiles mais, à part quelques mitrailleuses au loin, la nuit était soudainement tranquille.”
Comme il avait déduit la victoire en comptant les victimes allemandes, l’infirmier canadien profitait alors d’un des avantages revenant de droit aux vainqueurs : la liberté de se tenir debout dans le no man’s land.